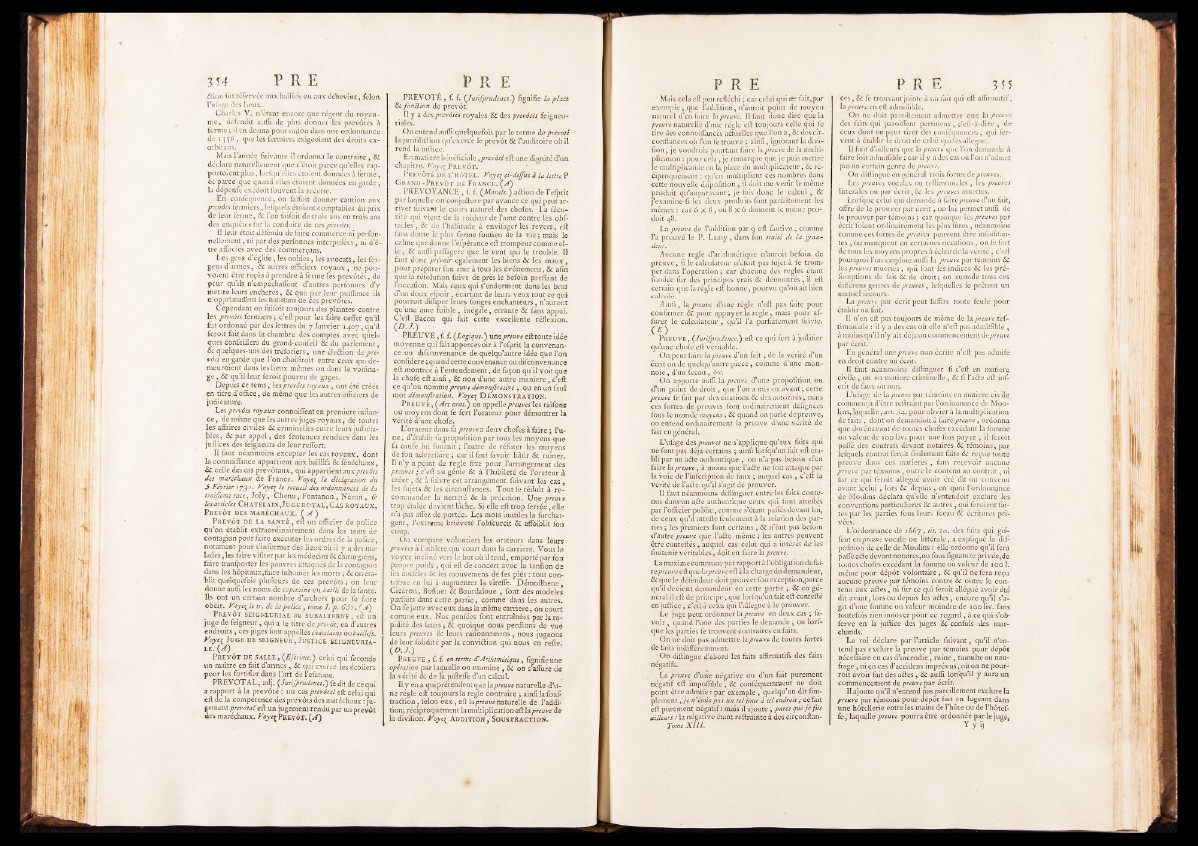
£lion fut réfervce aux baillifs ou aux échevins, félon
Pu (âge des lieux.
Charles V. n’étant -encore que régent du royaume,
défendit auffi de plus donner les prévôtés à
ferme ; il en donna pour raifon dans une ordonnance
de 1 356, que les fermiers exigeoient des droits ex-
or bilans.
Mais l’année fuivante il ordonna le contraire , &
déclara naturellement que c’étoit parce qu’elles rap-
portoientplus, lorfqu’elles étoient données à ferme,
& parce que quand elles étoient données en garde,
la dépenfe cxédoit fouvent la recette.
En conféquence, on faifoit donner caution aux
prévôts fermiers, lefquels étoient comptables du prix
de leur ferme, 6c l’on faifoit de trois ans en trois ans
des enquêtes fur la conduite de ces prévôts.
Il leur étok défendu de faire commerce ni perfon-
nellement, ni par des perfonnes interpofées, ni d’être
affociés avec des commerçans.
Les gens d’églife, les nobles, les avocats,' les fer-
gens d’armes, & autres officiers ro y au x , ne pou-
voient être reçus à prendre à ferme les prévôtés, de
peur qu’ils n’empêchaffent d’autres perfonnes d’y
mettre leurs enchères, & que par leur puiffance iis
n’opprimaffent les habitans de ces prévôtés.
Cependant on faifoit toujours des plaintes contre
les prévôts fermiers ; c’eft pour les faire ceffer qu’il
fut ordonné par des lettres du 7 Janvier 14 0 7 , qu’il
feroit fait dans la chambre des comptes avec quelques
confeillers du grand-confeil & du parlement,
& quelques-uns des tréforiers, une élettion de prévôts
en garde que l ’on choifiroit entre ceux qui de-
meuroient dans les lieux mêmes ou dans le voifina-
ge , & qu’il leur feroit pourvu de gages.
Depuis ce tems, les prévôts royaux, ont été créés
en titre,d’office, de même que les autres officiers de
judicature.
Les prévôts royaux connoiffertt en première in (lance
, de même que les autres juges royaux, de toutes
les affaires civiles 6c criminelles entre leurs jufticia-
bles, 6c par appel, des fentences rendues dans les
juftices des feigneurs de leur reffort.
Il faut néanmoins excepter les cas royaux, dont
la connoiffance appartient aux baillifs 6c fénéchaux,
& celle des cas prevôtaux, qui appartient aux prévôts
des maréchaux de France. Foye{ la déclaration du
S Février 17 3 1- F'oyei le recueil des ordonnances de la
troifiemt race, Jo ly , Chenu, Fontanon , Néron , &
les articles CHATELAIN, JüGËROYAL,CaS ROYAUX,
Prévôt des maréchaux. ( A )
Prévôt de la santé , eft un officier de police
qu’on établit extraordinairement dans les tems de
contagion pour faire exécuter les ordres de la police,
notament pour s’informer des lieux où il y a des malades
, les faire vifiter par les médecins & chirurgiens,
faire tranfporter les pauvres attaqués de la contagion
dans les hôpitaux,faire inhumer les morts ; &: on établit
quelquefois plufieurs de ces prévôts ; on leur
donne auffi les noms de capitaine ou bailli de la (anté.
Us ont un certain nombre d’archers pour fe faire
obéir. Foyei le tr. de la police , tome I. p. $ 5 2 . (A)
Prévôt seigneurial ou subalterne, eft un
juge de feigneur, qui a le titre de prévôt; en d’autres
endroits, ces juges font appelles châtelains ou baillifs,
Fqyc[ Juge de seigneur, Justice seigneuriale.
{A ) I
Prévôt de salle, (Efcrime.) celui qui fécondé
lin maître en fait d’armes , 6c qui exerce les écoliers
pour les fortifier dans l ’art de l’efcrime.
PR EVO TA L, adj. (Jurifprudence.) fe dit de ce qui
a rapport à la prévôté : un cas prevôtal eft celui qui
e(l de la compétence des prévôts des maréchaux : jugement
prevôtal eft un jugement rendu par un prévôt
des maréchaux. Voye^ Preyôt. (A )
PRÉVÔTÉ , f. f. { Ju r if prudence?) fignifie la place
6c fonction de prévôt.
Il y a des prévôtés royales 6c des prévôtés feigneu-
riales.
On entend auffi quelquefois par le terme de prévôté
la jurifdiftion qu’exerce le prévôt 6c l’auditoire où il
rend la iuftice.
En matière bénéficiale,prévôté eft une dignité d’un
chapitre. Voye^ Prévôt.
Prévôté de l’hôtel. V?yeç ci-dejfus à la lettre P
Grand - Prévôt de France. (A )
PR ÉVO YAN C E , f. f. (Morale.) aftion de l’efprit
par laquelle on conjeélure par avance ce qui peut arriver
luivant le cours naturel des chofes. La fécu-
rité qui vient de la roideur de l’ame contre les obf-
tacles, & de l’habitude à envifager les revers, eft
fans doute le plus ferme foutien de la vie ; mais le
calme que donne l’efpérance eft trompeur comme elle
, 6c auffi paffagere que le vent qui le trouble. Il
faut donc prévoir également les biens & les maux,
pour préparer fon ame à tous les événemens, 6c afin
que la réfolution fuive de près le befoin preffant de
I occafion. Mais ceux qui s’endorment dans les bras
d’un doux efpoir, écartant de leurs yeux tout ce qui
pourroit diffiper leurs fonges enchanteurs, n’auront
qu’une ame foible, inégale, errante 6c fans appui.
C’eft Bacon qui fait cette excellente réflexion.
( -D .7. )
P R EU V E , f. f. (Logique.) une preuve eft toute idée
moyenne qui faitappercevoir à l’efprit la convenance
ou difconvenânce de quèlqu’autre idée que l’on
confidere ; quand cette convenance ou difconvenânce
eft montrée à l’entendement, de façon qu’il voit que
la chofe eft ainli, 6c non d’une autre maniéré, c’eft
ce qu’on nomme preuve démonjtrative , ou en un feul
mot démonftration. Voye{ DÉMONSTRATION.
Preuve, (Art orat.) on appelle preuves les raifons
ou moyens dont fe fert l’orateur pour démontrer la
vérité d’une chofe.
L ’orateur dans fa preuve a deux chofes à faire ; l’une
, d’établir fa propofition par tous les moyens que
fa caufe lui fournit ; l’autre de réfuter les moyens
de fon adverfaire ; car il faut favoir bâtir & ruiner.
II n’y a point de réglé fixe pour l’arrangement des
preuves ; c’ eft au génie & à l’habileté de l’orateur à
cré e r, 6c à fuivre cet arrangement fuivant les cas ,
les fujets & les circonftances. Toutfe réduit à recommander
la netteté & la précifion. Une preuve
trop étalée devient lâche. Si elle eft trop ferrée, elle
n’a pas affez de portée. Les mots inutiles la furchar-
gent, l’extreme brièveté l’obfcurcit 6c affoiblit fon
coup.
On compare volontiers les orateurs dans leurs
preuves à l’athlete qui court dans la carrière. Vous le
voyez incliné vers le but où il tend, emporté par fon
propre poids , qui eft de concert avec la tenfion de
fes mufcles 6c les mouvemens de fes pies : tout contribue
en lui à augmenter la vîteffe. Démofthene,
Cicéron, Boffiiet 6c Bourdaloue , font des modèles
parfaits dans cette partie, comme dans les autres.
On fe jette avec eux dans la même carrière, on court
comme eux. Nos penfées font entraînées par la rapidité
des leurs ; & quoique nous perdions de vue
leurs preuves 6c leurs railbnnemens , nous jugeons
de leur foiidité par la convi&ion qui nous en refte.
m m
Preuve , f. f. en terme d?Arihtmétique, fignifie une
opération par laquelle on examine , 6c on s’affure de
la vérité 6c de la jufteffe d’un calcul.
Il y en a qui prétendent que la preuve naturelle d’une
régie eft toujours la réglé contraire ; ainfi la foufi
tra&ion, félon e u x , eft la preuve naturelle de l’addition;
réciproquement la multiplication eft la preuve de
la divifion, Foye^ Addition, Soustraction.
M a is c e la e ft p e u ré flé ch i ; c a r c e lu i q u i n e la i t , p a r
e x e m p l e , q u e l’a d d it io n , n ’a u r o it p o in t d e m o y e n
n a tu r e l d ’e n fa i r e la preuve. I l fa u t d o n c d ire q u e la
preuve n a tu re lle d ’un e r é g ie e ft to u jo u r s c e lle q u i fe
t ir e d e s c o n n o iffan c e s a d u e l le s q u e l ’o n a , 6c d e s c ir c
o n ft a n c e s o ji l’o n fe t r o u v e ; a in f i , ig n o r a n t la d i v if
io n , je v o u d r o is p o u r tan t fa i r e la preuve d e la m u lt ip
l ic a t io n : p o u r c e la , j e rem a rq u e q u e je p u is m e t t re
l e m u lt ip lic a n d e en la p la c e d u m u l t ip l i c a t e u r , 6c r é c
ip ro q u em e n t : q u ’ e n m u lt ip lian t c e s n om b r e s dan s
c e t t e n o u v e l le d i fp o f i t io n , i l d o it m e v e n i r le m êm e
p r o d u it q u ’a u p a r a v a n t ; je fa is d o n c le c a lc u l , 6c
j ’ e x am in e f i le s d e u x p ro d u it s fo n t p a r fa item e n t le s
m êm e s : c a r 6 x 8 , o u 8 X 6 d o n n e n t le m êm e p r o d
u it 4 8 .
L a preuve d e l’a d d it io n p a r q e ft fa u t iv e , c om m e
l ’a p r o u v é le P . L a m y , d an s fo n traité de la grandeur.
A u c u n e r é g lé d’ a r ithm é t iq u e n ’a u r o it b e fo in d e
p r e u v e ., fi le c a lc u la te u r n ’é to it p a s fu je t à fe t rom p
e r d an s l’ o p é r a t io n ; c a r c h a cu n e d e s r é g lé s é tan t
fo n d é e fu r d e s p r in c ip e s v r a i s 6c d ém o n t r é s , i l e ft
c e r t a in q u e la r é g ie e ft b o n n e , p o u r v u q u ’o n a it b ien
c a lc u lé .
A in f i , la preuve 'd ’u n e r é g ie n ’e ft p a s fa ite p o u r
c o n firm e r 6c p o u r a p p u y e r la r é g l é , m a is p o u r a f -
fu r e r le c a lc u la t e u r , q u ’i l l ’a p a rfa item e n t fu iv ie . K9| ■
P r e u v e , (jurifprudence.) e ft c e q u i f e r t à ju ft ifie r
q u ’u n e c h o fe e ft v é r it a b le .
O n p e u t f a ire la preuve d ’ un f a i t , d e la v é r i t é d’ un
é c r i t o u d e q u e lq u ’a u t r e p i e c e , c om m e d ’u n e m o n -
n o i e , d’un ( c e a u , &c.
O n a p p o r t e a u ffi la preuve d’ u n e p r o p o fi t io n o u
d ’u n p o in t d e d r o i t , q u e l’o n a m is e n a v a n t ; c e t t e
preuve fie fa it p a r d e s c ita t io n s 6c d e s a u t o r i t é s ; m a is
c e s fo r t e s d e p r e u v e s fo n t o rd in a irem e n t d é fign c e s
fo u s le n om d e moyens ; 6c q u a n d o n p a r le d e p r e u v e ,
o n e n te n d o rd in a irem e n t la p r e u v e d’u n e v é r i t é d é
fa i t e n g é n é r a l.
L ’u fa g e d e s preuves n e s ’ a p p liq u e q u ’ a u x fa it s q u i
n e fo n t p a s d é jà c e r t a in s ; a in fi lo r fq u ’u n fa it e ft é t a b
l i p a r u n a & e a u th e n t iq u e , o n n ’a p a s b e fo in d ’en
f a i r e la preuve, à m o in s q u e l ’a f t e n e fioit a t ta q u é p a r
l a v o i e d e l’ in fc r ip t io n d e f a u x ; a u q u e l c a s , c’ e ft la
v é r i t é d e l’ a f t e q u ’i l s’ a g it d e p r o u v e r .
I l fa u t n é a nm o in s d ift in g u e r e n t re le s fa it s c o n te n
u s d a n s u n a â e a u th e n t iq u e c e u x q u i fo n t a t te fté s
p a r l ’o f fic ie r p u b l i c , c om m e s ’ é tan t p a ffé s d e v a n t lu i,
d e c e u x q u ’ i l a t te fte fe u lem e n t à la re la t io n d e s p a r t
ie s ; le s p r em ie r s fo n t c e r t a in s , 6c n’ ô n t p a s b e fo in
d ’a u t r e preuve q u e l ’a & e m êm e ; le s a u t r e s p e u v e n t
ê t r e c o n te fté s , a u q u e l c a s c e lu i q u i a in t é r ê t d e lé s
fo u t e n ir v é r i t a b le s , d o it e n f a i r e la preuve.
L a m a x im e c om m u n e p a r ra p p o r t à l’o b lig a t io n d é f a ir
e preuve e ft q u e l a preuve e ft à la c h a rg e d u d em an d e u r ,
& q u e le d é fe n d e u r d o it p r o u v e r fo n e x c e p t io n ,p a r c e
q u ’ il d e v ie n t d em an d e u r e n c e tt e p a r t ie ; 6c e n g é n
é r a l i l e ft d e p r in c ip e , q u e lo r fq u ’ u n fa it e ft c o n te fté
e n ju f t i c e , c ’ e ft à c e lu i q u i l’a lle g u e à le p r o u v e r .
L e ju g e p e u t o rd o n n e r la preuve e n d e u x c a s ; fa v
o i r , o u an d l’u n e d e s p a r t ie s le d em a n d e , o u lo r f -
q u e le s p a r t ie s f e t ro u v e n t c o n t r a ir e s e n fa its .
O n n e d o it p a s a dm e t t re la preuve d e to u te s fo r te s
d e fa its in d iffé rem m e n t .
O n d ift in g u e d’a b o rd le s fa its affirm a t ifs d e s fa its
n é g a t ifs .
L a preuve d’ u n e n é g a t iv e o u d’u n fa i t p u rem e n t
n é g a t i f e ft im p o f f ib le , 6c c o n fé q u em m e n t n e d o it
p o in t ê t r e adm ife : p a r e x em p le , q u e lq u ’ un d it Amp
lem e n t ,y e nétois pas un tel jo u r a tel endroit ; c e fa it
e ft p u rem e n t n é g a t i f : m a is il a jo u t e , parce que j e fu s
ailleurs : la n é g a t iv e é t an t r e ft r a in t e à d e s c ir ç o n ftan -
Tome X I I I .
ces, 6c fe trouvant jointe à un fait qui eft affirmatif,
la preuve en eft admiffible.
On ne doit pareillement admettre que la preuve
des faits qui paroiffent pertinens , c’eft-à-dire , de
ceux dont on peut tirer des confcquences, qui fervent
à établir le droit de celui qui les allégué.
Il faut d’ailleurs que la preuve que l’on demande à
faire foit admiffible ; car il y a des cas où l’on n’admet
pas un certain genre de preuve.
On diftingue en général trois fortes de preuves.
Les preuves vocales ou teftimoniales , les preuves
littérales ou par écrit, 6c les preuves muettes.
Lorfque celui qui demande à faire preuve d’un fait,
offre de le prouver par écrit, on lui permet auffi de
le prouver par témoins ; car quoique les preuves par
écrit foient ordinairement les plus fûres , néanmoins
comme ces fortes de preuves peuvent être infuffifan-
tes , ou manquent en certaines occafions, on fe fert
de tous les moyens propres à éclaircir la vérité , c’eft
pourquoi l’on emploie auffi la preuve par témoins 6c
les preuves muettes , qui font les indices 6c les pré-
fomptions de fait 6c cle droit; on cumule tous ces
differens genres de preuves, lefquelles fe prêtent un
mutuel fecours.
La preuve par écrit peut fuffire toute feule pour
établir un fait.
Il n’en eft pas toujours de meme de la preuve tef-
timoniale : il y a des cas où elle n’eft pas admiffible ,
à moins qu’il n’y ait déjà un commencement de preuve
par écrit.
En général une preuve non écrite n’eft pas admife
en droit contre un écrit.
Il faut néanmoins diftinguer fi c’eft en matière
civile , pu en matière criminelle, 6c fi l’aéle eft inf-
crit de faux ou non.
L ’ufage de la preuve par témoins en matière civile
commença d’être reftraint par l’ordonnance de Moulins,
laquelle, art. 5 4. pour obvier à la multiplication
de faits , dont on demandoit à faire preuve, ordonna
que dorénavant de toutes chofes excédant la fomme
ou valeur de 100 liv. pour une fois payer , il feroit
pafle des contrats devant notaires & témoins, par
lefquels contrat feroit feulement faite & reçue tojite
preuve dans ces matières , fans recevoir aucune
preuve'par témoins , outré le contenu au contrat, ni
fur ce qui feroit allégué avoir été dit ou convenu
avant ice lui, lors & depuis ,,en quoi l’ordonnance
de Moulins déclara qu’elle n’entendoit exclure les
conventions particulières & autres, qui feroient faites
par les parties fous leurs fceau & écritures privées.'
L’ordonnance de 166 7 , tit. 20. des faits qui g iflent
en preuve vocale ou littérale, a explique la difpofition
de celle de Moulins : elle ordonne qu’il fera
pafle afte devant notaires,ou fous fignature privée,de
toutes chofes excédant la fomme ou valeur de 100 1.
même pour dépôt volontaire, & qu’il ne fera reçu
aucune preuve par témoins contre & outre le contenu
aux aries, ni fur ce qui feroit allégué avoir été
dit avant, lors ou depuis les aftes, encore qu’il s’agit
d’iine fomme ou valeur moindre de 100 liv. fans
toutefois rien innover pour ce regard , à ce qui s’ob-
ferve en la juftice des juges & confuls des marchands.
Le roi déclare par l’article fuivant, qu’il n’entend
pas exclure la preuve par témoins pour dépôt
néceffaire en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage
, ni en cas d’accidens imprévus, où on ne pourroit
avoir fait des a ftes, & auffi lorfqu’il y aura un
commencement de preuve par écrit.
Il ajoute qu’il n’entend pas pareillement exclure la
preuve par témoins pour dépôt fait en logeant dans
une hôtellerie entre les mains de l’hôte ou de l’hôtef-
fe , laquelle preuve pourra être ordonnée par le juge,
Y y ij