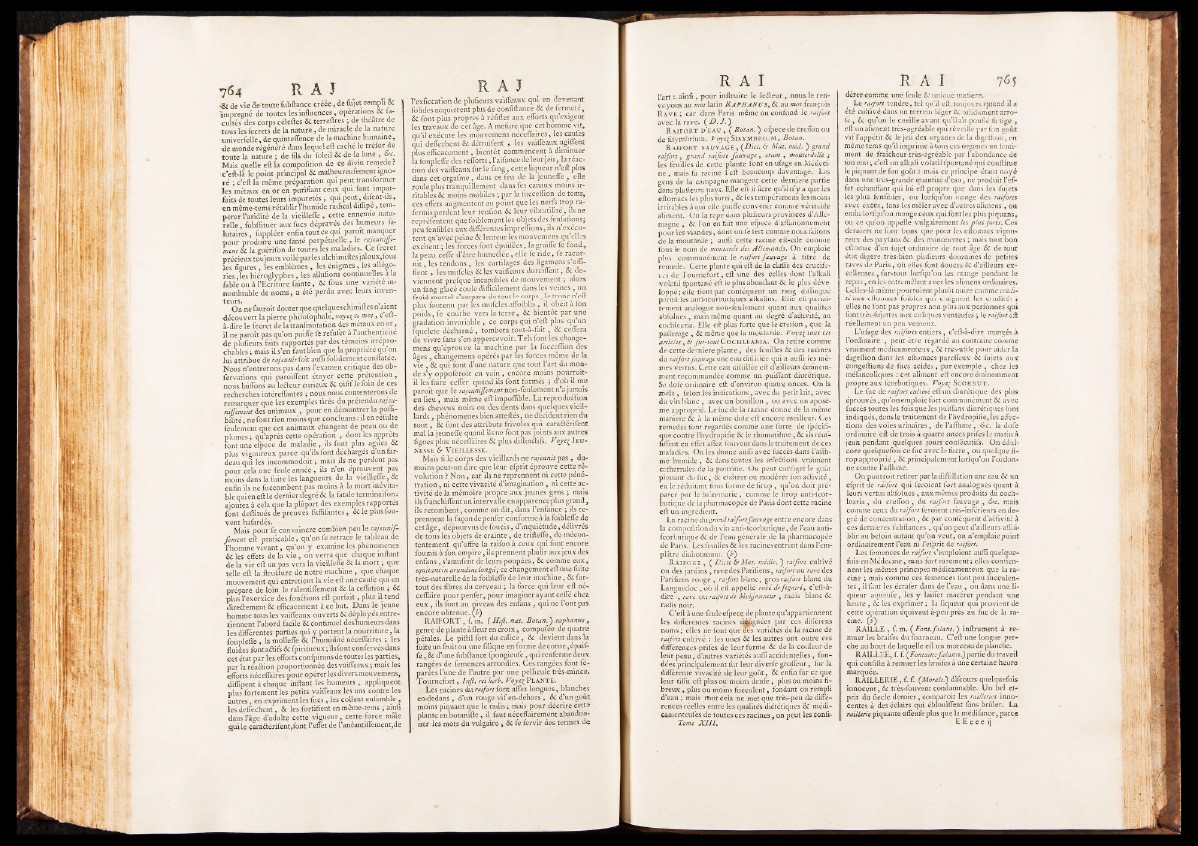
7*54 R A J
de vie aetoüteîubftance créée, de fiïjét rempli & \
imprégné de toutes les influences, opérations & fa- :
cultes des corps céleftes & terreftres ; de theatre de
tous les fecrets de la nature , de miracle de la nature
:univerfelle, de quinteffence de la-machine humaine,
d e monde régénéré dans lequel eft cache le tréfor de
toute la nature ; de fils du foleil & de la lune , &c.
Mais quelle eft la compofition de ce divin remede ?
c’ eft-là le point principal & malheureufement ignoré
; c’eft la même préparation qui peut transformer
les métaux en or en purifiant ceux qui font imparfaits
de toutes leurs impuretés, qui peut, dilent-ils,
en même-tems rétablir l’humide radical diflipe, tempérer
^aridité de la vieillefTe , cette ennemie natu- :
re lie , fubftituer aux fucs dépraves des humeurs la-
lutaires, fuppléer enfin tout ce qui paroît manquer ;
-pour produire une fanté perpétuelle , 1 e ra/eunijje-
ment & la guérifon de toutes les maladies. Ce fecret
précieux toujours voilé par les alchimiftes jdoux,fous
le s figures, les emblèmes , les énigmes, les allégories
, les hiéroglyphes, les allufions 'continuelles à la
fable ou à l’ Ecriture fainte, & fous uhe variété innombrable
de noms, a été perdu avec leurs inventeurs.
. , .
On nefauroit douter que quelques chimiftes n aient
•découvert la pierre philofophale, voye{ ce mot, c eft-
à-dire le fecret de la tranfmutation des métaux en or »
il ne paroît pas qu’on puiffe fe refiifer à Tauthenticite
de plufieurs faits rapportés par des témoins irrepro-
-chables ; mais il s’en faut bien que la propriété qu’on
lui attribue de rajeunir {dit aufli folidement conftatee.
Nous n’entrerons pas dans l’examen critique des observations
qui paroiflent étayer cette prétention,
nous laiffons au lefreur airieux & oifif le foin de ces
recherches intéreffantes ; nous nous contenterons de
remarquer que les exemples tires du prétendu rajeunissement
des animaux , pour en démontrer la çoffi-
bîlité, ne font rien moins que concluans : il en réfulte
feulement que ces animaux changent de peau ou de
plumes ; qu’après cette opération ,, dont les apprêts
font une efpece de maladie, ils font plus agiles &
plus vigoureux parce qu’ils font déchargés d un fardeau
qui les incommodoit ; mais ils ne perdent pas
pour cela une feule année, ils n’ en éprouvent pas
moins dans la fuite les langueurs de la vieillefTe, &
enfin ils ne fuccombent pas moins -à la mort inévitable
qui en eft le dernier degré & la fatale terminaifon :
ajoutez à cela que la plûpart des exemples rapportés
font deftitués de preuves fuflifantes, & le plus fou-
vent hafardés. .
Mais pour fe convaincre combien peu le rajeumj-
fement eft praticable, qu’on fe retrace le tableau de
l’homme v ivan t, qu’on y examine les phénomènes
& les effets de la v i e , on verra que chaque inftant
de la vie eft un pas vers la vieillefTe & la mort ; que
telle eft la ftrufrure de notre machine , que chaque
mouvement qui entretient la vie eft une caufe qui en
prépare de loin le ralentiffement & la ceffation ; &
plus l’ exerxice des fonfrions eft parfait, plus il tend
direfrement & efficacement à ce but. Dans le jeune
homme tous les vaiffeaux ouverts deployes.entre-
tiennent l’abord facile & continuel desnumeurs dans
les différentes parties qui y portent la nourriture, la
foupleflè, la molleffe & l’humidité néceffaires ; les
fluides font afrifs & fpiritueux ; ils font confervés dans
cet état par les efforts confpirans de toutes les parties,
par la reafrion proportionnée des vaiffeaux; mais les
efforts néceffaires pour opérer les divers mouvemens,
diffipent à chaque inftant les humeurs , appliquent,
plus fortement les petits vaiffeaux les uns contre les
autres, en expriment les fucs , les collent enfemble,,
les deffechent, & les fortifient en même-tems ; ainfi
dans l’âge d’adulte cette vigueur, cette force mâle
qui le carafrérifent,font l’ effet de l’aneantiffement,de
R A J
lfoxficcation de plufieurs vaiffeaux qui en devenant
folidesacquièrent plus de confiftanCe & de fermeté,
& font plus propres à réfifter aux efforts qu’exigent
les travaux de cet âge. A mefure que cet homme vit,
qu’il exécute les mouvemens néceffaires, les caufes
qui deffechent & détruifent , les vaiffeaux agiffent
plus efficacement, -bientôt commencent à diminuer
la foupleffe des refforts, Taifance de leur jeu , la réaction
des vaiffeaux fur le fang, cette liqueur n’eft plus
dans cet orgafme , dans ce feu de la jeuneffe , elle
roule plus tranquillement dans fes canaux moins irritables
& moins mobiles ; par la fucceffion de tems,
ces effets augmentent au point que les nerfs trop ra-
fermis perdent leur tenfion & leur vibratilite, ils ne
repréfentent que foiblement les objets des fenfations;
peu fenfibles aux différentes impreffions, ils n’exécutent
qu’avec peine & lenteur les mouvemens qu elles
excitent ; les forces font épUifées , la graiffe fe fond,
la peau ceffe d’être humefrée, elle fe ride, fe racornit
, les tendons;, les cartilages des ligamens s’offi-
fien t, les mufeies & le s vaiffeaux durciffent, & deviennent
prefque incapables de mouvement ; alors
un fang glacé coule difficilement dans les veines , un
froid mortel s’ empare de tout le corps, le tronc n’eft
plus foutenu par les mufcles affoiblis , il obéit à fon
poids, fe coiirbe vers la te rre , & bientôt par une
gradation invariable , ce corps qui n’eft plus qu’un
fquelete décharné , tombera tout-à-faït, & ceffera
de vivre fans s’en appercevoir. Tels font les change-
mens qu’éprouve la machine par la fucceffion des
âges , changemens opérés par les forces même de la
vie , & qui font d’une nature que tout l’art du monde
s’y oppoferoit en v a in , encore moins pourroit-
il les faire ceffer quand ils font formés ; d’où il me
paroît que le rajeuniffenient non-feulement n’a jamais
eu lieu , mais même eft injpoffible. La reprodufrion
des cheveux noirs ou des dents dans quèlques vieillards
, phénomènes bien atteftés, ne décident rien du
to u t, & font des attributs frivoles qui carafrérifent
mal la jeuneffe quand ils ne font pas joints aux autres
figues plus néceffaires & plus diftinfrifs. Voyt{ J eu n
e s s e & V ie i l l e s s e .
Mais fi le corps des vieillards ne rajeunit pas , du-
moins peut-on dirë que leur efprit éprouve cette ré-
j volution ? N on, car ils ne reprennent ni cette pénétration
, ni cette vivacité d’imagination , ni cette activité
de la mémoire propre aux jeunes gens ; mais
ils franchiffentun intervalle enapparenceplus grand,
ils retombent, comme on d it, dans l’enfance ; ils reprennent
la.façondepenfer conforme à la foibleffe de
cet âge, dépourvus de foucis , d’inquiétude, délivrés
de tous les objets de crainte, de tnfteffe, de mécontentement
qu’offre la raifon à ceux qui font encore
fournis à fon empire, ils prennent plaifir aux jeux des
enfans, s’amufent de leurs poupées, & comme eux ,
equitantin arundinelongâ; ce changement eft une fuite
très-naturelle de la foibleffe de leur machine, & fur-
tout des fibres du cerveau ; la force qui leur eft né-
ceffaire pour penfer, pour imaginer ayant ceffé chez
e u x , ils font au niveau des enfans , qui ne l’ont pas
encore obtenue, (b)
RAIFORT , f. m. ( Hiß. nat. Botan.) raphanus ,
genre de plante àfleur en cro ix , compofee de quatre
pétales. Le piftil fort du calice , & devient dans la
fuite un fruit ou une filique en forme de corne, épaif-
fe , & d’une fubftance fpongieufe, qui renferme deux
rangées de femences arrondies. Ces rangées font fé-
parées l’une de l’autre par une pellicule très-mince.
Tournefort, Inß. rei herb. Voye{ P l a n t e .
Lés racines du raifort font affez longues, blanches
en-dedans , d’un rouge v i f en-dehors , & d’un goût
moins piquant que le radis ; mais pour décrire cette
plante en botanifte , il faut néceffairement abandonner
les mots du vulgaire, & fe fervir des termes de
RAI RAI 7^5
l’art :. ainfi, pour inftruire le leûeur, nous le renvoyons
au mqt latin Raphanus , & au mot François
R a v e ; car dans Paris même on confond le raifort
avec là rave. ( D . J . )
R a i f o r t d’ e a u , ( Botan.') efpece de creffon ou
de fifymbrium. RqyqSlSYMBRiujyi, Botan.
R a if o r t s a u v a g e , (Dieu & Mat. méd. ) gtand
raifort, grand raifort fauvage , eram , monterdélit ;
les feuilles de cette plante font en ufage en Médecine
,, mais fa racine l’eft beaucoup davantage. Les
gens de la campagne mangent çette derniere partie
dans plufieurs pays. Elle eft fi âcre qu’il n’y a que les
eftomacs les plus forts, & les tempéramens les moins
irritables à qui elle puiffe convenir comme véritable
aliment. On la râpe dans plufieurs provinces d’Allemagne
, & Ton en fait une efpece d ’afTaiionnement
pour les viandes, dont on 1e lèrt Comme nous faifons
de la moutarde ; âuffi Cette racine eft-eile connue
fous le nom de moutarde des Allemands. On emploie
plus communément le raifort fauvage à titre de
remede. Cette plante qui eft de la chiffe des crucifères
de Tournefort, eft une des celles dont Talkali
volatil lpontané eft le plus abondant & le plus développé;
elle tient par conféquent un rang diftingué
parmi les anti-feorbutiques alkalins. Elle eft parfaitement
analogue non-feulement quant aux qualités
abfolues , mais même quant au degré d’activité, au
cochlearia. Elle eft plus forte que le creffon , que la
pafferage , & même que la moutarde. Voye\ tous ces
articles, & Jur-tout(ioc H LE a r ia . On retire comme
de cette derniere plante, des feuilles & des racines
du raifort fauvage une eau difliilée qui a auffi les mêmes
vertus. Cette eau difliilée eft d’ailleurs éminemment
recommandée comme un puiffant diurétique.
Sa dofe ordinaire eft d’environ quatre onces. On la
mêle , félon les indications, avec du petit lait, avec
du vin blanc , avec un bouillon , ou avec un aposè-
me approprié. Le Tue de la racine donné de la même
maniéré & à la même dole eft encore meilleur. Ces
remedes font regardés comme une forte de fpécifi-
que contre Thydropifie & le rhumatifme, & ils réuf-
fifl'ent en effet aflèz fouvent dans le traitement de ces
maladies. On les donne auffi avec fuccès dans l’afth-
me humide , & dans toutes les affefrions vraiment
cr.tharrales de la poitrine. On peut corriger le goût
piquant du fuc, & châtrer ou modérer fon a ftivité,
en le réduifant fous forme de lîrop , qu’on doit pré-
arer par le bain-marie, comme le ftrop anti-feor-
utique de la pharmacopée de Paris dont cette racine
eft un ingrédient.
La racine du grand raifort fauvage entre encore dans
la comoofition du vin anti-feorbutique, de l’eau anti-
feorbutique & de l’eau générale de la pharmacopée
de Paris. Les feuilles & les racines entrent dans l’emplâtre
diabotanum. (b)
R a i f o r t , ( Dicte & Mat. mèdic. ) raifort cultivé
ou des jardins, rave des Parifiens, raifort ou rave des
Pariiiens rouge , raifort blanc, gros raifort blanc du
Languedoc , oii il eft appellé rabé de fegairé, c’eft-à-
dire , rave ou raifort de Moijjonneur , radis blanc &
radis noir.
C’eft à une feule efpece de plante qu’appartiennent
les différentes racines dgftgnées par ces différens
noms ; elles ne font que oes variétés de la racine de
raifon cultivé : les unes & les autres ont outre ces
différences prifes de leur forme & de la couleur de
leur peau, d’autres variétés auffi accidentelles, fondées
principalement fur leur diverfe groffeur, fur la
différente vivacité de leur goût, & enfin fur ce que
leur tiffu eft plus ou moins denfe , plus ou moins fibreux
, plus ou moins fucculent, fondant ou rempli
d’ eau ; mais tout cela ne met que très-peu de différences
réelles entre les qualités diététiques & médi-
camenteufes de toutes ces racines,, on peut les confi-
Tome X I I I .
dérer comme une feule & unique matière*
Le raifort tendre, tel qu’il eft. toujours quand il a
été cultivé dans un terrein léger & affidument arro*
f é , qu’on le cueille avant qu’il ait pouflé fatige *
eft un aliment très-agréable qui réveille par fon goût
v i f l’appétit & le jeu des organes de la digeftion, en
même tems cp’il imprime à tous ces organes un fenti*
ment de fraîcheur très-agréable par l’abondance dé
fon eau ; c’eft un alkali volatil fpontané qui conftitue
le piquant,de fon goût : mais ce principe étant noyé
dans une très-grande quantité d’eau, ne produit l’effet
échauffant qui lui eft propre que dans les fujets
les plus fenfibles, ou lorfqu’on mange des raiforts
avec excès , fans les mêler avec d’autres alimens , ou
enfin lorfqu’on mange ceux qui font les plus piquans,
ou ce qu’on appelle vulgairement les plus forts. Ces
derniers ne font bons que pour les eftomacs vigou*
reux des payfàns & des manoeuvres ; mais tout bon
eftomac d’ un fujet ordinaire de tout âge & de tout
état digéré très-bien plufieurs douzaines de petites
raves de Paris, oîi elles font douces & d’ailleurs excellente^^
fur-tout lorfqu’on les mange pendant le
repas, en les entremêlant avec les alimens ordinaires*
Celles-là même pourroient plutôt nuire comme ctudU
r« aux, eftomacs foibles qui craignent les crudités ;
elles ne font pas propres non plus aux perfonnes qui
font très-fujettes aux coliques venteufes ; le raifort eft
réellement un peu venteux.
L’ufàge des raiforts entiers, c’ eft-à-dire mangés ,à
l’ordinaire , peut être regardé au contraire comme
vraiment médicamenteux, & très-utile pour aider la
digeftion dans les eftomacs pareffeux & fujets aux
conge fiions de fucs acides, par exemple , chez les
mélancoliques : cet aliment eft encore éminemment
propre aux feorbutiques. Voye^ S c o r b u t .
Le fuc de raifort cultive eft un diurétique des plu9
éprouvés, qu’on emploie fort communément Sc avec
fuccès toutes les fois que les puifl'ans diurétiques font
indiqués, dans le traitement de Thydropifie, les affections
des voies urinaires, de l’afthme, &c. la dôfé
ordinaire eft de trois à quatre onces prifes le matin à
jeun pendant quelques jours confécutits. On édulcore
quelquefois ce fuc avec le lucre, ou quelque fi-*
rop approprié , & principalement lorfqu’on l’ordonne
contre Tafthme.
On pourroitretirer parla diftillation une eau & un
efprit de raifort qui feroiertt fort analogues quant à
leurs vertus abfolues , aux mêmes produits du cochlearia
, du creffon, du raifort fauvage , &c. mais
comme ceux du raifort feroient très-inférieurs en degré
de concentration , & par conféquent d’aclivité à
ces dernieres fubftances , qu’on peut d’ailleurs affoi-
blir au befoin autant qu’on veut, on n’emploie point
ordinairement l’eau ni Tefprit de raifort.
Les femences de raifort s’emploient auffi quelque»
fois en Médecine, mais fort rarement; elles contiennent
les mêmes principes médicamenteux que la racine
; mais comme ces femences font peu fucculen-
tes, il faut les écrâfer dans de l’eau , ou dans une. liqueur
aqueufe, les y laiffer macérer pendant une
heure, & les exprimer ; la liqueur qui provient de
cette opération équivaut à-peu près au fuc de la racine.
(£)
RAILLE , fi m. ( Font.falant. ) infiniment à remuer
les braifes du fourneau. C’eft une longue per*
che au bout de laquelle eft un morceau de planche.
RAILLÉE, f. f. (Fontainefilante.) partie du travail
qui confifte à remuer les braifes à une certaine heure
marquée.
R A IL L E R IE , f. f. (Morale.) difeours quelquefois
innocent, & très-fouvent condamnable. Un bel el-
prit du fiecle dernier, comparoit les railleries innocentes
à des éclairs qui éblouiffent fans brûler. La
raillerie piquante offenfe plus que la médifance, parc©
E E e e e ij