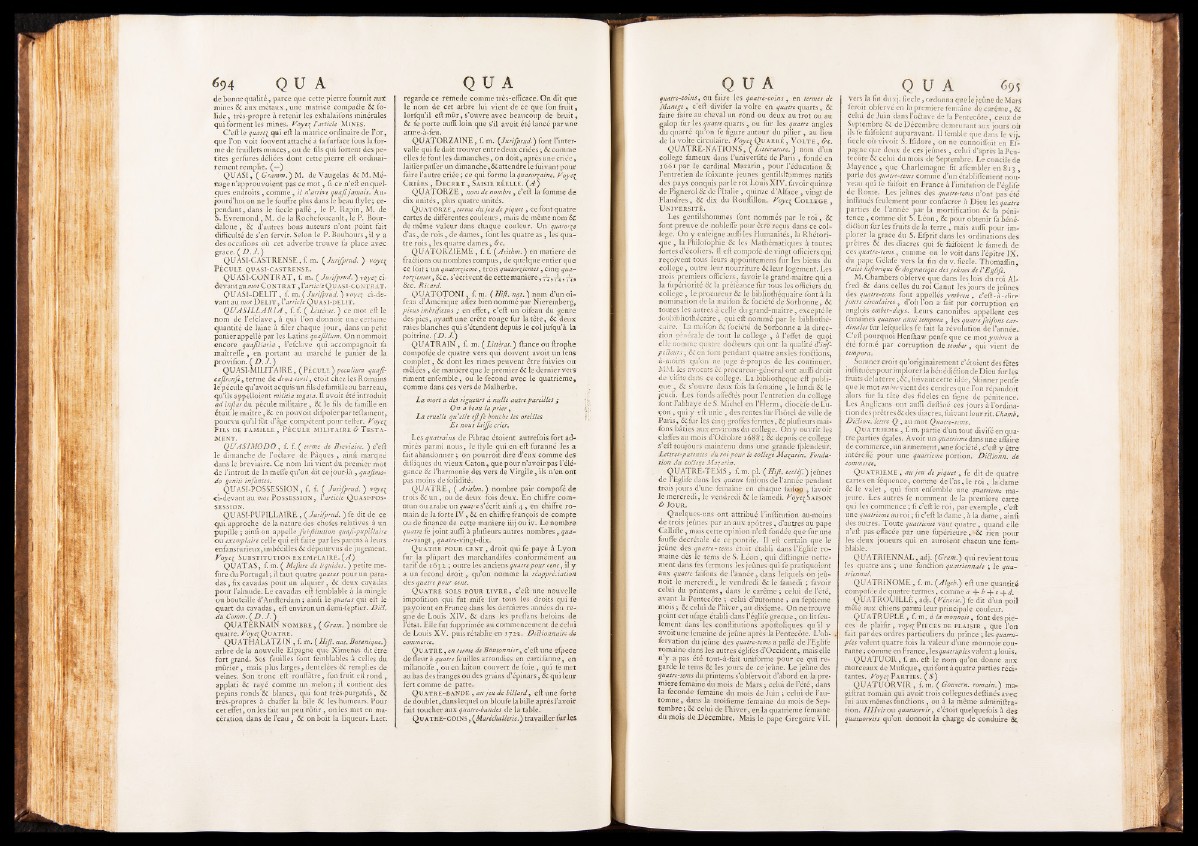
694 Q U A Q U A
de bonne qualité, parce que cette pierre fournit aux
mines & aux métaux, une matrice compa&e & fo-
lide, très-propre à retenir les exhalaifons minérales
qui forment les mines. Voyez!article Mines.
C’eft le quartz qui eft la matrice ordinaire de l’o r,
que l’on voit fouvent attaché à fa furface fous la forme
de feuillets minces , ou de fils qui fortent des per
tites gerfures déliées dont cette pierre eft ordinairement
remplie. (—)
QUASI, (Gram m.)M. deVaugelas & M.Ménage
n’approuvoient pas ce mo t, fi ce n’eft en quelques
endroits, comme, il /*’arrive quajîjamais. Aujourd'hui
on ne le fouffre plus dans le beau ftyle ; cependant,
dans le fiecle paffé, le P. Rapin, M. de
S. Evremond , M. de la Rochefoucault, le P. Bour-
daloue, & d’autres bons auteurs n’ont point fait
difficulté de s’en fervir. Selon le P. Bouhours, il y a
des occafions où cet adverbe trouve fa place avec
grâce. ( D . J . )
Q U ASI-C ASTREN S E , f. m. ( Jurifprud. ) voyez
PÉCULE QUASI-CASTRENSE.
QUASI-CONTR A T , 1. m. ( Jurifprud'.) voyez ci-
devant au mot Contrat , l’article Quasi-contrat.
Q U A S I-D E L IT , f. m. ( Jurifprud. ) voyez ci-de-
vant au mot Délit , l’article Qu asi-delit.
Q U A S IL L A R IA , f. f. ( Littérat. ) ce mot eft le
nom de l’efclave, à qui l’on donnoit une certaine
quantité de laine à filer chaque jour, dans un petit
panier appellé par les Latins quajîUum. On nommoit
encore quajillaria , l’efclave qui accompagnoit fa
maîtreffe , en portant au marché le panier de la
prov ifion. ( D. J . )
QUASI-MILITAIRE, (Pécule’) peculium quaji-
caflrenfe, terme de droit civil, étoit chez les Romains
le pécule qu’avoit acquis un fils de famille au barreau,
qu’ils appelloient militia togata. Il avoit été introduit
ad in far du pécule militaire , & le fils de famille en
étoit le maître, & en pouvoit difpofer par teftament,
pourvu qu’il fût d’âge compétent pour tefter. Voyez
F ils de famille , Pécule militaire & T estament.
Q U A S I MO D O , f. f. ( terme de Bréviaire. ) c’eft
le dimanche de l’o&ave de Pâques , ainfi marqué
dans le bréviaire. Ce nom lui vient du premier mot
de l’introït de la meffe qu’on dit ce jour-là , quaf modo
geniti infantes.
QUASI-POSSESSION, f. f. ( Jurifprud. ) voyez
ci-devant au mot Possession , l’article QuASi-POS-
SESSION.
QUASI-PUPILLAIRE , ( Jurifprud. ) fe dit de ce
qui approche de la nature des choies relatives à un
pupille ; ainfi on appelle fubflitution quafi-pupillaire
ou exemplaire celle qui eft faite par les parens à leurs
cnfansfurieuXjimbécilles & dépourvus de jugement.
Voyez Substitution exemplaire. (A )
QUATAS, f. m. ( Mefure de liquides. ) petite me-
fure du Portugal ; il faut quatre quotas pour un paradas
, fix cavadas pour un alquier, & deux cavadas
pour l’almude. Le cavadas eft femblable à la mingle
pu bouteille d’Amfterdam ; ainfi le quotas qui eft le
quart du cavadas, eft environ un demi-feptier. Dicl.
du Comm. ( D . J . ')
QUATERNAIN nombre , ( Gram. ) nombre de
quatre. Voyez Quatre.
QUATHALATZJN , f. m. ( Hifl. nat. Botanique.)
arbre de la nouvelle Efpagne que Ximenès dit être
fort grand. Ses feuilles fpnt femblables à celles du
mûrier, mais plus larges, dentelées & remplies de
veines. Son tronc eft rouflatre, fon fruit eft rond ,
applati & rayé comme un melon ; il contient des
pépins ronds & blancs, qui font très-purgatifs, 6c
très-propres à chafl’er la bile 6c les humeurs. Pour
cet effet, on les fait un peu rôtir , on les met en macération
dans de l’eau, 6c on boit la liqueur. Laet.
regarde ce remede comme très-efficace. On dit que
le nom de cet arbre lui vient de ce que fon fruit,
lorfqu’il eft mûr, s’ouvre avec beaucoup de bruit,
& fe porte auffi loin que s’il avoit été lancé par une
arme-à-feu.
QUATORZAINE, f. m. (Jurifprud.) font l’ intervalle
qui fe doit trouver entre deux criées ; & comme
elles fe font les dimanches, on doit, après une criée,
laifferpaffer un d imanche,&attendrele fuivant pour
foire l’autre criée ; ce qui forme la quator^aine. Voyez
Criées , Decret , Saisie réelle. (A )
Q U A TO R Z E , nom de nombre, c’eft la fomme de
dix unités, plus quatre unités.
Quatorze , terme du jeu de piquet, ce font quatre
cartes de différentes couleurs, mais de même nom 6c
de même valeur dans chaque couleur. Un quaione
d’a s , de rois, de dames, font les quatre a s , les quatre
ro is, les quatre dames, &c.
Q UATORZIEME, f. f. (Arithm. ) en matière de
fraétions ou nombres rompus, de quelque entier que
ce foit ; un quatorzième, trois quatorzièmes, cinq quatorzièmes
y 6cc, s’écrivent de cette maniéré ,7 7 ,1^ ,
6cc. Ricard.
Q UATOTO NI, f. m. ( Hifl. nat. ) nom d’un o i-
feau d’Amérique affez bien nommé par Nieremberg,
picus imbrifeetus ; en effet, c ’eft un oifeau du genre
des pics, ayant une crête rouge fur la tête, 6c deux
raies blanches qui s’étendent depuis le col jufqu’à la
poitrine. (D . / .)
QU ATRAIN , f. m. ( Littérat. ) ftance ou ftrophe
compofée de quatre vers qui doivent avoit un fens
complet, 6c dont les rimes peuvent être ftiivies ou
mêlées , de maniéré que le premier 6c le dernier vers
riment enfemble, ou le fécond avec le quatrième,
comme dans ces vers de Malherbe.
La mort a des rigueurs d nulle autre pareilles ;
On a beau la prier,
La cruelle qu elle efl fe bouche les oreilles
E t nous laijfe crier.
Les quatrains de Pibrae étoient autrefois fort admirés
parmi nous, le ftylè qui en eft furanné les a
fait abandonner ; on pourroit dire d’eux comme des
difliques du vieux Caton, que pour n’avoir pas l’élégance
6c l’harmonie des vers de V irgile, ils n’en ont
pas moins defolidité.
Q U A T R E , ( Arithm. ) nombre pair compofé de
trois & u n , ou de deux fois deux. En chiffre commun
ou arabe un quatre s’écrit ainfi 4 , en chiffre ro»
main de la forte IV , & en chiffre françois de compte
ou de finance de cette maniéré iiij ou iv. Le nombre
quatre fe joint auffi à plufieurs autres nombres, qua-
tre-vingt, vingt-dix.
Quatre pour c en t , droit qui fe paye à Lyon
fur la plûpart des marchandiles conformément au
tarif de 163 z ; outre les anciens quatre pour cent, il y
a un fécond droit , qu’on nomme la réappréciation
des quatre pour cent.
Quatre sols pour l iv r e , c’ eft une nouvelle
impofition qui fut mife fur tous les droits qui fe
payoient en France dans les dernieres années du re--
gne de Louis XIV . 6c dans les prefians befoins de
l’état. Elle fut fupprimée au commencement de celui
de Louis X V . puis rétablie en 172A. Dictionnaire de
commerce.
Quatre , en terme de Boutonnitr, c’ eft une efpece
de fleur à quatre feuilles arrondies en cartifanne, en
milanoife , ou en laiton couvert de foie , qui fe-met
au bas des franges ou des grains d’épinars, oc qui leur
fert comme de patte.
Quatre-bande , au jeu de billard y eft une forte
de doublet, dans lequel on bloufe la bille après l’avoir
fait toucher aux quatre-bandes de la table.
Qu a t r e -COINS , (Maréchallerie.) travailler fur les
Q U A
qtiatre-coins, ou faire les quatre-coins , en termes de
Manege , c’eft divifer -la volte en quatre quarts, 6c
foire faire au cheval un rond ou deux au trot ou au
galop fur les quatre quarts, ou fur les quatre angles
du quarré qu’on fe figure autour du pilier , au lieu
de la volte circulaire. Voyez Quarré , Volte , &c.
QUATRE-NATIONS, ( Littérature. ) nom d’un
college fameux dans l’univerfité de Paris , fondé en
3661 par le cardinal Mazarin, pour l’éducation &
l’entretien de foixante jeunes gentilshommes natifs
des pays conquis par le roi Louis X IV . favoir quinze
de Pignerol 6c de l’Italie , quinze d’Alface , vingt de
Flandres, 6c dix du Rouflillon. Voyez College ,
Université.
Les gentilshommes font nommés par le r o i , 6c
font preuve de nobleffe pour être reçus dans ce college.
On y enfeigne auffi les Humanités, la Rhétorique
, la Philofophie &c les Mathématiques à toutes
fortes d’écoliers. Il eft compofé de vingt officiers qui
reçoivent tous leurs appointemens fur les biens du
college, outre leur nourriture 6c leur logement. Les
trois premiers officiers, favoir le grand-maître qui a
la fupériorité & la préféance fur tous les officiers du
college, le procureur & le bibliothéquaire font à la
nomination de la maifon 6c fociété de Sorbonne., 6c
toutes les autres à celle du grand-maître, excepté le
foubibliothécaire , qui eft nommé par le bibliothécaire.
La maifon 6c fociété de Sorbonne a la direction
générale de tout le college , à l’effet de quoi
elle nomme quatre do&eurs qui ont la qualité d’inf-
peclturs, 6c en font pendant quatre ans les fondions,
à-moins qu’on ne juge à-propos de les continuer.
MM. les avocats 6c procureur-général ont auffi droit
de vifite dans ce college. La bibliothèque eft publique
, 6c s’ouvre deux fois la femaine , le lundi 6c le
jeudi. Les fonds affedés pour l’entretien du college
font l’abbaye de S. Michel en l’Herm, diocèfe de Lu-
^on , qui y eft unie , des rentes fur l’hôtel de ville de
Paris, & fu r les cinq greffes fermes, 6c plufieurs maifon
s bâties aux environs du college. On y ouvrit les
claflès au mois d’Odobre 1688 ; 6c depuis ce college
s’eft toujours maintenu dans une grande fplendeur.
Lettres-patentes du roi pour le college Mazarin. Fondation
du college Mazarin.
QUATRE-TEMS, f. m. pl. (Hifl. eccléf.) jeûnes
de l’Eglife dans les quatre faifons de l’année pendant
trois jours d’une femaine en chaque foifçgj , favoir
le m ercredi, le vendredi 6c le famedi. VoyezSaison
& Jour.
Quelques-uns ont attribué l’inftitution au-moins
de trois jeûnes par an aux apôtres, d’autres au pape
Callifte , mais cette opinion n’ eft fondée que fur une
fouffe decrétale de ce pontife. Il eft certain que le
jeûne des quatre-tems étoit établi dans l’Eglilë romaine
dès le tems de S. L éo n , qui diftingue nettement
dans fes fermons les jeûnes qui fe pratiquoient
aux quatre faifons de l’année, dans lefquels on jeû-
noit le mercredi, le vendredi 6c le famedi ; favoir
celui du printems, dans le carême ; celui de l’été,
avant la Pentecôte ; celui d’automne , au feptieme
mois ; & celui de l’hiver, au dixième. On ne trouvé
point cet ufoge établi dans l’églife greque, on lit feulement
dans les conftitutions apoftoliques qu’il y
avoit une femaine de jeûne après la Pentecôte. L ’ob- s
fervation du jeûne des quatre-tems a paffé de l’Eglife
romaine dans les autres églifes d’Occident, mais elle
n y a pas été tout-à-fait uniforme pour ce qui regarde
le tems & les jours de ce jeûne. Le jeûne, des
quatre-tems du printems s’obfervoit d’abord en la première
femaine du mois de Mars ; celui de l’été, dans
la fécondé femaine du mois de Juin ; celui de l’automne,
dans la troifieme femaine du mois de Septembre
; & celui de l’h iver, en la quatrième femaine -
du mois de Décembre, Mais le pape Grégoire VII.
Q U A 695
vert la fin duxj. fiecle, ordonna que le jeûne de Mars
feroit obferve en la première femaine de carême, &
celui de Juin dansl’oftave de la Pentecôte, ceux de
Septembre & de Décembre demeurant aux jours où
ils fe faifoient auparavant. Il femble que dans le vij.
fiecle où-vivoit S. Ifidore, on ne connoiffoit en E(-
pagne que deux de ces jeûnes , celui d’après la Pentecôte
& celui du mois de Septembre. Le concile de
Mayence , que Charlemagne fit affembler en 8 13 ,
parle des quatre-tems comme d’un établiffement nouveau
qui fe faifoit en France à l’imitation de l’églife
de Rome. Les jeûnes des quatre-tems n’ont pas été
inftitués feulement pour confacrer à Dieu les quatre
parties de l’année par la mortification & la pénitence
, comme dit S. Léon, & pour obtenir fa bénédiction
fur les fruits de la terre , mais auffi pour implorer
la grâce du S. Efprit dans les ordinations des
prêtres & des diacres qui fe faifoient le famedi de
ces quatre-tems, comme on le voit dans l’épître IX .
du pape Gélafe vers la fin du v . fiecle. Thomaffin,
traite hiflorique 6* dogmatique des jeunes de VEglife,
M. Chambers obferve que dans les lois du roi Alfred
& dans celles du roi Canut les jours de jeûnes
des quatre-tems font appellés ymbren , c’eft-à-dire
jours circulaires , d’où l’on a fait par corruption en
anglois ember-days. Leurs canoniftes appellent ces
femaines quatuor anni tempora , les quatre faifons cardinales
fur lefquelles fe fait la révolution de Tannée*
C’eft pourquoi Henffiaw penfe que ce mot.ymbren a
ete forme par corruption de tember, qui vient d©
tempora^
Somner croit qu’originairement c’étoient des fêtes
inftituéespourimplorer la bénédiction de Dieu fur les
fruits delaterre ; & , fuivant cette idée, Skinner penfe
que le mot ember vient des cendres que Ton répandoit
alors fur la tête des fideles en ligne de pénitence.
Les Anglicans ont auffi deftiné ces jours à l’ordination
des prêtres & des diacres, fuivant leur rit. Chamb.
Diction, lettre Q , au mot Quatre-tems.
Quatrième , f. m. partie d’un tout divifé en quatre
parties égales. Avoir un quatrième dans une affaire
de commerce, un armement, une fociété, c’eft y être
intéreffé pour une quatrième portion. Diclionn. de
commerce.
Quatrième , au jeu de piquet, fe dit de quatre
cartes en féquence, comme de l’a s , le r o i , la.dame
& le v a le t , qui font enfemble une quatrième majeure.
Les autres fe nomment de la première carte
qui les commence ; fi c’eft le roi, par exemple, c’eft
une quatrième au roi ; fi c’eft la dame, à la dame, ainfi
des autres. Toute quatrième vaut quatre , quand elle
n’eft pas effacée par une fupérieure, & rien pour
les deux joueurs qui en auroient chacun une femblable.
QUATRIENNAL, adj. (Gram.) qui revient tous
les quatre ans ; une fon&ion quatriennale ; le qua-
triennal.
QUATRINOME, f. m. (Algeb.) eft une quantité
compofée de quatre termes, comme a + b 4- c -j- d.
QU ATROUILLÉ, adj. (Vénerie.) fe dit d’un poil
mêlé aux chiens parmi leur principale couleur.
QUATRUPLE , f. m. à la monnaie, font des pièces
de plaifir, voyez Pièces de plaisir , que Ton
fait par des ordres particuliers du prince ; les quatru-
ples valent quatre fois la Valeur d’une monnoie courante;
comme en France, lesquatruples valent 4 louis.
Q U A TUO R , f. m. eft le nom qu’on donne aux
morceaux de Mufique, qui font à quatre parties récitantes.
Voyez Parties. ( S )
QUATUORVIR , f. m. (Gouvern. romain.) ma»
giftrat romain qui avoit trois collègues deftinés avec
lui aux mêmes fondions , ou à la même adminiftra-
tion. I lI Iv ir ou quatuorvir, c’étoit quelquefois à des
quatuorvirs qu’on donnoit la charge de conduire &.