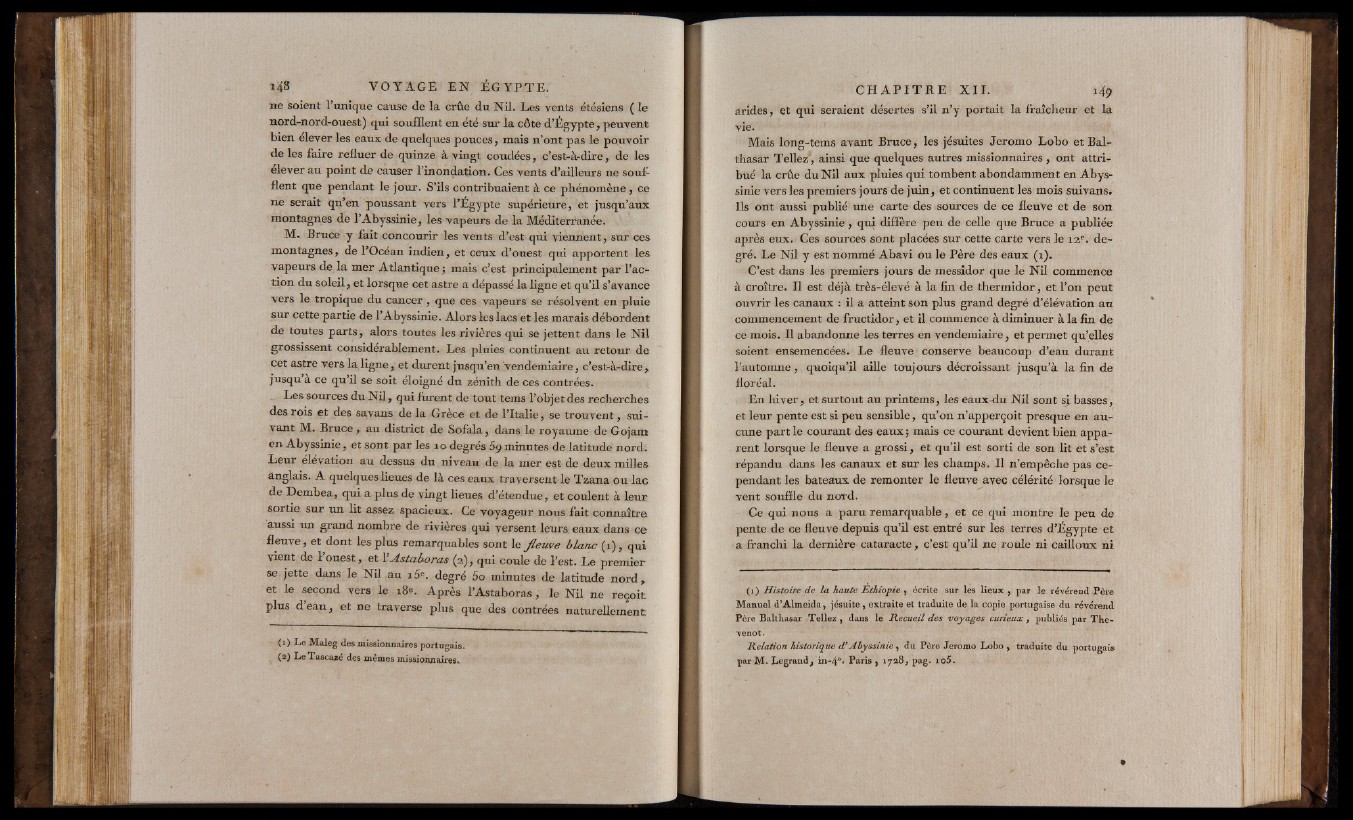
ne soient l ’unique cause de la crûe du Nil. Les vents étésiens ( le
nord-nord-ouest) qui soufflent en été sur la côte d’E gypte, peuvent
bien élever les eaux de quelques pouces, mais n’ont pas le pouvoir
de les faire refluer de quinze à vingt coudées, c’est-à-dire, de les
élever au point de causer l ’inondation. Ces vents d’ailleurs ne soufflent
que pendant le jour. S’ils contribuaient à ce phénomène , ce
ne serait qu’en poussant vers l ’Egypte supérieure, et jusqu’aux
montagnes de l ’Abyssinie, les vapeurs de la Méditerranée.
M. Bruce y fait concourir les vents d’est qui viennent, sur ces
montagnes, de l ’Ocean indien, et ceux d’ouest qui apportent les
vapeurs de la mer Atlantique ; mais c’est principalement par l ’action
du soleil, et lorsque cet astre a dépassé la ligne et qu’il s’avance
vers le tropique du cancer, que ces vapeurs se résolvent en pluie
sur cette partie de l ’Abyssinie. Alors les lacs et les marais débordent
de toutes parts, alors toutes les rivières qui se jettent dans le Nil
grossissent considérablement. Les pluies continuent au retour de
cet astre vers la ligne, et durent jusqu’en vendémiaire, c ’est-à-dire ,
jusqu à ce qu’il se soit éloigné du zénith de ces contrées.
Les sources du N il, qui furent de tout tems l’objet des recherches
des rois et des savans de la Grèce et de l’Italie, se trouvent, suivant
M. Bruce , au district de Sofala, dans le royaume de Gojam
en Abyssinie, et sont par les 10 degrés 5p minutes de latitude nord.
Leur élévation au dessus du niveau de l a mer est de deux milles
anglais. A quelques lieues de là ces eaux traversent le Tzana ou lac
de Dembea, qui a plus de vingt lieues d’étendue, et coulent à leur
sortie sur un lit assez spacieux. Ce voyageur nous fait connaître
aussi un grand nombre de rivières qui versent leurs eaux dans ce
fleuve, et dont les plus remarquables sont le fleuve blanc (1 ), qui
vient de 1 ouest, et 1'Astaboras (a), qui coule de l ’est. Le premier
se jette dans le Nil au i 5e. degré 5o minutes de latitude n o rd ,
et le second vers le i8<>. Après l ’Astaboras, le Nil ne reçoit
plus d’eau , et ne traverse plus que des contrées naturellement
( i ) L e Maleg des m issionnaires portugais,
(a) L e Tascaaé des mêmes m issionnaires.
arides, et qui seraient désertes s’il n’y portait la fraîcheur et la
Yie.
Mais long-tems avant Bruce, les jésuites Jeromo Lobo et Bal-
thasar Teflez', ainsi que quelques autres missionnaires , ont attribué
la crûe du Nil aux pluies qui tombent abondamment en Abyssinie
vers les premiers jours de juin, et continuent les mois suivans.
Ils ont aussi publié une carte des sources de ce fleuve et de son
cours en Abyssinie, qui diffère peu de celle que Bruce a publiée
après eux. Ces sources sont placées sur cette carte vers le 12e. degré.
Le Nil y est nommé Abavi ou le Père des eaux (1).
C’est dans les premiers jours de messidor que le Nil commence
à croître. Il est déjà très-élevé à la fin de thermidor, et l’on peut
ouvrir les canaux : il a atteint son plus grand degré d’élévation au
commencement de fructidor, et il commence à diminuer à la fin de
ce mois. Il abandonne les terres en vendémiaire, et permet qu’elles
soient ensemencées. Le fleuve conserve beaucoup d’eau durant
l ’automne, quoiqu’il aille toujours décroissant jusqu’à la fin de
floréal.
En h ive r , et surtout au printems, les eaux -du Nil sont sj basses,
et leur pente est si peu sensible, qu’on n’apperçoit presque en aucune
part le courant des eaux •, mais ce courant devient bien apparent
lorsque le fleuve a grossi, et qu’il est sorti de son lit et s’est
répandu dans les canaux et sur les champs. Il n’empêche pas cependant
les bateaux de remonter le fleuve avec célérité lorsque le
vent souffle du nord.
Ce qui nous a paru remarquable, et ce qui montre le peu de
pente de ce fleuve depuis qu’il est entré sur les terres d’Egypte et
a franchi la dernière cataracte, c’est qu’il ne roule ni cailloux ni
( j) Histoire de la haute Ethiopie , écrite sur les lieux , par le révérend Père
Manuel d’Almeida, jésuite , extraite et traduite de la copie portugaise du révérend
Père Balthasar Tellez , dans le Recueil des voyages curieux , publiés par The-
venot.
Relation historique d*Abyssinie, du Père Jeromo L o b o , traduite du portugais
par M . Legrand, in-4“ . P a r is , 1728, pag. io 5 .