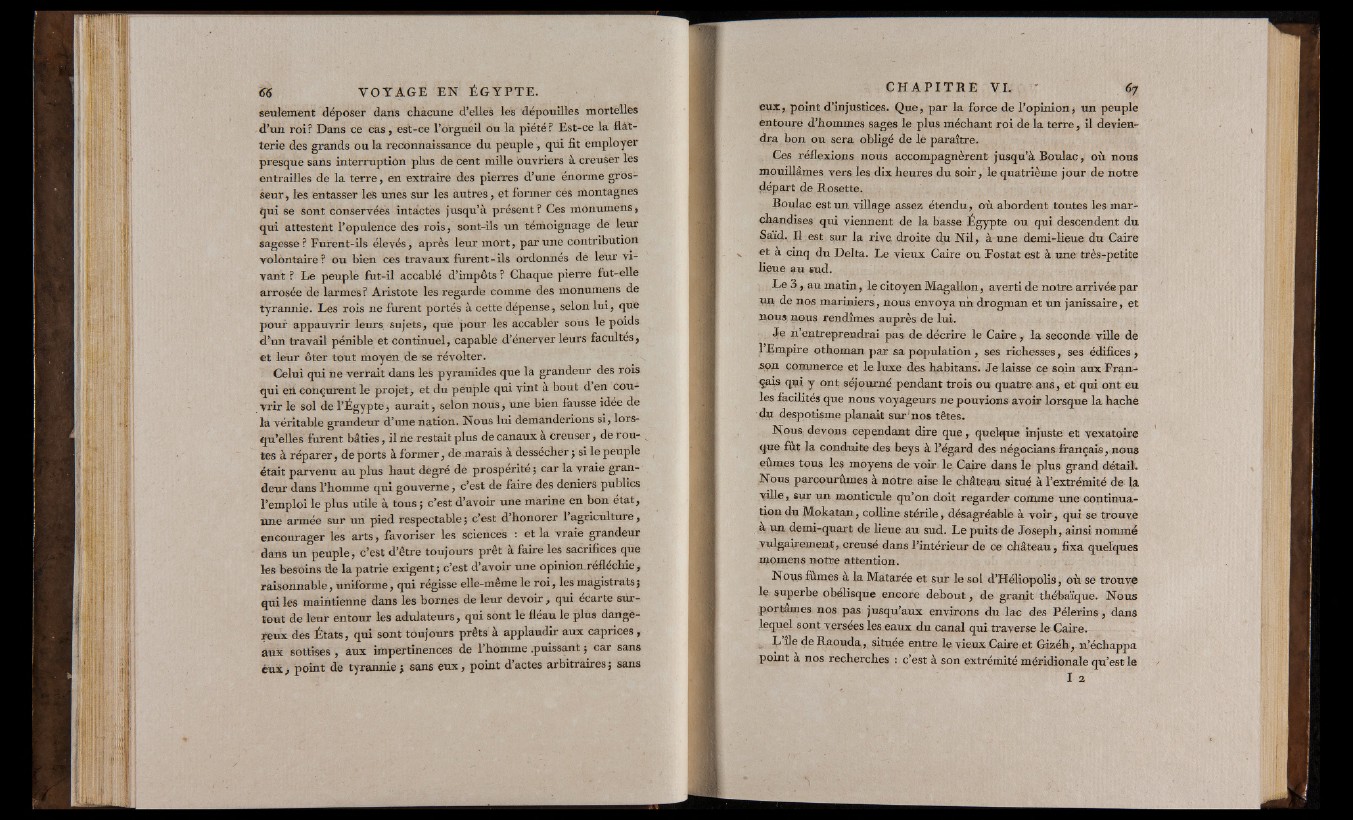
seulement déposer dans chacune d’elles les dépouilles mortelles
d’un roi? Dans ce c a s , est-ce l ’orgueil ou la piété? Est-ce la flàt-
terie des grands ou la reconnaissance du peuple , qui fit employer
presque sans interruption plus de cent mille ouvriers à creuser lès
entrailles de la terre, en extraire des pierres d’une énorme grosseur,
les entasser les unes sur les autres, et former cés montagnes
qui se sont conservées intactes jusqu’à présent ? Ces monumens,
qui attestent l’opulence des rois, sont-ils un témoignage de leur
sagesse ? Furent-ils élevés, après leur mort, par une contribution
volontaire ? ou bien ces travaux furent - ils ordonnés dé leur v ivant
? Le peuple fut-il accablé d’impôts ? Chaque pierre fut-elle
arrosée de larmes ? Aristote les regarde comme des monumens de
tyrannie. Les rois ne furent portés à cette dépense, selon lu i, què
pour appauvrir leurs, sujets, que pour les accabler sous le poids
d ’un travail pénible et continuel, capable d’énerver leurs facultés,
et leur ôter tout moyen de se révolter.
Celui qui ne verrait dans les pyramides que la grandeur des rois
q u i en conçurent le projet, et du peuple qui vint à bout d en couvrir
le sol de l’É gypte, aurait, selon nous, une bien fausse idee de
la véritable grandeur d’une nation. Nous lui demanderions si, lorsqu’elles
furent bâties, il ne restait plus de canaux à creuser, de routes
à réparer, de ports à former, de marais à dessécher ; si le peuple
¿tait parvenu au plus haut degré de prospérité ; car la vraie grandeur
dans l’homme qui gouverne, c’est de faire des deniers publics
l’ emploi le plus utile à tous ; c ’est d’avoir une marine en bon état,
une armée sur un pied respectable ; c’est d’honorer l’agriculture,
encourager les arts , favoriser les sciences : et la vraie grandeur
dan« un peuple, c ’est d’être toujours prêt à fairé les sacrifices que
les besoins de la patrie exigent; c’est d’avoir une opinion.réfléchie,
raisonnable, uniforme, qui régisse elle-même le ro i, les magistrats;
qui les maintienne dans les bornes de leur devoir , qui ecarte surtout
de leur entour les adulateurs, qui sont le fléau le plus dangereux
des États, qui sont toujours prêts à applaudir aux caprices ,
aux sottises , aux impertinences de l ’homme .puissant ; car sans
eux / point de tyrannie ; sans eu x , point d’actes arbitraires ; sans
eu x , point d’injustices. Que, par la force de l ’opinion; un peuple
entoure d’hommes sages le plus méchant roi de la terre, il deviendra
bon ou sera obligé de lè paraître.
Ces réflexions nous accompagnèrent jusqu’à Boulac, où nous
mouillâmes vers les dix heures du soir, le quatrième jour de notre
départ de Rosette.
Boulac est un village assez étendu, où. abordent toutes les marchandises
qui viennent de la basse Égypte ou qui descendent du
Saïd, II .est sur la rive droite du N il, à-une demi-lieue, du Caire
et à cinq du Delta. Le vieux Caire ou Fostat est à une très-petite
lieue au sud.
Le 3 , au matin, le citoyen MagaMon, averti de notre arrivée par
de nos mariniers., nous envoya un drogman et un janissaire, et
nous nous rendîmes auprès de lui.
Je n ’entreprendrai pas de décrire le Caire., la seconde ville de
1 Empire othoman par sa population , ses richesses, ses édifices ,
spn commerce et le luxe des habitans. Je laisse ce soin aux Fran-
Çais qui y ont séjourné pendant trois ou quatre ans, et qui ont eu
les facilités que nous voyageurs ne pouvions avoir lorsque la hache
du despotisme planait sur'nos têtes.
Nous devons cependant dire que, quelque injuste et vexatoire
que fut la conduite des beys à Fégard des négocians français, nous
eûmes tous les moyens de voir le Caire dans le plus grand détail.
.Nous parcourûmes à notre aise le château- situé à l ’extrémité de la
ville, sur un monticule qu’on doit regarder comme une continuation
du M okatan, colline stérile, désagréable à v o ir , qui se trouve
à. un demi-quart de lieue au sud. L e puits de Joseph, ainsi nommé
vulgairement, creusé dans l’intérieur de ce château, fixa quelques
momens notre attention.
Nous fûmes à la Matarée et sur le sol d’Béliopolis, où se trouve
lç superbe obélisque encore deb out, de granit thébaïque. Nous
portâmes nos pas jusqu’aux environs du lac des Pèlerins, dans
lequel sont versées les eaux du canal qui traverse le Caire,
g fi île de R aouda, située entre le vieux Caire et Gizéh, n’échappa
point à nos recherches : c’est à son extrémité méridionale qu’est le
I a