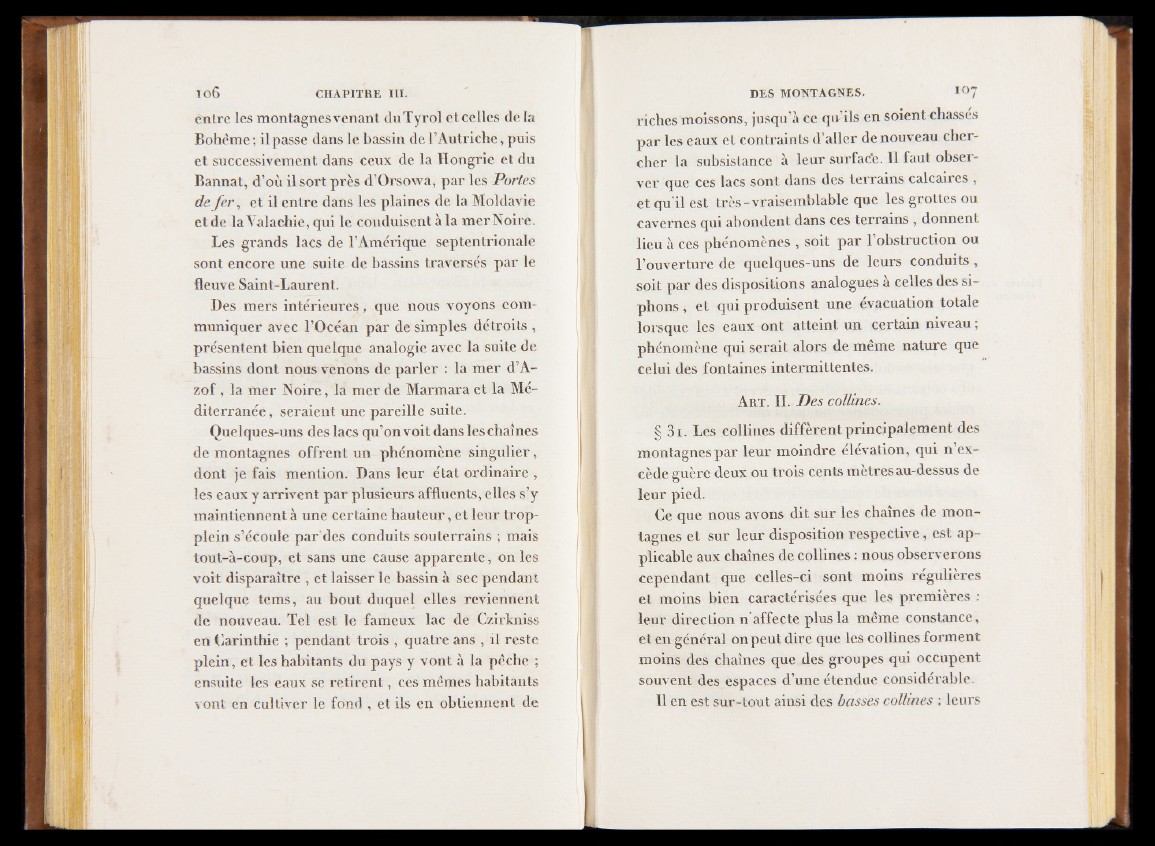
èntre les montagnes venant cluTyrol et celles delà
Bohême ; il passe dans le bassin de l’Autriche, puis
et successivement dans ceux de la Hongrie et du
Bannat, d’où il sort près d’Orsowa, par les Portes
de f e r , et il entre dans les plaines de la Moldavie
et de la Yalaehie, qui le conduisent à la merNoire.
Les grands lacs de l’Amérique septentrionale
sont encore une suite de bassins traversés par le
fleuve Saint-Laurent.
Des mers intérieures, que nous voyons communiquer
avec l ’Océan par de simples détroits ,
présentent bien quelque analogie avec la suite de
bassins dont nous venons de parler : la mer d’A-
z o f , la mer Noire, la mer de Marmara et la Méditerranée,
seraient une pareille suite.
Quelques-uns des lacs qu’on voit dans les chaînes
de montagnes offrent un phénomène singulier,
dont je fais mention. Dans leur état ordinaire ,
les eaux y arrivent par plusieurs affluents, elles s’y
maintiennent à une certaine hauteur, et leur trop-
plein s’écoule par des conduits souterrains ; mais
tout-à-coup, et sans une cause apparente, on les
voit disparaître , et laisser le bassin à sec pendant
quelque tems, au bout duquel elles reviennent
de nouveau. Tel est le fameux lac de Czirkniss
en Carinthie ; pendant trois , quatre ans , il reste
plein, et les habitants du pays y vont à la pêche ;
ensuite les eaux se retirent, ces mêmes habitants
vont en cultiver le fond , et ils en obtiennent de
riches moissons, jusqu’à ce qu’ils en soient chassés
par les eaux et contraints d’aller de nouveau chercher
la subsistance à leur surfac’e. Il faut observer
que ces lacs sont dans des terrains calcaires ,
et qu’il est très-vraisemblable que les grottes ou
cavernes qui abondent dans ces terrains , donnent
lieu à ces phénomènes , soit par l ’obstruction ou
l ’ouverture de quelques-uns de leurs conduits ,
soit par des dispositions analogues à celles des siphons
, et qui produisent une évacuation totale
lorsque les eaux ont atteint un certain niveau ;
phénomène qui serait alors de même nature que
celui des fontaines intermittentes.
Ar t . II. Des collines.
§ 31. Les collines diffèrent principalement des
montagnes par leur moindre élévation, qui n’excède
guère deux ou trois cents mètres au-dessus de
leur pied.
Ce que nous avons dit sur les chaînes de montagnes
et sur leur disposition respective, est applicable
aux chaînes de collines : nous observerons
cependant que celles-ci sont moins régulières
et moins bien caractérisées que les premières :
leur direction n'affecte plus la même constance,
et en général on peut dire que les collines forment
moins des chaînes que des groupes qui occupent
souvent des espaces d’une étendue considérable.
Il en est sur-tout ainsi des basses collines ; leurs