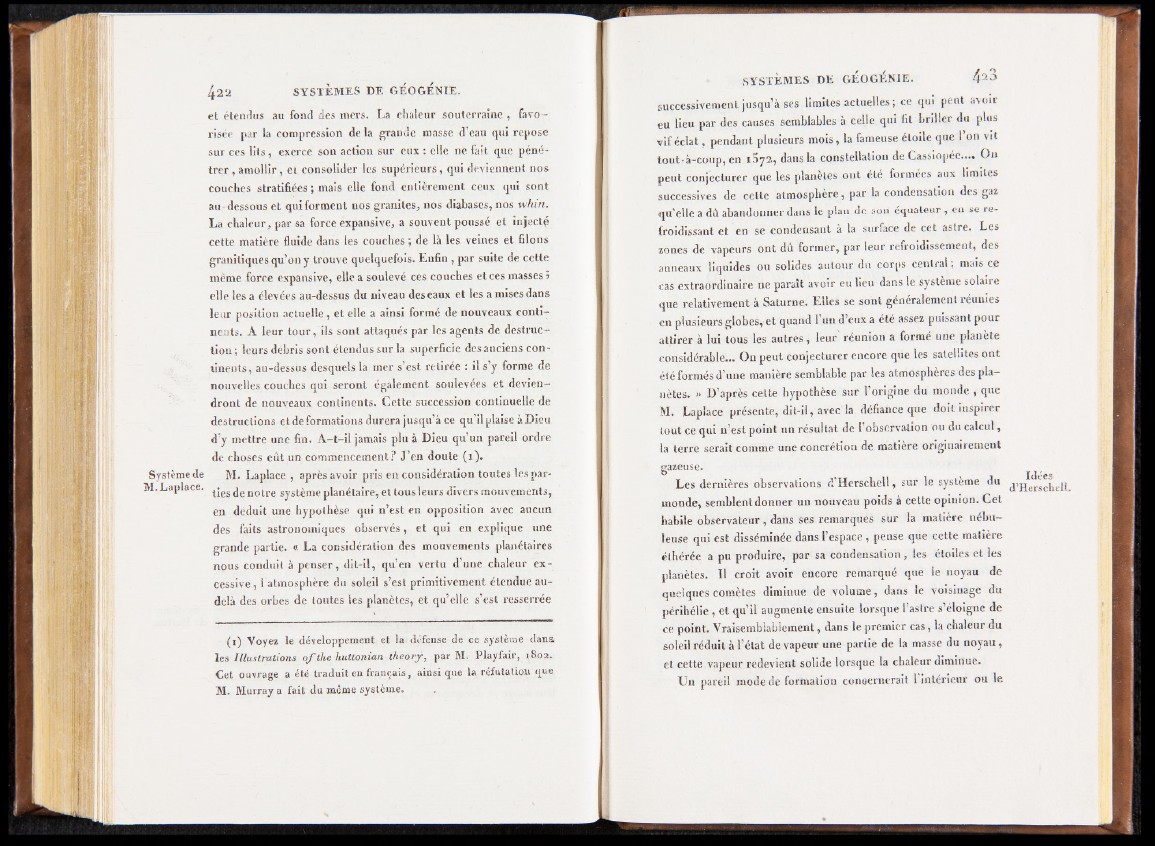
Système de
M. Laplace.
et étendus au fond des mers. La chaleur souterraine , favorisée
par ia compression de la grande niasse d’eau qui repose
sur ces lits, exerce son action sur eux : elle ne fait que pénétrer
, amollir, et consolider les supérieurs, qui deviennent nos
couches stratifiées ; mais elle fond entièrement ceux qui sont
au dessous et qui forment nos granités, nos diabases, nos «Ain.
La chaleur, par sa force expansive, a souvent poussé et injecté
cette matière fluide dans les couches ; de là les veines et filons
granitiques qu’on y trouve quelquefois. Enfin , par suite de cette
même force expansive, elle a soulevé ces couches et ces masses »
elle les a élevées au-dessus du niveau des eaux et les a mises dans
leur position actuelle, et elle a ainsi formé de nouveaux continents.
A leur tour, ils sont attaqués par les agents de destruction;
leurs débris sont étendus sur la superficie des anciens continents,
au-dessus desquels la mer s’ est retirée : il s’y forme de
nouvelles couches qui seront également soulevées et deviendront
de nouveaux continents. Cette succession continuelle de
destructions et de formations durera jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu
d’y mettre une fin. A - t- il jamais plu à Dieu qu’un pareil ordre
de choses eût un commencement? J’en doute (1).
M. Laplace , après avoir pris en considération toutes les parties
de notre système planétaire, et tous leurs divers mouvements,
en déduit une hypothèse qui n’est en opposition avec aucun
des faits astronomiques observés, et qui en explique une
grande partie. « La considération des mouvements planétaires
nous conduit à penser, dit-il, qu’ en vertu d’une chaleur e x cessive,
1 atmosphère du soleil s’est primitivement étendue au-
delà des orbes de toutes les planètes, et qu’elle s’est resserrée
(1) Voyez le développement et la défense de ce système dans,
les Illustrations o f the hutlonian theory, par M. Playfair, 1802.
Cet ouvrage a été traduit en français, ainsique la réfutation que
M. Murray a fait du même système.
successivement jusqu’à ses limites actuelles ; ce qui peut avoir
eu lieu par des causes semblables à celle qui fit briller du plus
Vif éclat, pendant plusieurs mois, la fameuse étoile que l’on vit
tout-à-coup, en i 5y2, dans la constellation de Cassiopée.... On
peut conjecturer que les planètes ont été formées aux limites
successives de cette atmosphère, par la condensation des gaz
qu’elle a dû abandonner dans le plan de son équateur , en se refroidissant
et en se condensant à la surface de cet astre. Les
zones de vapeurs ont dû former, par leur refroidissement, des
anneaux liquides ou solides autour du corps central ; mais ce
cas extraordinaire ne paraît avoir eu heu dans le système solaire
que relativement à Saturne. Elles se sont généralement réunies
en plusieurs globes, et quand l’un d’eux a été assez puissant pour
attirer à lui tous les autres, leur réunion a formé une planète
considérable... On peut conjecturer encore que les satellites ont
été formés d’une manière semblable par les atmosphères des planètes.
» D’après cette hypothèse sur l’origine du monde , que
M. Laplace présente, dit-il, avec la défiance que doit inspirer
tout ce qui n’est point un résultat de l’observation ou du calcul,
la terre serait comme une concrétion de matière originairement
gazeuse.
Les dernières observations d’Herschell, sur le système du
monde, semblent donner un nouveau poids à cette opinion. Cet
habile observateur, dans ses remarques sur la matière nébuleuse
qui est disséminée dans l’espace , pense que cette matière
éthérée a pu produire, par sa condensation, les étoiles et les
planètes. Il croit avoir encore remarqué que le noyau de
quelques comètes diminue de volume, dans le voisinage du
périhélie , et qu’ il augmente ensuite lorsque l’astre s’éloigne de
ce point. Vraisemblablement, dans le premier cas, la chaleur du
soleil réduit à l’état de vapeur une partie de la masse du noyau,
et cette vapeur redevient solide lorsque la chaleur diminue.
Un pareil mode de formation conaernerait 1 intérieur ou le
■
L
Idées
d’Herschell