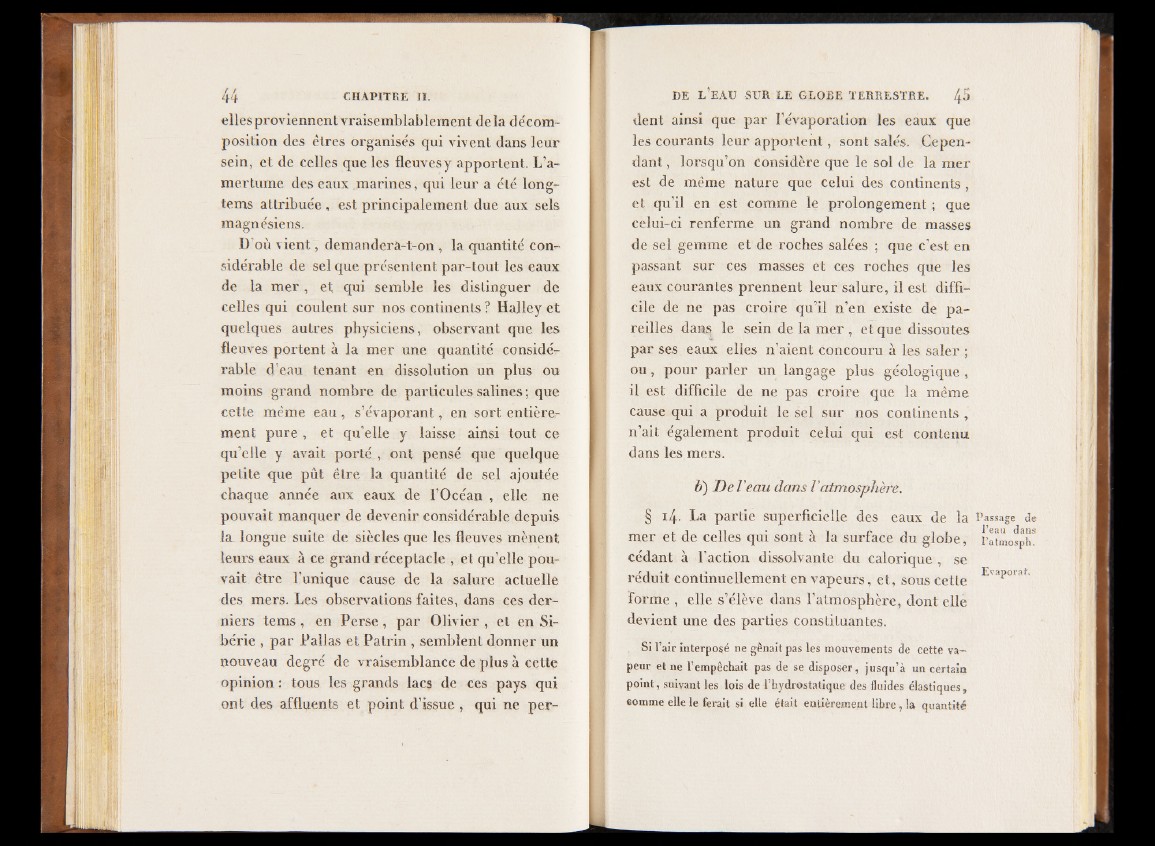
elles proviennent vraisemblablement delà décomposition
des êtres organisés qui vivent dans leur
sein, et de celles que les fleuvesy apportent. L’amertume
des eaux marines, qui leur a été long-
tems attribuée , est principalement due aux sels
magnésiens.
D’où vient, demanderà^-t-on , la quantité considérable
de sel que présentent par-tout les eaux
de la mer , et qui semble les distinguer de
celles qui coulent sur nos continents ? Halley et
quelques autres physiciens, observant que les
fleuves portent à la mer une quantité considérable
d’eau tenant en dissolution un plus ou
moins grand nombre de particules salines ; que
cette même eau , s’évaporant, en sort entièrement
pure , et qu’elle y laisse ainsi tout ce
qu’elle y avait porté , ont pensé que quelque
petite que pût être la quantité de sel ajoutée
chaque année aux eaux de l’Océan , elle ne
pouvait manquer de devenir considérable depuis
la longue suite de siècles que les fleuves mènent
leurs eaux à ce grand réceptacle , et qu’elle pouvait
être l’unique cause de la salure actuelle
des mers. Les observations faites, dans ces derniers
tems, en Perse, par Olivier , et en Sibérie
, par Pallas et Patrin , semblent donner un
nouveau degré de vraisemblance de plus à cette
opinion : tous les grands lacs de ces pays qui
ont des affluents et point d’issue , qui ne perdent
ainsi que par l’évaporation les eaux que
les courants leur apportent, sont salés. Cependant
, lorsqu’on Considère que le sol de la mer
est de même nature que celui des continents ,
et qu’il en est comme le prolongement ; que
celui-ci renferme un grand nombre de masses
de sel gemme et de roches salées ; que c’est en
passant sur ces masses et ces roches que les
eaux courantes prennent leur salure, il est difficile
de ne pas croire qu’il n’en existe de pareilles
dans le sein de la mer , et que dissoutes
par ses eaux elles n’aient concouru à les saler ;
ou , pour parler un langage plus géologique ,
il est difficile de ne pas croire que la même
cause qui a produit le sel sur nos continents ,
n’ait également produit celui qui est contenu
dans les mers.
b) D e l eau dans l ’atmosphère.
§ 14. La partie superficielle des eaux de la
mer et de celles qui sont à la surface du globe,
cédant à l ’action dissolvante du calorique , se
réduit continuellement en vapeurs, et, sous cette
forme , elle s’élève dans l’atmosphère, dont elle
devient une des parties constituantes.
Si l’air interposé ne gênait pas les mouvements de cette vapeur
et ne l’empêchait pas de se disposer, jusqu’à un certain
point, suivant les lois de l’hydrostatique des fluides élastiques,
somme elle le ferait si elle était entièrement libre, la quantité
Passage de
l’eau dans
l’atmosph.
Evaporat.