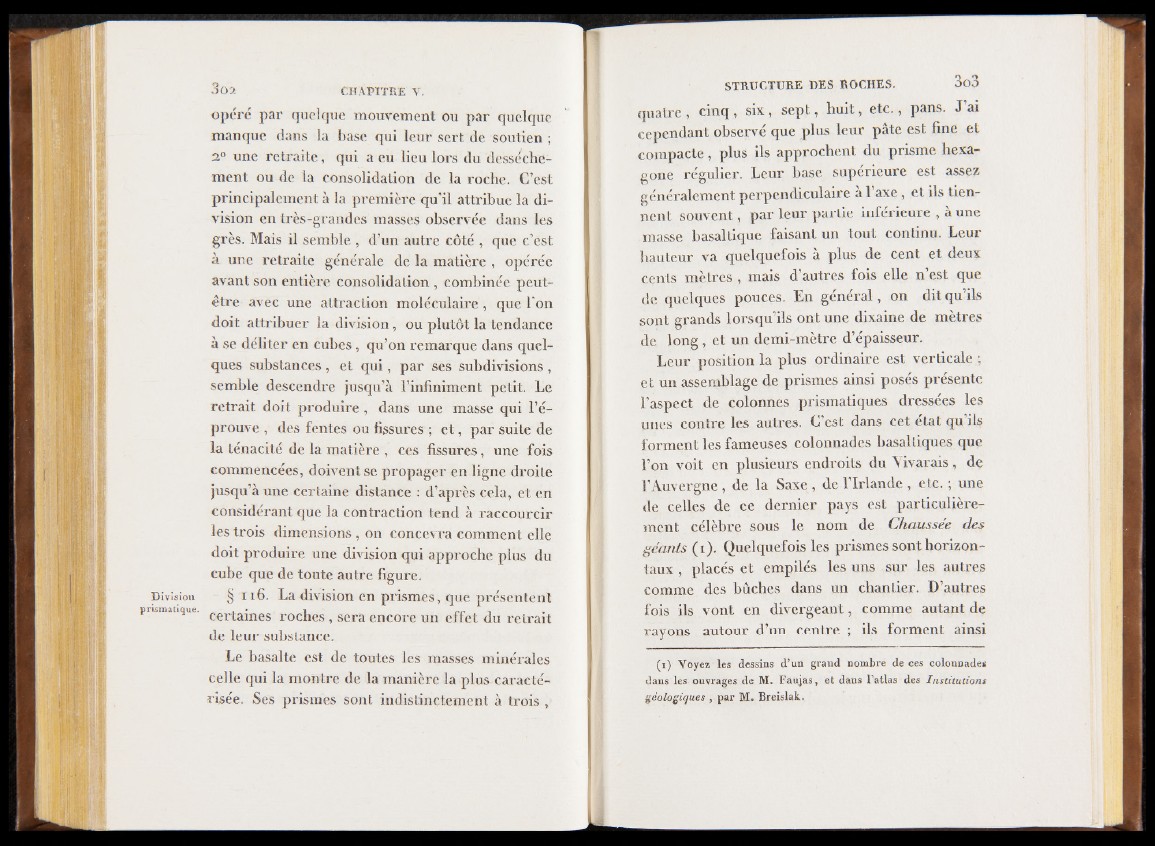
H H Ü k
l l l l l i l f
Division
prismatique.
opéré par quelque mouvement ou par quelque
manque dans la base qui leur sert de soutien ;
2° une retraite, qui a eu lieu lors du dessèchement
ou de la consolidation de la roche. C’est
principalement à la première qu'il attribue la division
en très-grandes masses observée dans les
grès. Mais il semble , d’un autre côté , que c’est
à une retraite générale de la matière , opérée
avant son entière consolidation , combinée peut-
être avec une attraction moléculaire, que l'on
doit attribuer la division, ou plutôt la tendance
à se déliter en cubes, qu’on remarque dans quelques
substances , et qu i, par ses subdivisions ,
semble descendre jusqu’à l ’infiniment petit. Le
retrait doit produire , dans une masse qui l ’éprouve
, des fentes ou fissures ; e t , par suite de
la ténacité de la matière , ces fissures, une fois
commencées, doivent se propager en ligne droite
jusqu’à une certaine distance : d’après cela, et en
considérant que la contraction tend à raccourcir
les trois dimensions , on concevra comment elle
doit produire une division qui approche plus du
cube que de toute autre figure.
§ 1 16. La division en prismes, que présentent
certaines roches , sera encore un effet du retrait
de leur substance.
Le basalte est de toutes les masses minérales
celle qui la montre de la manière la plus caractérisée.
Ses prismes sont indistinctement à trois ,
quatre , cinq , s ix , sept, huit, etc., pans. J’ai
cependant observé que plus leur pâte est fine et
compacte, plus ils approchent du prisme hexagone
régulier. Leur base supérieure est assez
généralement perpendiculaire a 1 axe, et ils tiennent
souvent, par leur partie inférieure , a une
masse basaltique faisant un tout continu. Leur
hauteur va quelquefois à plus de cent et deux
cents mètres , mais d’autres fois elle n’est que
de quelques pouces. En général, on dit qu’ils
sont grands lorsqu’ils ont une dixaine de mètres
de long , et un demi-mètre d’épaisseur.
Leur position la plus ordinaire est verticale ;
et un assemblage de prismes ainsi posés présente
l ’aspect de colonnes prismatiques dressées les
unes contre les autres. C’est dans cet état qu ils
forment les fameuses colonnades basaltiques que
l’on voit en plusieurs endroits du Vivarais, de
l’Auvergne , de la Saxe , de l’Irlande , etc. ; une
de celles de ce dernier pays est particulièrement
célèbre sous le nom de Chaussée des
géants (i). Quelquefois les prismes sont horizontaux
, placés et empilés les uns sur les autres
comme des bûches dans un chantier. D’autres
fois ils vont en divergeant, comme autant de
rayons autour d’un centre ; ils forment ainsi
(i) Voyez les dessins d’un grand nombre de ces colonnades
dans les ouvrages de M. Faujas, et dans l’atlas des Institutions
géologiques , par M. Breislak.