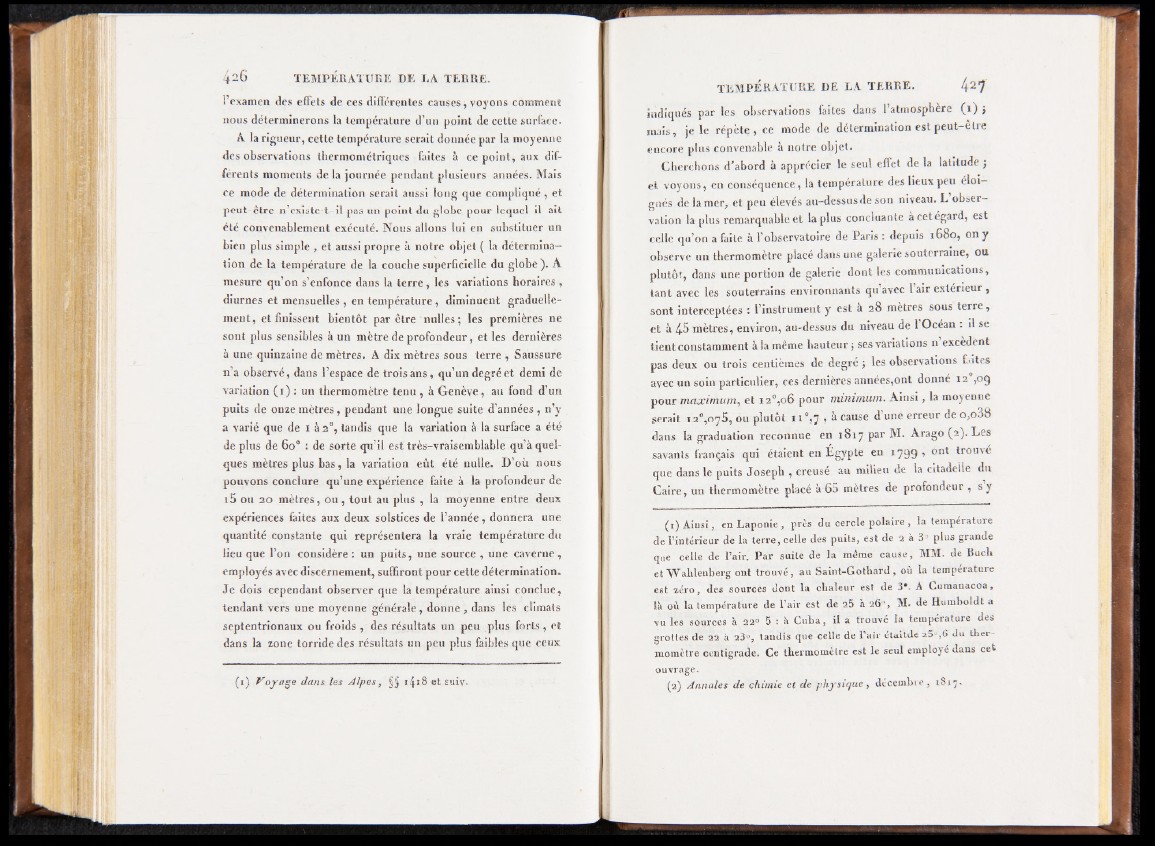
426
1 examen des effets de ces différentes causes ^ voyons comment
nous déterminerons la température d’un point de cette surface.
A la rigueur, cette température serait donnée par la moyenne
des observations thermométriques faites à ce point, aux différents
moments de la journée pendant plusieurs années. Mais
ce mode de détermination serait aussi long que compliqué, et
peut-être n’existe-t-il pas un point du globe pour lequel il ait
été convenablement exécuté. Nous allons lui en substituer un
bien plus simple , et aussi propre à notre objet ( la détermination
de la température de la couche superficielle du globe ). A
mesure qu’on s’enfonce dans la terre, les variations horaires ,
diurnes et mensuelles , en température, diminuent graduellement,
et finissent bientôt par être milles ; les premières ne
sont plus sensibles à un mètre de profondeur, et les dernières
à une quinzaine de mètres. À dix mètres sous terre , Saussure
n’a observé, dans l’espace de trois ans, qu’un degré et demi de
variation (1 ) : un thermomètre tenu , à Genève, au fond d’un
puits de onze mètres, pendant une longue suite d’années , n’y
a varié que de 1 à 20, tandis que la variation à la surface a été
de plus de 6o° : de sorte qu’il est très-vraisemblable qu’à quelques
mètres plus bas, la variation eût été nulle. D’où nous
pouvons conclure qu’une expérience faite à la profondeur de
i 5 ou 20 mètres, o u , tout au plus , la moyenne entre deux
expériences faites aux deux solstices de l’année, donnera une
quantité constante qui représentera la vraie température du
lieu que l’on considère : un puits, une source , une caverne ,
employés avec discernement, suffiront pour cette détermination.
Je dois cependant observer que la température ainsi conclue,
tendant vers une moyenne générale, donne , dans les climats
septentrionaux ou froids , des résultats un peu plus forts, et
dans la zone torride des résultats un peu plus faibles que ceux
(1) Vojrage dans les Alpes, §§ i/jiô et suivindiqués
par les observations faites dans l’atmosphère (x) j
mais, je le répète, ce mode de détermination est peut-être
encore plus convenable à notre objet.
Cherchons d’ abord à apprécier le seul effet de la latitude j
et voyons, en conséquence, la température des lieux peu éloignés
de la mer, et peu élevés au-dessus de son niveau. L observation
la plus remarquable et la plus concluante à cet égard, est
celle qu’on a faite à l’observatoire de Paris : depuis 1680, on y
observe un thermomètre placé dans une galerie souterraine, ou
plutôt, dans une portion de galerie dont les communications,
tant avec les souterrains environnants qu avec 1 air extérieur ,
sont interceptées : l’instrument y est à 28 mètres sous terre,
et à 4-5 mètres, environ, au-dessus du niveau de 1 Océan : il se
tient constamment à la même hauteur ; ses variations n excédent
pas deux ou trois centièmes de degré 5 les observations faites
avec un soin particulier, ces dernières années,ont donné 12 ,og
pour maximum, et I2°,o6 pour minimum. Ainsi, la moyenne
serait i2°,oy5, ou plutôt n ° ,7 5 à cause dune erreur deo,o38
dans la graduation reconnue en 1817 par M. Arago (2). Les
savants français qui étaient en Égypte en 1799 ’ ont trom^
que dans le puits Joseph , creusé au milieu de la citadelle du
Caire, un thermomètre placé à 65 mètres de profondeur , s y 1 2
(1) Ainsi, en Laponie, près du cercle polaire , la temperatuie
de l’intérieur de la terre, celle des puits, est de 2 à S3 plus grande
que celle de l’air. Par suite de la même cause, MM. de Buch
et "VVahlenberg ont trouvé, au Saint-Gothard, où la température
est zéro, des sources dont la chaleur est de 3*. A Cumanacoa,
là où la température de l’air est de 25 à 26% M. de Humboldt a
vu les sources à 220 5 : à Cuba, il a trouve la température des
grottes de 22 à 23°, tandis que celle de l’air étaitde 25°,6 du thermomètre
centigrade. Ce thermomètre est le seul employé dans cet
ouvrage.
(2) Annales de chimie et de physique , décembre, 1817.