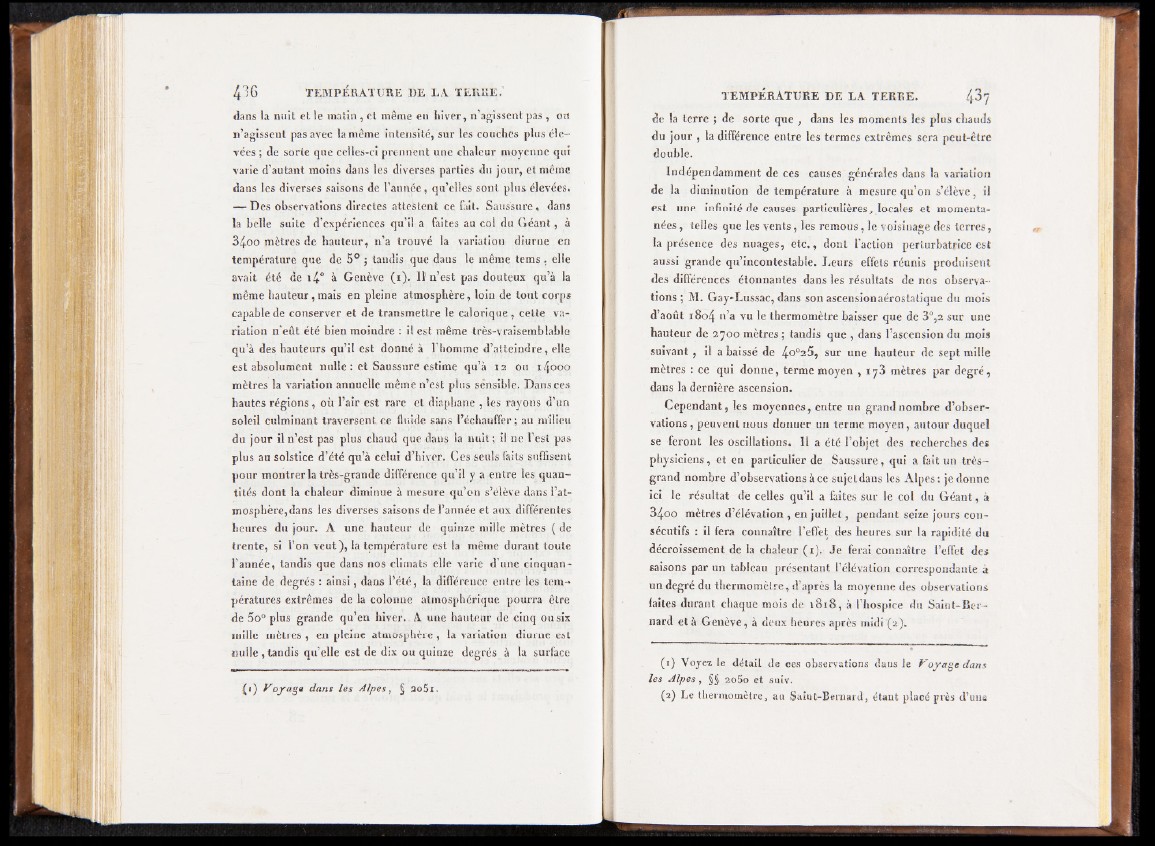
4 3 6
dans la nuit et le matin, et même en hiver, n’agissent pas , on
n’agissent pas avec la même intensité, sur les couches plus élevées
; de sorte que celles-ci prennent une chaleur moyenne qui
varie d’autant moins dans les diverses parties du jour, et même
dans les diverses saisons de l’année, qu’elles sont plusélevées.
— Des observations directes attestent ce fait. Saussure, dans
la belle suite d’expériences qu’il a faites au col du Géant, à
34.00 mètres de hauteur, n’a trouvé la variation diurne en
température que de 5° ; tandis que dans le même tems, elle
avait été de i 4° à Genève (1). Il n’est pas douteux qu’à la
même hauteur,mais en pleine atmosphère, loin de tout corps
capable de conserver et de transmettre le calorique, cette variation
n’eût été bien moindre : il est même très-vraisemblable
qu’à des hauteurs qu’il est donné à l’homme d’atteindre, elle
est absolument nulle : et Saussure estime qu’à 12 ou i 4ooo
mètres la variation annuelle même n’est plus sensible. Dans ces
hautes régions, où l’air est rare et diaphane , les rayons d’un
soleil culminant traversent ce fluide sans l’échauffer ; au milieu
du jour il n’est pas plus chaud que dans la nuit ; il ne l’est pas
plus au solstice d’été qu’à celui d’hiver. Ces seuls laits suffisent
pour montrer la très-grande différence qu’il y a entre les quantités
dont la chaleur diminue à mesure qu’on s’élève dans l’atmosphère,
dans les diverses saisons de l’année et aux différentes
heures du jour. A une hauteur de quinze mille mètres ( de
trente, si l’on veut), la température est la même durant toute
l’année, tandis que dans nos climats elle varie d’une cinquantaine
de degrés : ainsi, dans l’été, la différence entre les températures
extrêmes de la colonne atmosphérique pourra être
de 5o° plus grande qu’ en hiver. A une hauteur de cinq ou six
mille mètres , en pleine atmosphère, la variation diurne est
nulle , tandis qu’elle est de dix ou quinze degrés à la surface
^1) Voyage dans les Alpes, § ao5i.
de la terre ; de sorte que , dans les moments les plus chauds
du jour , la différence entre les termes extrêmes sera peut-être
double.
Indépendamment de ces causes générales dans la variation
de la diminution de température à mesure qu’on s’élève, il
est une infinité de causes particulières, locales et momentanées
, telles que les vents, les remous, le voisinage des terres,
la présence des nuages, etc., dont l’action perturbatrice est
aussi grande qu’incontestable. Leurs effets réunis produisent
des différences étonnantes dans les résultats de nos observations
; M. Gay-Lussac, dans son ascension aérostatique du mois
d’août 1804 n’a vu le thermomètre baisser que de 3°,2 sur une
hauteur de 2700 mètres ; tandis que , dans l’ascension du mois
suivant , il a baissé de 4°°1 25» sur une hauteur de sept mille
mètres : ce qui donne, terme moyen ,1 7 8 mètres par degré,
dans la dernière ascension.
Cependant, les moyennes, entre un grand nombre d’observations
, peuvent nous donner un terme moyen, autour duquel
se feront les oscillations. Il a été l’objet des recherches des
physiciens, et en particulier de Saussure, qui a fait un très-
grand nombre d’observations à ce sujet dans les Alpes : je donne
ici le résultat de celles qu’il a faites sur le col du Géant, à
34oo mètres d’élévation , en juillet, pendant seize jours consécutifs
: il fera connaître l’effet des heures sur la rapidité du
décroissement de la chaleur (1). Je ferai connaître l’effet des
saisons par un tableau présentant l’élévation correspondante à
un degré du thermomètre, d’après la moyenne des observations
faites durant chaque mois de 1818, à l’hospice du Saint-Bernard
et à Genève, à deux heures après midi (2).
(1) Voyez le détail de ces observations dans le Voyage dans
les A lp e s , §§ 2o5o et suiv.
(2) Le thermomètre, au Saint-Bernard, étant placé près d’une