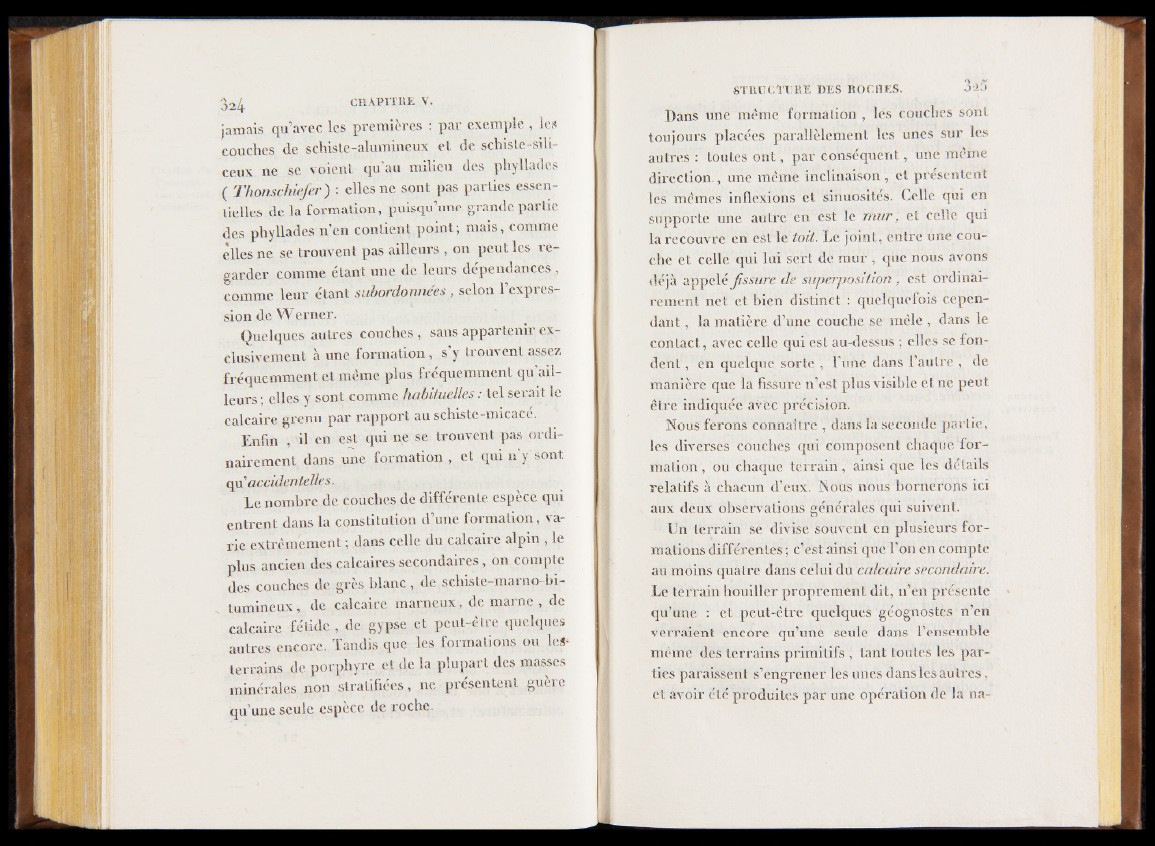
jamais qu’avec les premières : par exemple , les
couches de schiste-alumineux et de schiste-siliceux
ne se voient qu’au milieu des phyllades
( Thonschiefer ) : elles ne sont pas parties essentielles
de la formation, puisqu’une grande partie
des phyllades n’en contient point; mais, comme
elles ne se trouvent pas ailleurs , on peut les regarder
comme étant une de leurs dependances ,
comme leur étant subordonnées , selon l’expression
de Werner.
Quelques autres couches , sans appartenir exclusivement
à une formation , s y trouvent assez
fréquemment et même plus fréquemment qu ailleurs
; elles y sont comme habituelles : tel serait le
calcaire grenu par rapport au schiste-micacé.
Enfin , il en est qui ne se trouvent pas ordin
a i r e m e n t dans une formation, et qui n’y sont
qu ''accidentelles.
Le nombre de couches de différente espèce qui
entrent dans la constitution d’une formation, varie
extrêmement ; dans celle du calcaire alpin , le
plus ancien des calcaires secondaires, on compte
des couches de grès blanc , de schiste-marno-bitumineux
, de calcaire marneux, de marne , de
calcaire fétide , de gypse et peut-être quelques
autres encore. Tandis que les formations ou les-
terrains de porphyre et de la plupart des masses
minérales non stratifiées, ne présentent guère
qu’une seule espèce de roche.
Dans une même formation , les couches sont
toujours placées parallèlement les unes sur les
autres : toutes on t , par conséquent, une même
direction., une même inclinaison , et présentent
les mêmes inflexions et sinuosités. Celle qui en
supporte une autre en est le mur, et celle qui
la recouvre en est le toit. Le joint , entre une couche
et celle qui lui sert de mur , que nous avons
déjà appelé fissure de superposition, est ordinairement
net et bien distinct : quelquefois cependant
, la matière d’une couche se mêle , dans le
contact, avec celle qui est au-dessus ; elles se fondent
, en quelque sorte , l’une dans l’autre , de
manière que la fissure n’est plus visible et ne peut
être indiquée avec précision.
Nous ferons connaître , dans la seconde partie,
les diverses couches qui composent chaque formation
, ou chaque terrain, ainsi que les détails
relatifs à chacun d’eux. Nous nous bornerons ici
aux deux observations générales qui suivent.
Un terrain se divise souvent en plusieurs formations
différentes ; c’est ainsi que l’on en compte
au moins quatre dans celui du calcaire secondaire.
Le terrain houiller proprement dit, n’en présente
qu’une : et peut-être quelques géognostes n’en
verraient encore qu’une seule dans l’ensemble
même des terrains primitifs , tant toutes les parties
paraissent s’engrener les unes danslesauLres,
et avoir été produites par une opération de la fia