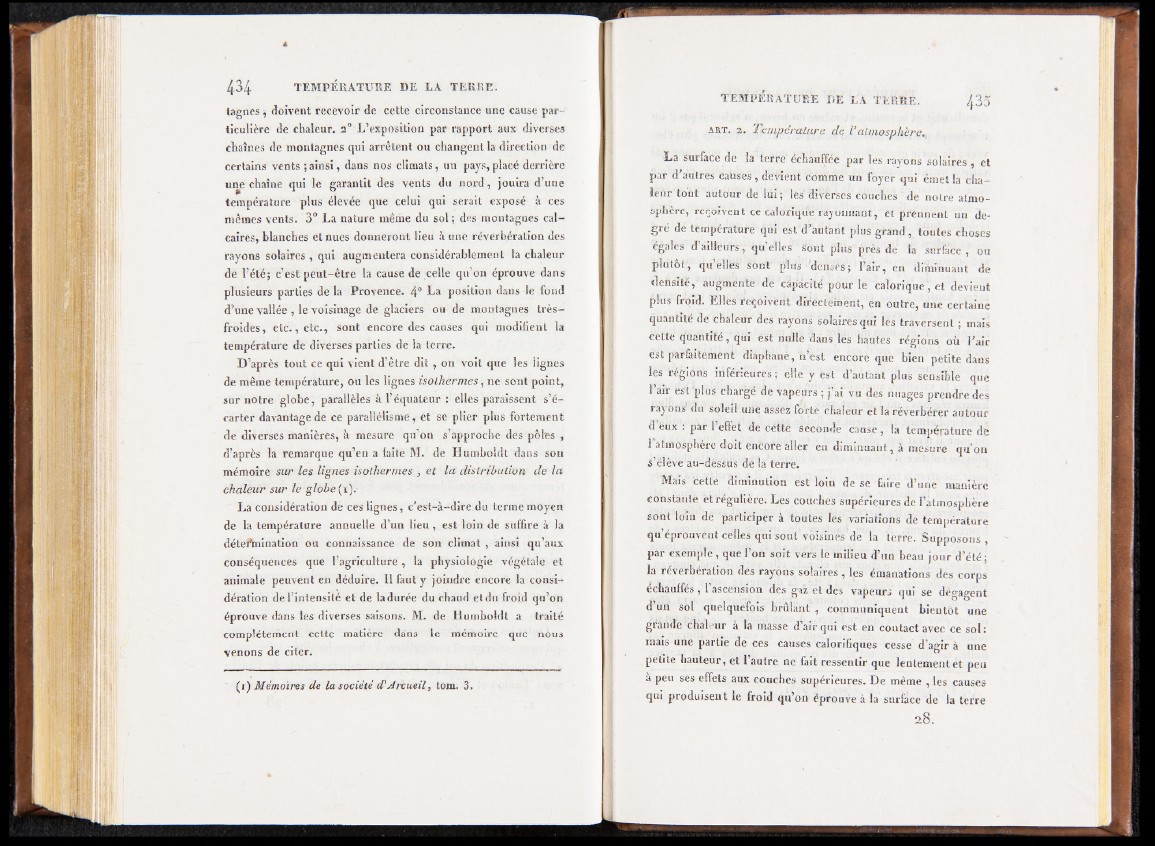
TEMPERATURE 434 DE LA TERRE.
tagnes, doivent recevoir de cette circonstance une cause particulière
de chaleur. 2° L ’exposition par rapport aux diverses
chaînes de montagnes qui arrêtent ou changent la direction de
certains vents ; ainsi, dans nos climats, un pays, placé derrière
une chaîne qui le garantit des vents du nord, jouira d’une
température plus élevée que celui qui serait exposé à ces
mêmes vents. 3° La nature même du sol ; des montagnes calcaires,
blanches et nues donneront lieu à une réverbération des
rayons solaires , qui augmentera considérablement la chaleur
de l’été; c’est peut-être la cause de celle qu’on éprouve dans
plusieurs parties de la Provence. 4° La position dans le fond
d’une vallée , le voisinage de glaciers ou de montagnes très-
froides, e tc ., etc., sont encore des causes qui modifient la
température de diverses parties de la terre.
D ’après tout ce qui vient d’être d i t , on voit que les lignes
de même température, ou les lignes isothermes, ne sont point,
sur notre globe, parallèles à l’équateur : elles paraissent s’écarter
davantage de ce parallélisme, et se plier plus fortement
de diverses manières, à mesure qu’on s’approche des pôl'es ,
d’après la remarque qu’en a laite M. de Humboldt dans son
mémoire sur les lignes isothermes , et la distribution de la
chaleur sur le globe (1).
La considération dè ces lignes, c’est-à-dire du terme moyen
de la température annuelle d’un lieu , est loin de suffire à la
déteiànination ou connaissance de son climat , ainsi qu’aux
conséquences que l’agriculture , la physiologie végétale et
animale peuvent en déduire. 11 faut y joindre encore la considération
de l’intensité et de ladurée du chaud etdu froid qu’on
éprouve dans les diverses saisons. M. de Humboldt a traité
complètement cette matière dans le mémoire que nous
•venons de citer.
(1) Mémoires de la société d'Accueil, tom. 3,
a r t . 2 . Température de l’atmosphère.,
La Surface de la terre échauffée par les rayons solaires et
par d’autres caüses, devient comme un foyer qui émet la chaleur
tout autour de lui ; les diverses couches de notre atmosphère,
reçoivent ce calorique rayonnant, et prennent un degré
de température qui est d’autant plus grand, toutes choses
égales d’ailleurs, quelles Sont plus près de la surface , ou
plutôt, qu’elles sont plus 'dénsès; l’air, en diminuant de
densité, augmente de capacité pour le calorique , et devient
plus froid. Elles reçoivent directement, en outre, une certaine
quantité de chaleur des rayons solaires qui les traversent ; mais
cette quantité, qui est nulle dans les hautes régions où l’air
est parfaitement diaphane, n’est encore que bien petite dans
les régions inférieures; elle y est d’autant plus sensible que
ï air est plus chargé de vapeurs ; j’ai vu des nuages prendre des
rayons1 du soleil une assez forte chaleur et la réverbérer autour
d eux : par l’effet de cette seconde cause, la température dé
l ’atmosphère doit encore aller eu diminuant, à mesure qu’on
s’élève au-dessus de la terre.
Mais cette diminution est loin de se faire d’une manière
constante ét régulière. Les couches supérieures de l’atmosphère
sont loin dé participer à toutes les variations de température
qu’éprouvent celles qui sont voisines de la terre. Supposons,
par exemple, que l’on soit vers le milieu d’un beau jour d’été •
la réverbération des rayons solaires , les émanations des corps
echaulfes , 1 ascension des gaz et des vapeurs qui se dégagent
d’un sol quelquefois brûlant , communiquent bientôt une
grande chaleur à la masse d’air qui est en contact avec ce sol :
mais une partie de ces causes calorifiques cesse d’agir à une
petite hauteur, et l’autre ne fait ressentir que lentement et peu
à peu ses effets aux couches supérieures. De même , les causes
qui produisent le froid qu’on éprouve à la surface de la terre