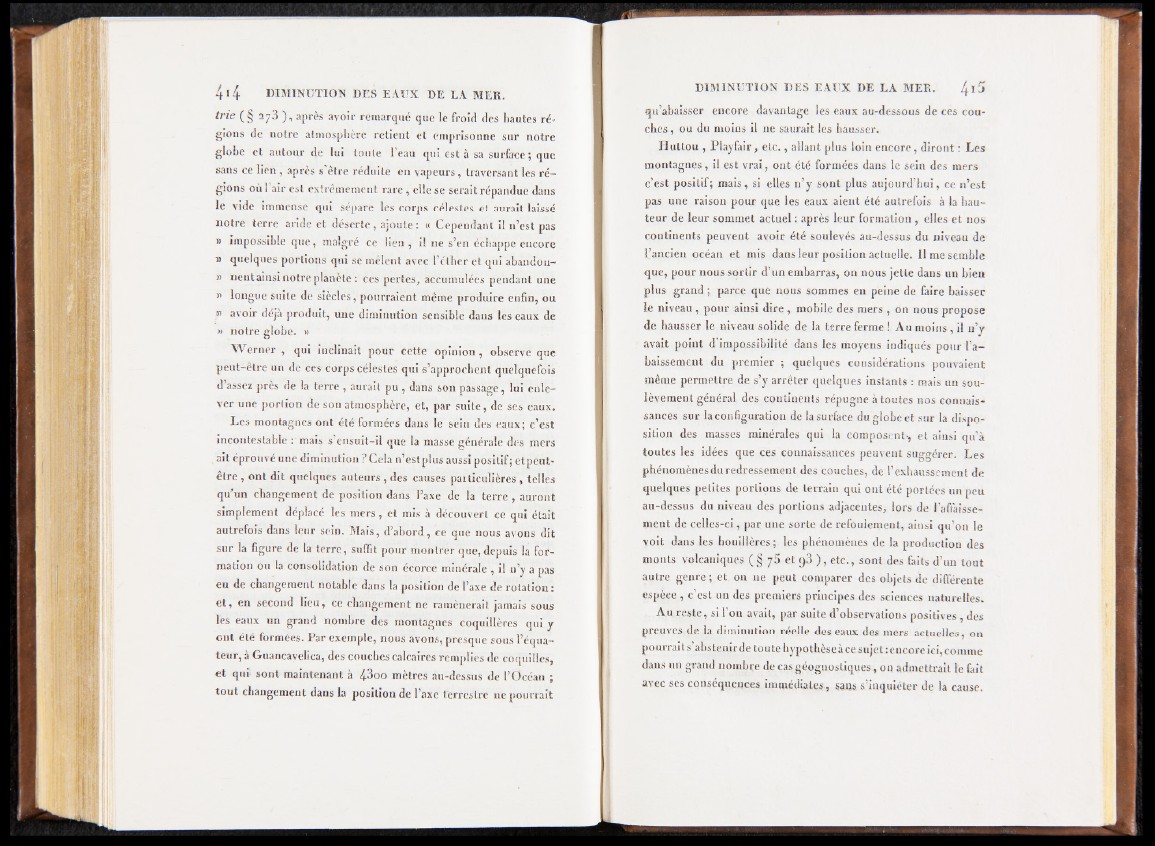
trie (§ 273 ), après avoir remarqué que le froid des hautes ré-
gions de notre atmosphère retient et emprisonne sur notre
globe et autour de lui toute l’eau qui est à sa surfa'ee ; que
sans ce lien, après s’être réduite en vapeurs, traversant les régions
où l’air est extrêmement rare , elle se serait répandue dans
le vide immense qui sépare les corps célestes et aurait laissé
notre terre aride et déserte, ajoute: « Cependant il n’est pas
» impossible que, malgré ce lien, il ne s’en échappe encore
» quelques portions qui se mêlent avec l’éther et qui abandou-
» nent ainsi notre planète : ces pertes, accumulées pendant une
« longue suite de siècles, pourraient même produire enfin, ou
F avoir déjà produit, une diminution sensible dans les eaux de
» notre globe. »
Werner , qui inclinait pour cette opinion, observe que
peut-être un de ces corps célestes qui s’approchent quelquefois
d assez près de la terre , aurait pu , dans son passage, lui enlever
une portion de son atmosphère, et, par suite, de ses eaux.
Les montagnes ont été formées dans le sein des eaux; c’est
incontestable : mais s’ensuit-il que la masse générale des mers
ait éprouvé une diminution PCela n’estplus aussi positif; et peut-
etre , ont dit quelques auteurs, des causes particulières , telles
qu’un changement de position dans l’axe de la terre , auront
simplement déplacé les mers, et mis à découvert ce qui était
autrefois dans leur sein. Mais, d’abord, ce que nous avons dit
sur la figure de la terre, suffit pour montrer que, depuis la formation
ou la consolidation de son écorce minérale , il n’y a pas
eu de changement notable dans la position de l’axe de rotation:
e t , en second lieu, ce changement ne ramènerait jamais sous
les eaux un grand nombre des montagnes coquillères qui y
ont été formées. Par exemple, nous avons, presque sous l’équateur,
à Guancavelica, des couches calcaires remplies de coquilles,
et qui sont maintenant à 43oo mètres au-dessus de l’Océan ;
tout changement dans la position de l’axe terrestre ne pourrait
qu’abaisser encore davantage les eaux au-dessous de ces couches
, ou du moins il ne saurait les hausser.
Huttou , Playfair, etc., allant plus loin encore, diront : Les
montagnes, il est vrai, ont été formées dans le sein des mers
c’est positif; mais, si elles n’ y sont plus aujourd’hui, ce n’est
pas une raison pour que les eaux aient été autrefois à la hauteur
de leur sommet actuel : après leur formation , elles et nos
continents peuvent avoir été soulevés au-dessus du niveau de
l’ancien océan et mis dans leur position actuelle. 11 me semble
que, pour nous sortir d’un embarras, on nous jette dans un bien
plus grand ; parce que nous sommes en peine de faire baisser
le niveau , pour ainsi dire , mobile des mers , on nous propose
de hausser le niveau solide de la terre ferme ! Au moins, il n’y
avait point d'impossibilité dans les moyens indiqués pour l’abaissement
du premier ; quelques considérations pouvaient
même permettre de s’y arrêter quelques instants : mais un soulèvement
général des continents répugne à toutes nos connaissances
sur la configuration de la surface du globe et sur la disposition
des masses minérales qui la composent-, et ainsi qu’à
toutes les idées que ces connaissances peuvent suggérer. Les
phénomènes du redressement des couches, de l’exhaussement de
quelques petites porliçns de terrain qui ont été portées un peu
au-dessus du niveau des portions adjacentes, lors de l’affaissement
de celles-ci, par une sorte de refoulement, ainsi qu’on le
voit dans les houillères ; les phénomènes de la production des
monts volcaniques ( § y5 et g3 ) , etc., sont des faits d’un tout
autre genre ; et on 11e peut comparer des objets de différente
espèce , c’est un des premiers principes des sciences naturelles.
Au reste, si l’on avait, par suite d’observations positives , des
preuves de la diminution réelle des eaux des mers actuelles, on
pourrait s’abstenir de toute hypothèse à ce sujet : encore ici, comme
dans un grand nombre de cas géognostiques, on admettrait le fait
avec ses conséquences immédiates, sans, s’inquiéter de la cause.