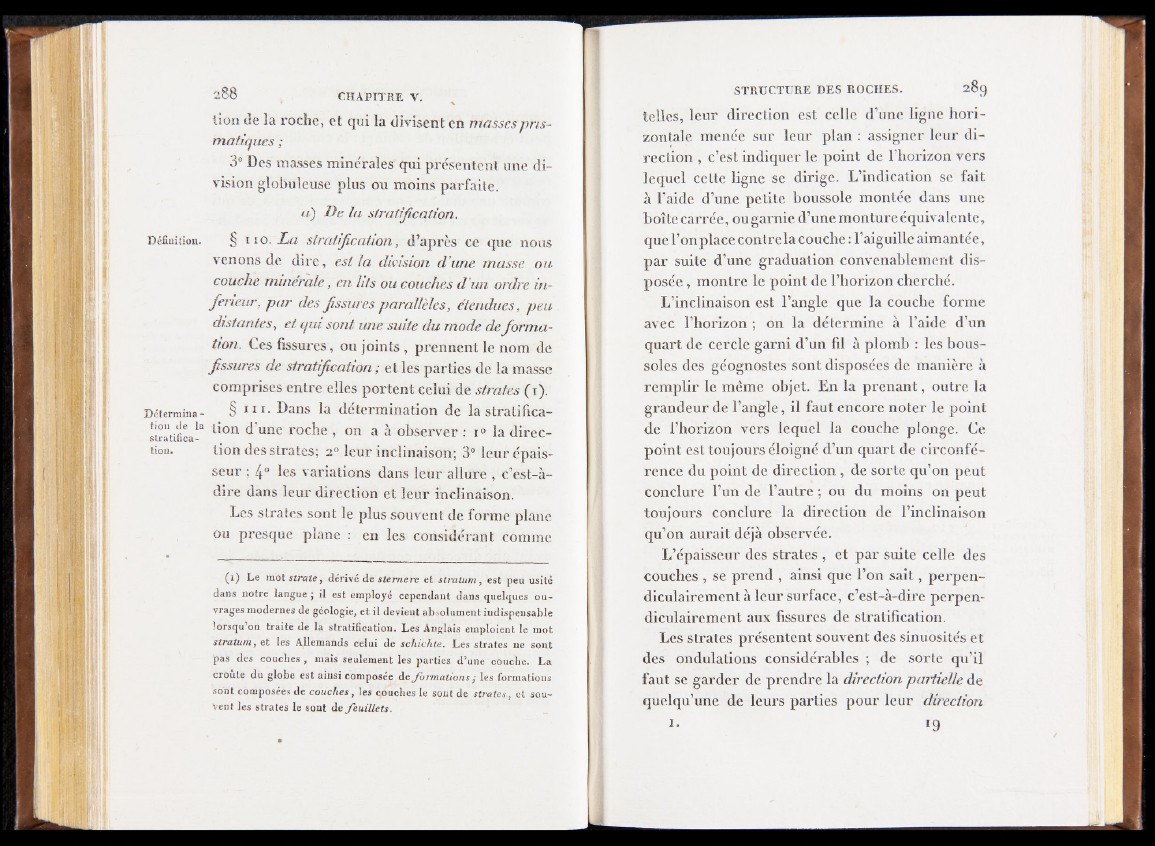
lion de la roche, et qui la divisent en masses prismatiques
;
3° Des masses minérales qui présentent une division
globuleuse plus ou moins parfaite.
a) De la stratification.
Définition. § i io .L a stratification, d’après ce que nous
venons de dire, est la division d ’une masse ou
couche minérale, en lits ou couches d un ordre inferieur,
par des fissures parallèles, étendues, peu
distantes, et qui sont une suite du mode de formation.
Ces fissures, ou joints , prennent le nom de
fissures de stratification ; et les parties de la masse
comprises entre elles portent celui de strates (i).
Détermina- § IXI- ^ ans la détermination de la stratifica-
stratifica-3 ^on ^ une roche y on a à observer : i° la direction.
tion des strates; 2° leur inclinaison; 3° leur épaisseur
; 4° les variations dans leur allure , c’est-à-
dire dans leur direction et leur inclinaison.
Les strates sont le plus souvent de forme plane
ou presque plane : en les considérant comme
(0 Le mot strate, dérivé de sternere et stratum, est peu usité
dans notre langue j il est employé cependant dans quelques ouvrages
modernes de géologie, et il devient absolument indispensable
lorsqu’on traite de la stratification. Les Anglais emploient le mot
stratum, et les Allemands celui de schichte. Les strates ne sont
pas des couches , mais seulement les parties d’une couche. La
croûte du globe est ainsi composée de formations y les formations
sont composées de couches, les couches le sont de strates, et souvent
les strates le sont de feuillets.
telles, leur direction est celle d’une ligne horizontale
menée sur leur plan : assigner leur direction
, c’est indiquer le point de l’horizon vers
lequel celte ligne se dirige. L’indication se fait
à l’aide d’une petite boussole montée dans une
boîte carrée, ougarnie d’une monture équivalente,
que l’on place contrela couche : l ’aiguille aimantée,
par suite d’une graduation convenablement disposée
, montre le point de l’horizon cherché.
L’inclinaison est l ’angle que la couche forme
avec l’horizon ; on la détermine à l’aide d’un
quart de cercle garni d’un fil à plomb : les boussoles
des géognostes sont disposées de manière à
remplir le même objet. En la prenant, outre la
grandeur de l ’angle, il faut encore noter le point
de l’horizon vers lequel la couche plonge. Ce
point est toujours éloigné d’un quart de circonférence
du point de direction , de sorte qu’on peut
conclure l’un de l’autre ; ou du moins on peut
toujours conclure la direction de l’inclinaison
qu’on aurait déjà observée.
L’épaisseur des strates , et par suite celle des
couches , se prend , ainsi que l ’on sait, perpendiculairement
à leur surface, c’est-à-dire perpendiculairement
aux fissures de stratification.
Les strates présentent souvent des sinuosités et
des ondulations considérables ; de sorte qu’il
faut se garder de prendre la direction partielle de
quelqu’une de leurs parties pour leur direction
1. ! 9