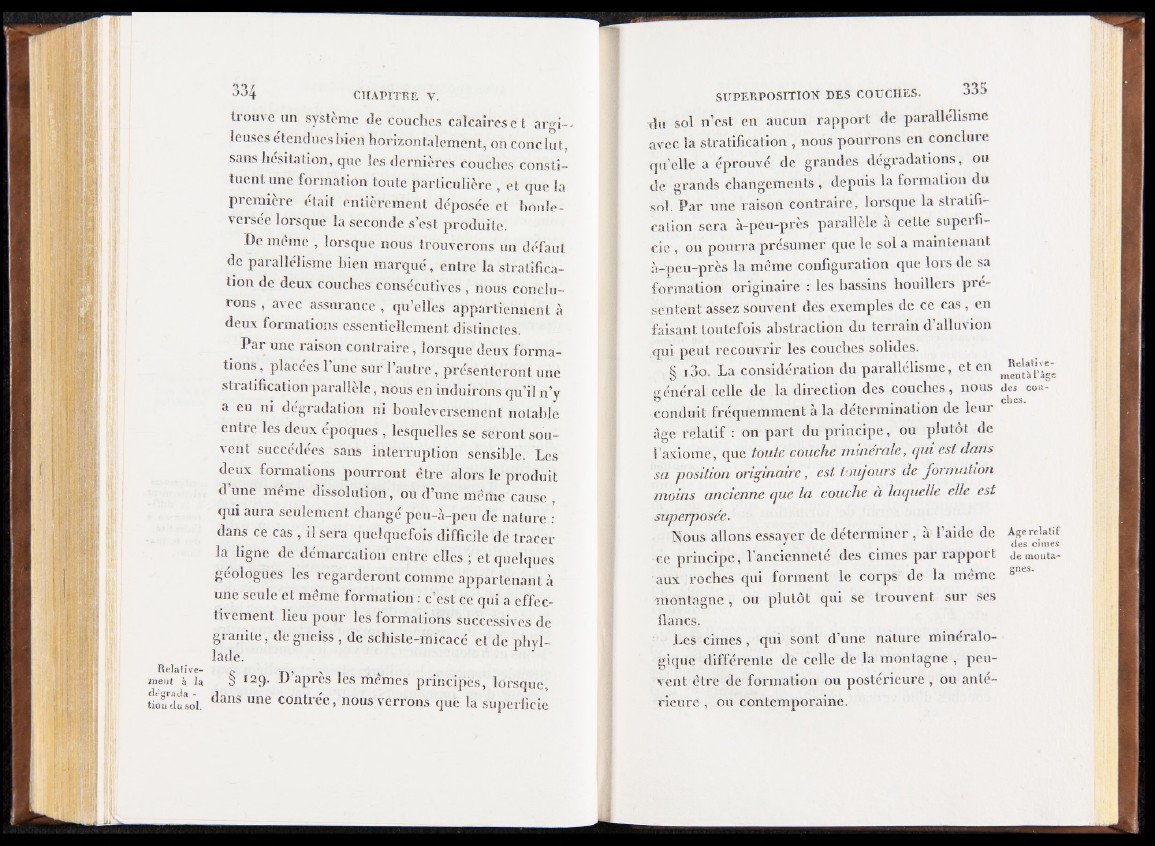
trouve un système de couches calcaires et argileuses
étendues bien horizontalement, on conclut,
sans hesitation, que les dernières couches constituent
une formation toute particulière , et que la
première était entièrement déposée et bouleversée
lorsque la seconde s’est produite.
De meme , lorsque nous trouverons un défaut
de parallélisme bien marqué, entre la stratification
de deux couches consécutives , nous conclurons
, avec assurance , qu’elles appartiennent à
deux formations essentiellement distinctes.
Par une raison contraire, lorsque deux formations
, placées l’une sur l ’autre, présenteront une
stratification parallèle, nous en induirons qu’il n’y
a eu ni dégradation ni bouleversement notable
entre les deux époques , lesquelles se seront souvent
succédées sans interruption sensible. Les
deux formations pourront être alors le produit
d’une même dissolution, ou d’une même cause ,
qui aura seulement changé peu-à-peu de nature I
dans ce cas , il sera quelquefois difficile de tracer
la ligne de démarcation entre elles ; et quelques
géologues les regarderont comme appartenant à
une seule et même formation : c’est ce qui a effectivement
lieu pour les formations successives de
granite, de gneiss , de schiste-micacé et de phyl-
lade.
Relative- c r** ' v *
meat à la S I29- D apres les memes principes, lorsque,
tioudusol. ^ans une contrée, nous verrons que la superficie
tIu sol n’est en aucun rapport de parallélisme
avec la stratification , nous pourrons en conclure
qu’elle a éprouvé de grandes degradations, ou
de grands changements , depuis la formation du
sol. Par une raison contraire, lorsque la stratification
sera à-peu-pres parallèle a cette superficie
, on pourra présumer que le sol a maintenant,
à-peu-près la même configuration que lors de sa
formation originaire : les bassins houillers présentent
assez souvent des exemples de ce cas, en
faisant toutefois abstraction du terrain d’alluvion
qui peut recouvrir les couches solides.
§ i 3o. La considération du parallélisme, et en
général celle de la direction des couches, nous
conduit fréquemment à la détermination de leur
âge relatif : on part du principe, ou plutôt de
l ’axiome, que toute couche minérale, qui est dans
sa position originaire, est toujours de formation
moins ancienne que la couche à laquelle elle est
superposée.
Nous allons essayer de déterminer, a l’aide de
ce principe, l'ancienne te des cimes par rapport
aux roches qui forment le corps de la même
montagne , ou plutôt qui se trouvent sur ses
flancs.
Les cimes, qui sont d’une nature minéralogique
différente de celle de la montagne , peuvent
être de formation ou postérieure , ou antérieure
, ou contemporaine.
Relativement
à l’âge
des couches.
Age relatif
des cimes
de montagnes.