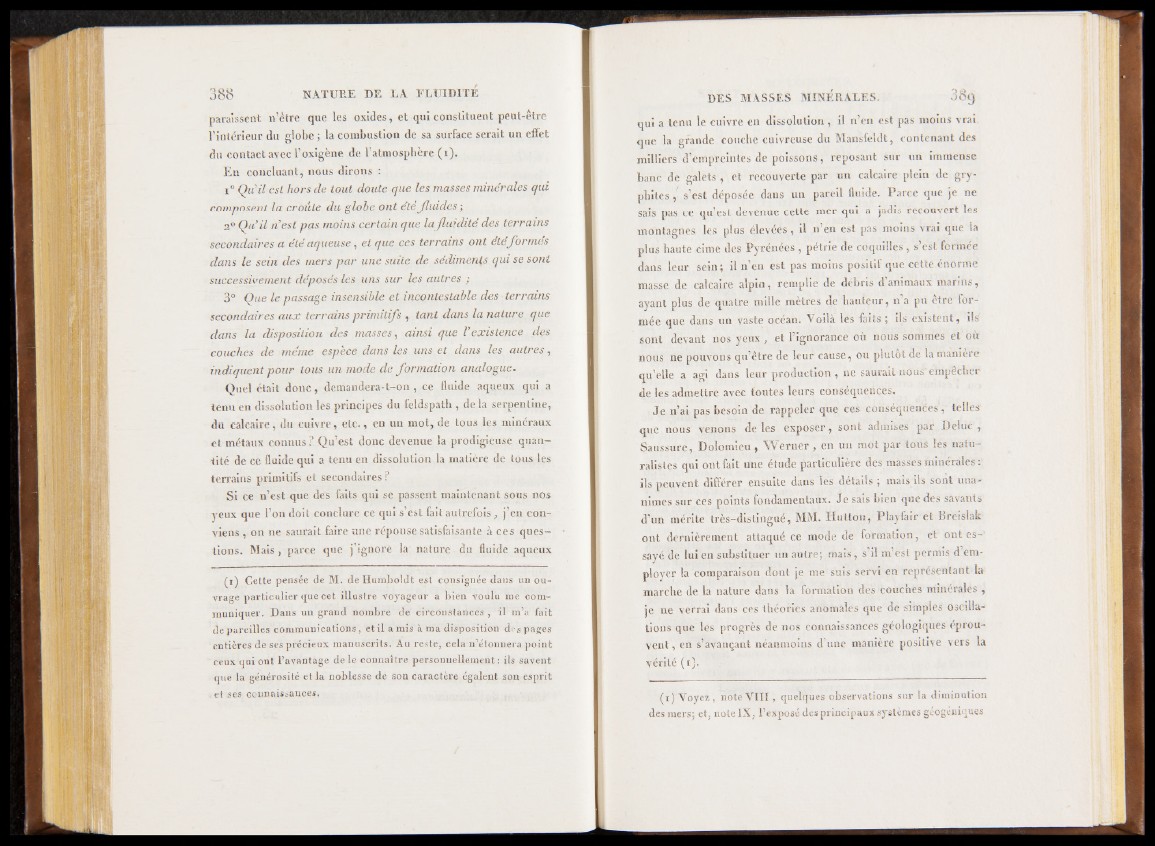
paraissent n’être que les oxides, et qui constituent peut-être
l’intérieur du globe ; la combustion de sa surface serait un effet
du contact avec l’oxigène de l’atmospbere ( i) .
En concluant, nous dirons :
i° Qu'il est hors de tout doute que les masses minérales qui
composent la croûte du globe ont été Jluides ;
2° Qu’ il n’est pas moins certain que la flu id ité des terrains
secondaires a été aqueuse, et que ces terrains ont été fo rm e s
dans le sein des mers par une suite de sédiments qui se sont
successivement déposés les uns sur les autres ;
3° Que le passage insensible et incontestable des terrains
secondaires a u x terrains primitifs , tant dans la nature que
dans la disposition des masses, ainsi que l’ existence des
couches de meme espèce dans les uns et dans les autres,
indiquent pour tous un mode de formation analogue.
Quel était donc, demandera-t-on, ce fluide aqueux qui a
tenu en dissolution les principes du feldspath , de la serpentine,
du calcaire, du cuivre, etc., en un mot, de tous les minéraux
et métaux connus ? Qu’est donc devenue la prodigieuse quantité
de ce fluide qui a tenu en dissolution la matière de tous les
terrains primitifs et secondaires P
Si ce n’est que des faits qui se passent maintenant sous nos
yeux que l’on doit conclure ce qui s’est fait autrefois, j’en conviens
, on ne saurait faire une réponse satisfaisante à ces questions.
Mais , parce que j’ignore la nature du fluide aqueux
(x) Cette pensée de M. de Humboldt est consignée dans un ouvrage
particulier que cet illustre voyageur a bien voulu me communiquer.
Dans un grand nombre de circonstances , il m’a fait
de pareilles communications, et il a mis à ma disposition des pages
entières de ses précieux manuscrits. Au reste, cela n’étonnera point
ceux qui ont l’avantage de le connaître personnellement : ils savent
que la générosité et la noblesse de son caractère égalent son esprit
. et ses connaissances.
389
qui a tenu le cuivre en dissolution , il n’en est pas moins vrai
que la grande couche cuivreuse du Mansfeldt, contenant des
milliers d’empreintes de poissons, reposant sur un immense
banc de galets , et recouverte par un calcaire plein de gry-
phites, s’est déposée dans un pareil fluide. Parce que je ne
sais pas ce qu’ est devenue cette mer qui a jadis recouvert les
montagnes les plus élevées, il n’en est pas moins vrai que la
plus haute cime des Pyrénées , pétrie de coquilles , s’est formée
dans leur sein; il n’en est pas moins positif que cette énorme
masse de calcaire alpin, remplie de débris danimaux marins,
ayant plus de quatre mille mètres de hauteur, n a pu etre formée
que dans un vaste océan. Voila les faits ; ils existent, ils
sont devant nos yeux, et l’ignorance où nous sommes et où
nous ne pouvons qu’être de leur cause, ou plutôt de la manière
qu’elle a agi dans leur production , ne saurait nous empêcher
de les admettre avec toutes leurs conséquences.
Je n’ai pas besoin de rappeler que ces conséquences, telles
que nous venons de les exposer, sont admises par Deluc ,
Saussure, Dolomieu , Werner , en un mot par tous les naturalistes
qui ont fait une étude particulière des masses minérales :
ils peuvent différer ensuite dans les détails ; mais ils sont unanimes
sur ces points fondamentaux. Je sais bien que des savants
d’un mérite très-distingué, MM. Hutton, Playfair et Breislak
ont dernièrement attaqué ce mode de formation, et ont es-'
sayé de lui en substituer un autre; mais, s’il m’est permis d employer
la comparaison dont je me suis servi en représentant la
marche de la nature dans la formation des couches minérales ,
je ne verrai dans ces théories anomales que de simples oscillations
que les progrès de nos connaissances géologiques éprouvent
, en s’avançant néanmoins d’une manière positive vers la
vérité (i).
(i) Voyez, note VIII , quelques observations sur la diminution
des mers; et, note IX, l’exposé des principaux systèmes géogéniques