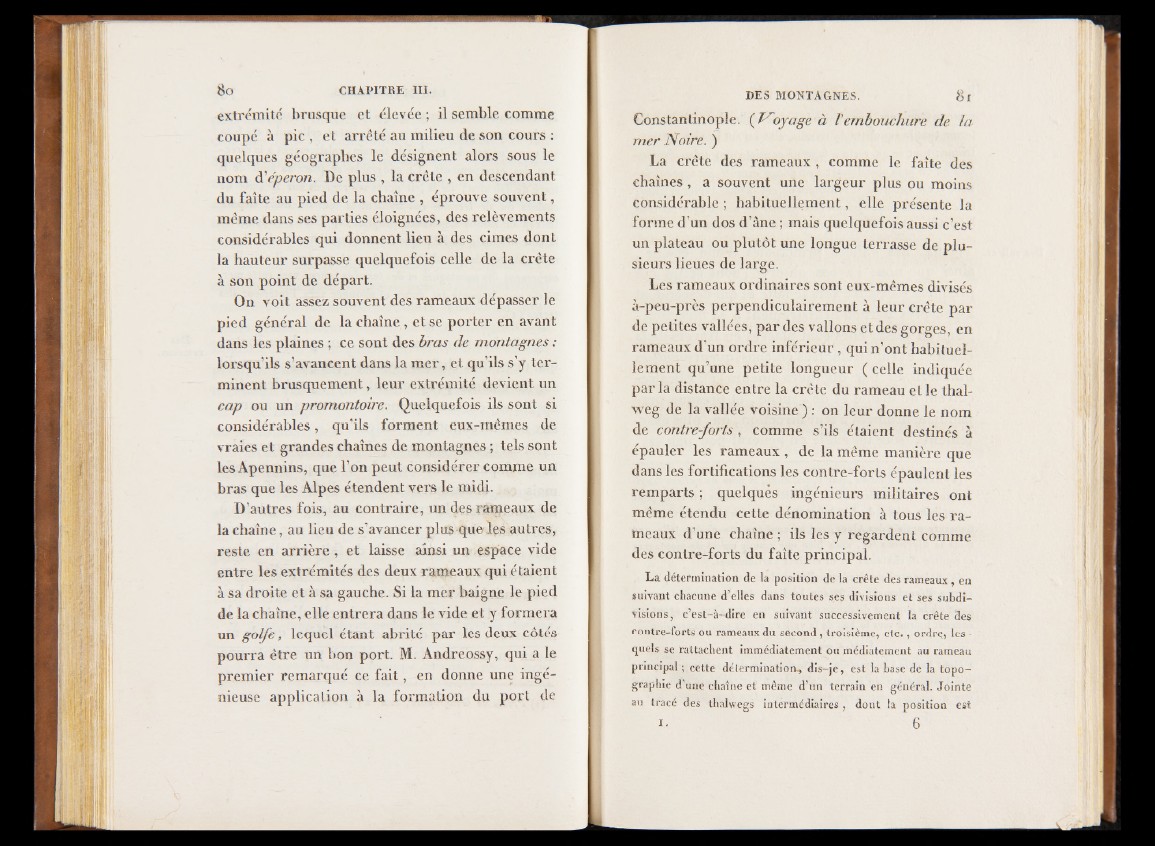
extrémité brusque et élevée ; il semble comme
coupé à pic , et arrêté au milieu de son cours :
quelques géographes le désignent alors sous le
nom à 'é p e r o n . De plus , la crête , en descendant
du faîte au pied de la chaîne , éprouve souvent,
même dans ses parties éloignées, des relèvements
considérables qui donnent lieu à des cimes dont
la hauteur surpasse quelquefois celle de la crête
à son point de départ.
On voit assez souvent des rameaux dépasser le
pied général de la chaîne , et se porter en avant
dans les plaines ; ce sont des b ra s d e m o n ta g n e s ;
lorsqu’ils s’avancent dans la mer, et qu’ils s’y terminent
brusquement, leur extrémité devient un
c a p ou un p r om o n to ir e . Quelquefois ils sont si
considérables, qu’ils forment eux-mêmes de
vraies et grandes chaînes de montagnes ; tels sont
les Apennins, que l’on peut considérer comme un
bras que les Alpes étendent vers le midi.
D’autres fois, au contraire, un des rameaux de
la chaîne, au lieu de s’avancer plus quoies autres,
reste en arrière, et laisse ainsi un espace vide
entre les extrémités des deux rameaux qui étaient
à sa droite et à sa gauche. Si la mer baigne le pied
de la chaîne, elle entrera dans le vide et y formera
un g o lf e , lequel étant abrité par les deux côtés
pourra être un bon port. M. Andreossy, qui a le
premier remarqué ce fa it , en donne une ingénieuse
application à la formation du port de
Constantinople. {T7 'o y a g e à V em b o u c h u r e d e la
m e r N o ir e . )
La crête des rameaux , comme le faîte des
chaînes , a souvent une largeur plus ou moins
considérable ; habituellement, elle présente la
forme d’un dos d’âne ; mais quelquefois aussi c’est
un plateau ou plutôt une longue terrasse de plusieurs
lieues de large.
Les rameaux ordinaires sont eux-mêmes divisés
à-peu-près perpendiculairement à leur crête par
de petites vallées, par des vallons et des gorges, en
rameaux d’un ordre inférieur , qui n’ont habituellement
qu’une petite longueur ( celle indiquée
par la distance entre la crête du rameau elle thalweg
de la vallée voisine ) : on leur donne le nom
de c o n tr e fo r t s , comme s’ils étaient destinés à
épauler les rameaux , de la même manière que
dans les fortifications les contre-forts épaulent les
remparts ; quelques ingénieurs militaires ont
même étendu cette dénomination à tous les rameaux
d’une chaîne ; ils les y regardent comme
des contre-forts du faîte principal.
La détermination de la position de la crête des rameaux , en
suivant chacune d’elles dans toutes ses divisions et ses subdivisions,
c’est-à-dire en suivant successivement la crête des
contre-forts ou rameaux du second, troisième, etc., ordrç, lesquels
se rattachent immédiatement ou médiatement au rameau
principal ; cette détermination, dis-je, est la base de la topographie
d’une chaîne et même d’un terrain en général. Jointe
au tracé des thalwegs intermédiaires, dont la position est
6