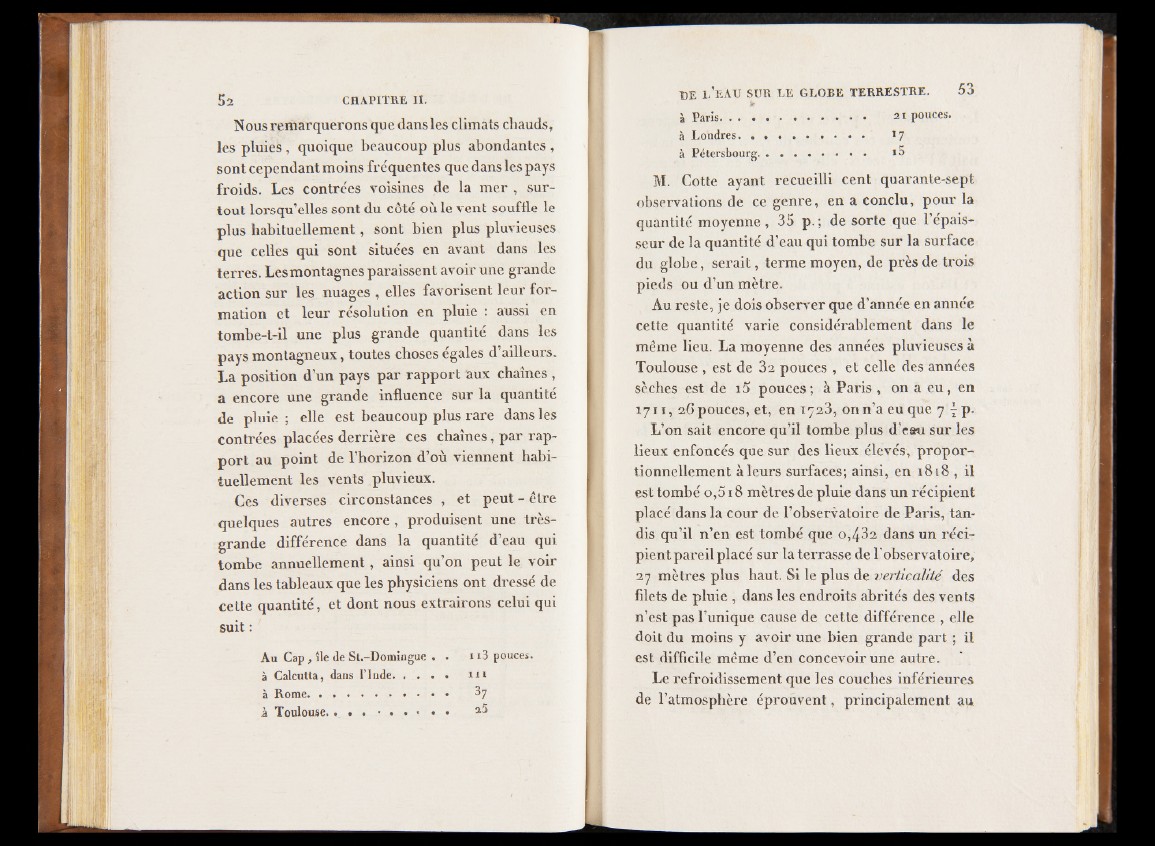
Nous remarquerons que dans les climats chauds,
les pluies , quoique beaucoup plus abondantes ,
sont cependant moins fréquentes que dans les pays
froids. Les contrées voisines de la mer , surtout
lorsqu’elles sont du côté où le vent souffle le
plus habituellement , sont bien plus pluvieuses
que celles qui sont situées en avant dans les
terres. Lesmontagnes paraissent avoir une grande
action sur les nuages , elles favorisent leur formation
et leur résolution en pluie : aussi en
tombe-t-il une plus grande quantité dans les
pays montagneux, toutes choses égales d’ailleurs.
La position d’un pays par rapport 'aux chaînes ,
a encore une grande influence sur la quantité
de pluie ; elle est beaucoup plus rare dans les
contrées placées derrière ces chaînes, par rapport
au point de l ’horizon d’où viennent habituellement
les vents pluvieux.
Ces diverses circonstances , et peut - être
quelques autres encore, produisent une très-
grande différence dans la quantité d’eau qui
tombe annuellement, ainsi qu’on peut le voir
dans les tableaux que les physiciens ont dressé de
cette quantité, et dont nous extrairons celui qui
suit : 1
Au Cap, île (le St.-Domingue . .
à Calcutta, dans l’Inde. , . . .
à Rome............................................ i Toulouse. . . • . . « • •
1 13 pouces.
n i
37
a5
à Paris.................................................. 21 pouces.
à Londres............................................ >7
à Pétersbourg................................. i 5
M. Cotte ayant recueilli cent quarante-sept
observations de ce genre, en a conclu, pour la
quantité moyenne, 35 p. ; de sorte que l’épaisseur
de la quantité d’eau qui tombe sur la surface
du globe, serait, terme moyen, de près de trois
pieds ou d’un mètre.
Au reste, je dois observer que d’année en année
cette quantité varie considérablement dans le
même lieu. La moyenne des années pluvieuses à
Toulouse , est de 32 pouces , et celle des années
sèches est de i 5 pouces; à Paris , on a eu, en
1711, 26 pouces, et, en 1723, on n’a eu que 7 7 p-
L’on sait encore qu’il tombe plus d’easu sur les
lieux enfoncés que sur des lieux élevés, proportionnellement
à leurs surfaces; ainsi, en 1818 , il
est tombé o,518 mètres de pluie dans un récipient
placé dans la cour de l’observatoire de Paris, tandis
qu’il n’en est tombé que o,432 dans un récipient
pareil placé sur la terrasse de F observatoire,
27 mètres plus haut. Si le plus de verticalité des
filets de pluie , dans les endroits abrités des vents
n’est pas l ’unique cause de cette différence , elle
doit du moins y avoir une bien grande part ; il
est difficile même d’en concevoir une autre.
Le refroidissement que les couches inférieures
de l ’atmosphère éprouvent, principalement au