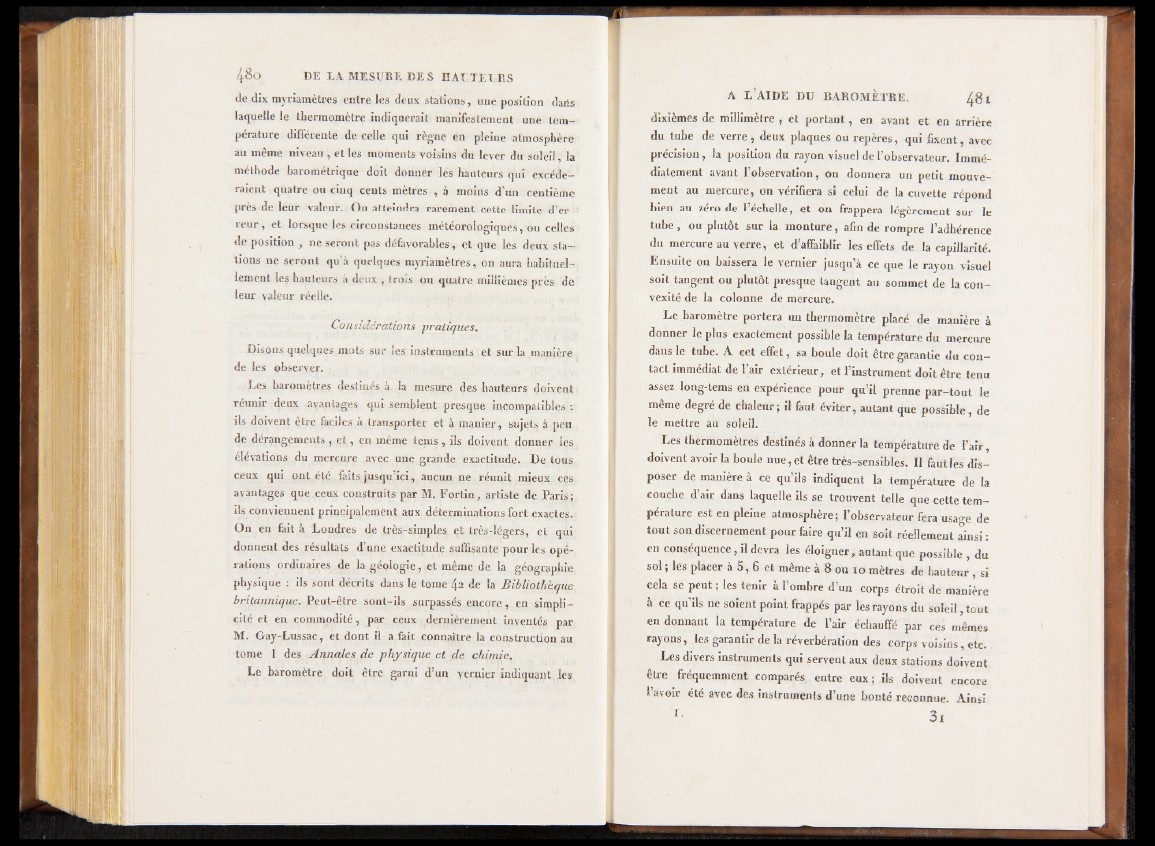
de dix myriamètres entre les deux stations, une position daiis
laquelle le thermomètre indiquerait manifestement une température
différente de celle qui règne en pleine atmosphère
au même niveau , et les moments voisins du lever du soleil, la
méthode barométrique doit donner les hauteurs qui excéderaient
quatre ou cinq cents mètres , a moins d’un centième
près de leur valeur. On atteindra rarement cette limite d’erreur,
et lorsque les circonstances météorologiques, ou celles
de position y ne seront pas défavorables, et que les deux stations
ne seront qu’à quelques myriamètres, on aura habituellement
les hauteurs à deux , trois ou quatre millièmes près de
leur valeur réelle.
Con sidérations pratiques.
Disons quelques mots sur les instruments et sur la manière
de les observer.
Les baromètres destinés à la mesure des hauteurs doivent
réunir deux avantages qui semblent presque incompatibles :
ils doivent être faciles à transporter et à manier, sujets à peu
de dérangements , e t , en même tems , ils doivent donner les
élévations du mercure avec une grande exactitude. De tous
ceux qui ont été faits jusqu’ici, aucun ne réunit mieux ces
avantages que ceux construits par M. Fortin, artiste de Paris;
ils conviennent principalement aux déterminations fort exactes.
On en fait à Londres de très-simples et très-légers, et qui
donnent des résultats d’une exactitude suffisante pour les opérations
ordinaires de la géologie, et même de la géographie
physique : ils sont décrits dans le tome 42 de la Bibliothèque
britannique. Peut-être sont-ils surpassés encore, en simplicité
et en commodité, par ceux dernièrement inventés par
M. Gay-Lussac, et dont il a fait connaître la construction au
tome I des Annales de physique et de chimie.
Le baromètre doit être garni d’un yernier indiquant les
a l ’a id e d u b a r o m è t r e . 4 8 1
dixièmes de millimètre , et portant, en avant et en arrière
du tube de verre , deux plaques ou repères, qui fixent, avec
précision, la position du rayon visuel de l’observateur. Immédiatement
avant l’observation, on donnera un petit mouvement
au mercure, on vérifiera si celui de la cuvette répond
bien au zéro de l ’échelle, et on frappera légèrement sur le
tube, ou plutôt sur la monture, afin de rompre l’adhérence
du mercure au verre, et d’afFaibiir les effets de la capillarité.
Ensuite on baissera le vernier jusqu’à ce que le rayon visuel
soit tangent ou plutôt presque tangent au sommet de la convexité
de la colonne de mercure.
Le baromètre portera un thermomètre placé de manière à
donner le plus exactement possible la température du mercure
dans le tube. A. cet effet, sa boule doit être garantie du contact
immédiat de l’air extérieur, et l’instrument doit être tenu
assez long-tems en expérience pour qu’il prenne par-tout le
même degré de chaleur; il faut éviter, autant que possible, de
le mettre au soleil.
Les thermomètres destinés à donner la température de l’air
doivent avoir la boule nue, et être très-sensibles. Il faut les disposer
de manière à ce qu’ ils indiquent la température de la
couche d’air dans laquelle ils se trouvent telle que cette température
est en pleine atmosphère; l’observateur fera usage de
tout son discernement pour faire qu’il en soit réellement ainsi :
en conséquence, il devra les éloigner, autant que possible , du
sol ; les placer à 5, 6 et même à 8 ou 10 mètres de hauteur , si
cela se peut ; les tenir à l’ombre d’un corps étroit de manière
à ce qu’ds ne soient point frappés par les rayons du soleil, tout
en donnant la température de l’air échauffé par ces mêmes
rayons, les garantir de la réverbération des corps voisins, etc.
Les divers instruments qui servent aux deux stations doivent
être fréquemment comparés, entre eux; ils doivent encore
l’avoir été avec des instrumenfs d’une bonté reconnue. Ainsi
1 3 i