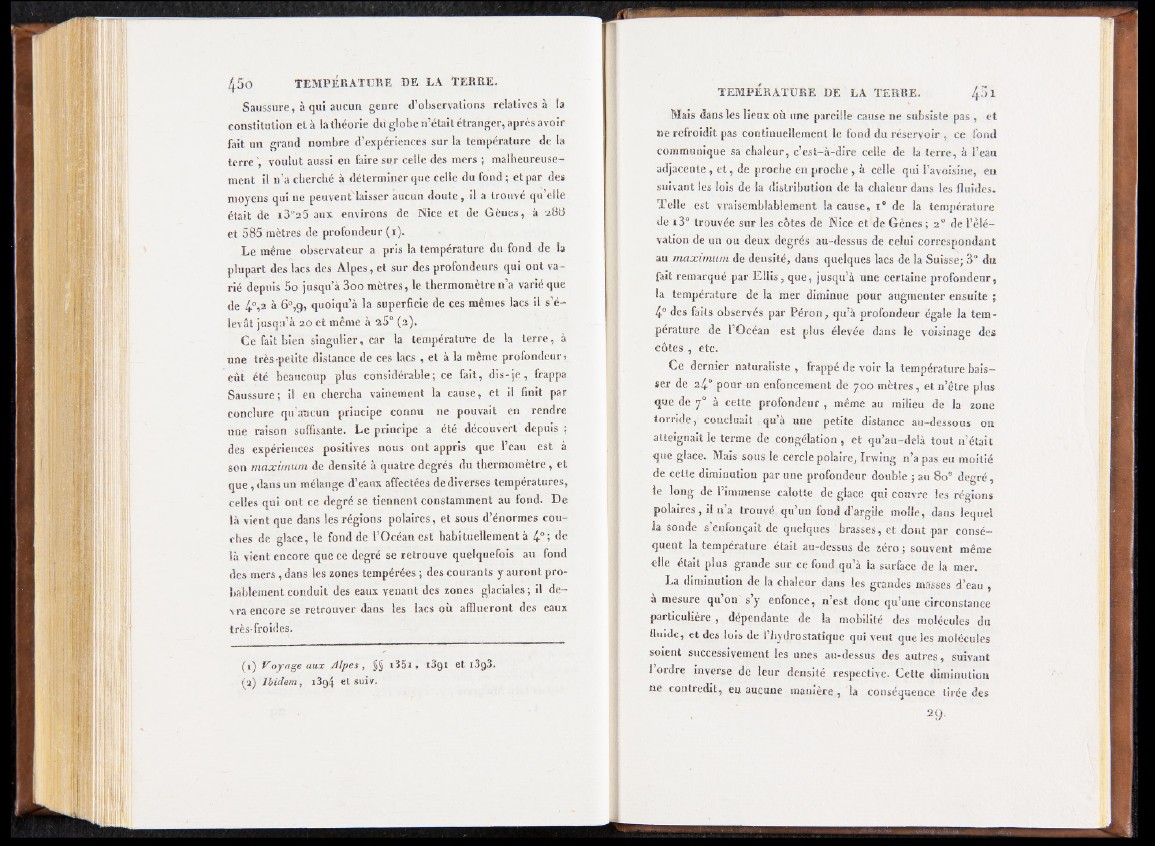
Saussure, à qui aucun genre d’observations relatives a la
constitution et à lathéorie dièglobe n’était étranger, après avoir
fait un grand nombre d’expériences sur la température de la
terre voulut aussi en faire sur celle des mers ; malheureusement
il n’a cherché à déterminer que celle du fond; et par des
moyens qui ne peuventdaisser aucun doute, il a trouvé qu’elle
était de i 3°25 aux. environs de Nice et de Gènes, à 288
et 585 mètres de profondeur (1).
Le même observateur a pris la température du fond de la
plupart des lacs des Alpes, et sur des profondeurs qui ont varié
depuis 5o jusqu’à 3oo mètres, le thermomètre n’a varié que
de 4°,2 à 6°,9, quoiqu’à la superficie de ces mêmes lacs il s’élevât
jusqu’ à 20 et même à a5° (2).
Ce fait bien singulier, car la température de la terre, à
une très-petite distance de ces lacs , et à la même profondeur,
eût été beaucoup plus considérable; ce fait, dis-je , frappa
Saussure; il en chercha vainement la cause, et il finit par
conclure qu’aucun principe connu ne pouvait en rendre
une raison suffisante. Le principe a été découvert depuis ;
des expériences positives nous ont appris que l’eau est à
son maximum de densité à quatre degrés du thermomètre , et
que , dans un mélange d’eaux affectées de diverses températures,
celles qui ont ce degré sé tiennent constamment au fond. De
là vient que dans les régions polaires, et sous d’énormes couches
de glace, le fond de l’Océan est habituellement à 4°; de
là vient encore que ce degré se retrouve quelquefois au fond
des mers , dans les zones tempérées ; des courants y auront probablement
conduit des eaux venant des zones glaciales ; il devra
encore se retrouver dans les lacs où afflueront des eaux
très-froid es.
(1) Voyage aux Alpes , §§ i 35i , i 3()i et i 3g3.
(2.) Ibidem, i 3g4 et suiv.
4 t)l
Mais dans les lieux où une pareille cause ne subsiste pas , et
ne refroidit pas continuellement le fond du réservoir , ce fond
communique sa chaleur, c’est-à-dire celle de la terre, à l’eau
adjacente , e t , de proche en proche , à celle qui l’avoisine, eu
suivant les lois de la distribution de la chaleur dans les fluides.
Telle est vraisemblablement la cause, i° de la température
de i 3° trouvée sur les côtes de Nice et de Gènes ; 20 de l’élévation
de un ou deux degrés au-dessus de celui correspondant
au maximum de densité, dans quelques lacs de la Suisse; 3° du
fait remarqué par E llis, que, jusqu’à une certaine profondeur,
la température de la mer diminue pour augmenter ensuite ;
4° des faits observés par Péron, qu’à profondeur égale la température
de l’Océan est plus élevée dans le voisinage des
côtes , etc.
Ce dernier naturaliste , frappé de voir la température baisser
de 24° pour un enfoncement de 700 mètres, et n’être plus
que de 70 à cette profondeur , même au milieu de la zone
torride, concluait qu’à une petite distance au-dessous on
atteignait le terme de congélation , et qu’au-delà tout 11’était
que glace. Mais sous le cercle polaire, Irwing n’a pas eu moitié
de cette diminution par une profondeur double ; au 80e degré,
le long de l’immense calotte de glace qui couvre les régions
polaires, il n’a trouvé qu’un fond d’argile molle, dans lequel
la sonde s’enfonçait de quelques brasses, et dont par conséquent
la température était au-dessus de zéro ; souvent même
elle était plus grande sur ce fond qu’à la surface de la mer.
La diminution de la chaleur dans les grandes masses d’eau ,
a mesure qu on s y enfonce, n est donc qu’une circonstance
particulière , dépendante de la mobilité des molécules du
fluide, et des lois de 1 hydrostatique qui veut que les molécules
soient successivement les unes au-dessus des autres, suivant
1 ordre inverse de leur densité respective. Cette diminution
ae contredit, eu aucune manière, la conséquence tirée des