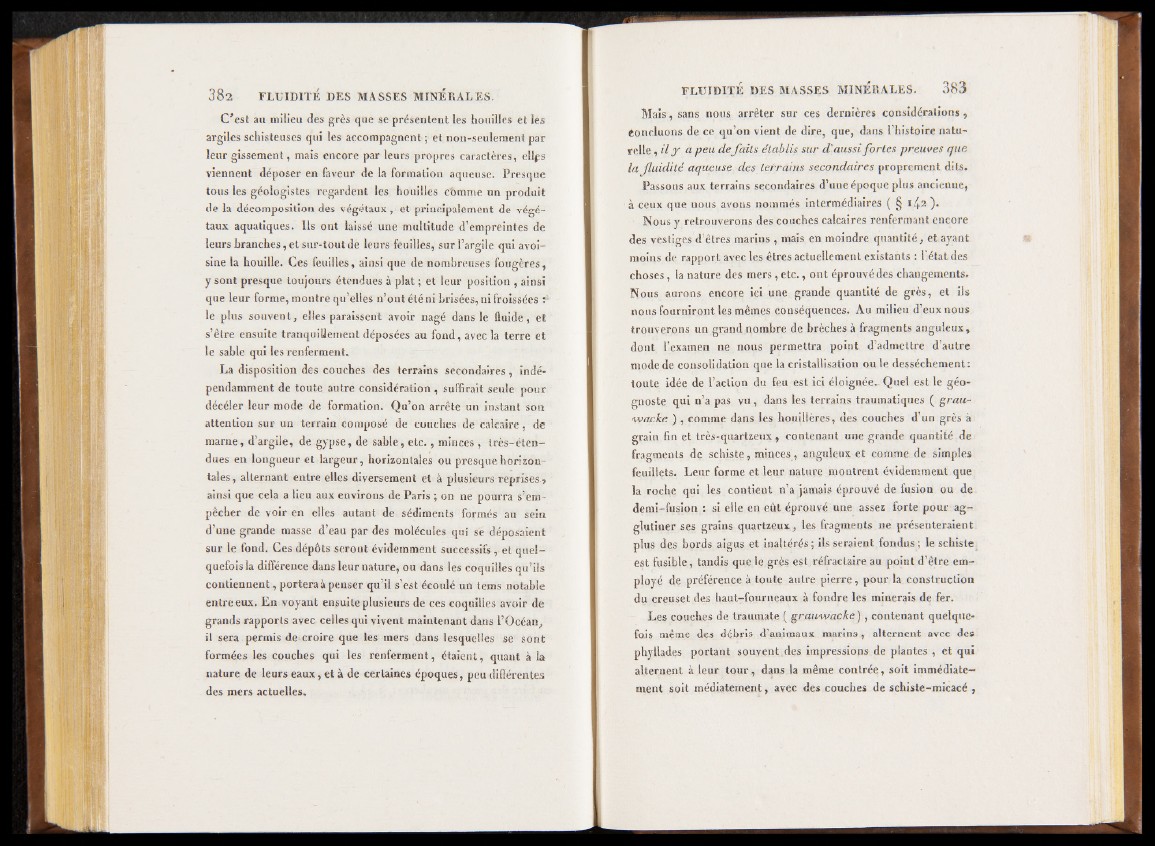
C'est au milieu des grès que se présentent les houilles et les
argiles schisteuses qui les accompagnent ; et non-seulement par
leur gissement, mais encore par leurs propres caractères, ell^s
viennent déposer en faveur de la formation aqueuse. Presque
tous les géologistes regardent les houilles cfomme un produit
de la décomposition des végétaux, et principalement de végétaux
aquatiques. Ils ont laissé une muUitude d’empreintes de
leurs branches, et sur-tout de leurs feuilles, sur l’argile qui avoisine
la houille. Ces feuilles, ainsi que de nombreuses fougères,
y sont presque toujours étendues à plat ; et leur position , ainsi
que leur forme, montre qu’elles n’ont été ni brisées, ni froissées r;
le plus souvent, elles paraissent avoir nagé dans le fluide, et
s’être ensuite tranquillement déposées au fond, avec la terre et
le sable qui les renferment.
La disposition des couches des terrains secondaires, indépendamment
de toute autre considération, suffirait seule pour
décéler leur mode de formation. Qu’on arrête un instant son
attention sur un terrain composé de couches de calcaire, de
marne, d’argile, de gypse, de sable, e tc ., minces , très-étendues
en longueur et largeur, horizontales ou presque horizontales,
alternant entre elles diversement et à plusieurs reprises ,
ainsi que cela a lieu aux environs de Paris ; on ne pourra s’empêcher
de voir en elles autant de sédiments formés au sein
d’une grande masse d’eau par des molécules qui sè déposaient
sur le fond. Ces dépôts seront évidemment successifs , et quelquefois
la différence dans leur nature, ou dans les coquilles qu’ils
contiennent, porterai penser qu’il s’est écoulé un tems notable
entre eux. En voyant ensuite plusieurs de ces coquilles avoir de
grands rapports avec celles qui vivent maintenant dans l’Océan,
il sera permis de croire que les mers dans lesquelles se sont
formées les couches qui les renferment, étaient, quant à la
nature de leurs eaux, et à de certaines époques, peu différentes
des mers actuelles.
Mais, sans nous arrêter sur ces dernières considérations,
Concluons de ce qu’on vient de dire, que, dans l’histoire naturelle
, i l y a p eu de fa i t s établis sur d 'au ssi fo r te s pr euv es qu e
la f lu id i t é aqueuse des terrains secondaires proprement dits.
Passons aux terrains secondaires d’une époque plus ancienne,
à ceux que nous avons nommés intermédiaires ( § i 4-2 ).
Nous y retrouverons des couches calcaires renfermant encore
des vestiges d’êtres marins , mais en moindre quantité, et ayant
moins de rapport avec les êtres actuellement existants : l'état des
choses, la nature des mers, etc., ont éprouvé des changements.
Nous aurons encore ici une grande quantité de grès, et ils
nous fourniront les mêmes conséquences. Au milieu d’eux nous
trouverons un grand nombre de brèches à fragments anguleux,
dont l’examen ne nous permettra point d’admettre d’autre
mode de consolidation que la cristallisation ouïe dessèchement:
toute idée de l’action du feu est ici éloignée- Quel est le géo-
gnoste qui n’a pas v u , dans les terrains traumatiques ( g r a u -
w a ck e ) , comme dans les houillères, des couches d’un grès à
grain fin et très-quartzeux, contenant une grande quantité de
fragments de schiste, minces, anguleux et comme de simples
feuillets. Leur forme et leur nature montrent évidemment que
la roche qui les contient n’a jamais éprouvé de fusion ou de
demi-fusion : si elle en eût éprouvé une assez forte pour agglutiner
ses grains quartzeux, les fragments ne présenteraient
plus des bords aigus et inaltérés; ils seraient fondus; le schiste
est fusible, tandis que le grès est réfractaire au point d’être employé
de préférence à toute autre pierre, pour la construction
du creuset des haut-fourneaux à fondre les minerais de fer.
Les couches de traumate ( g r a uw a c k e ) , contenant quelquefois
même des débris d’animaux marins, alternent avec des
phyllades portant souvent des impressions de plantes , et qui
alternent à leur tour, dans la même contrée, soit immédiatement
soit médiatement, avec des couches de schiste-micacé ,