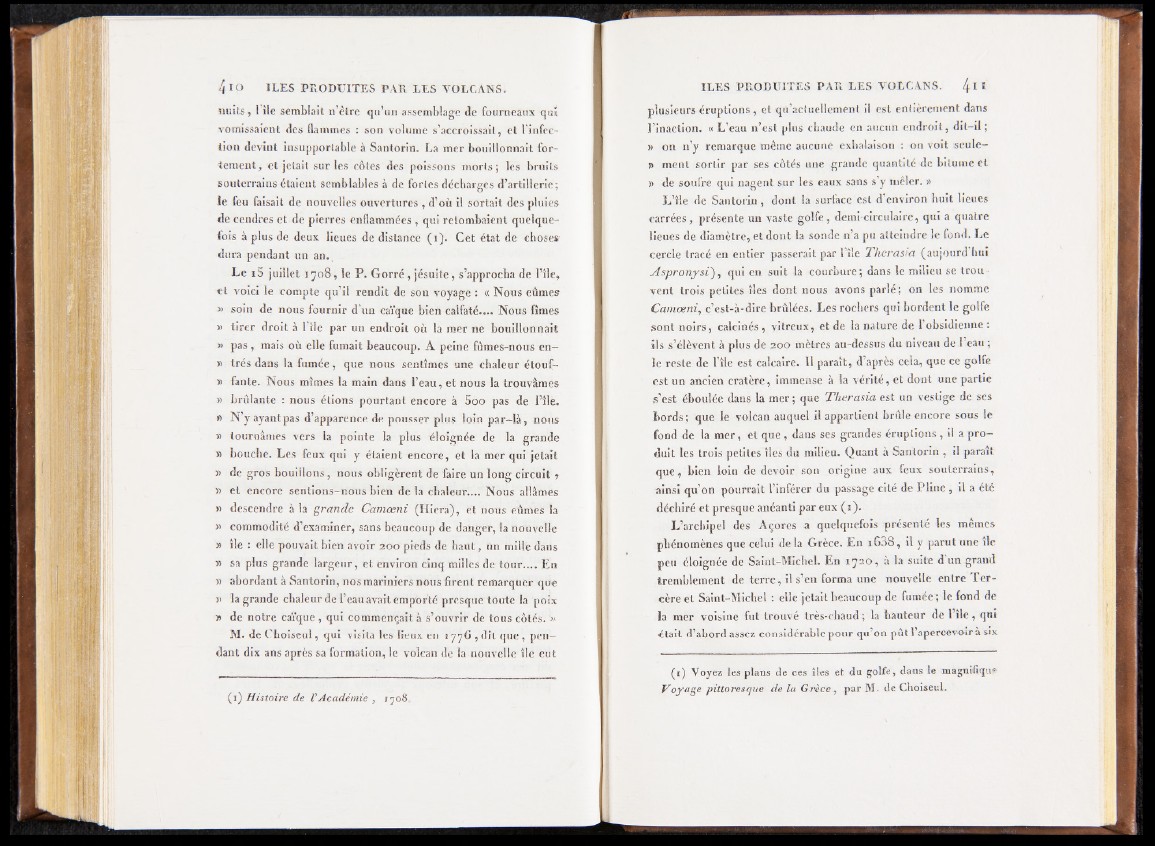
nuits, lêle semblait n’être qu’un assemblage de fourneaux qui
vomissaient des flammes : son volume s’accroissait, et l’infection
devint insupportable à Santorin. La mer bouillonnait fortement,
et jetait sur les côtes des poissons morts; les bruits
souterrains étaient semblables à de fortes décharges d’artillerie;
le feu faisait de nouvelles ouvertures , d’où il sortait des pluies
de cendres et de pierres enflammées , qui retombaient quelquefois
à plus de deux lieues de distance ( i ) . Cet état de choses
dura pendant un an.,
Le i 5 juillet 1708, le P. Gorré , jésuite, s’approcha de l’îîe,
et voici le compte qu’il rendit de son voyage : « Nous eûmes
» soin de nous fournir d’un caïque bien calfaté.... Nous fîmes
» tirer droit à 1 île par un endroit où la mer ne bouillonnait
» pas, mais où elle fumait beaucoup. A peine fûmes-nous en-
» trés dans la fumée, que nous sentîmes une chaleur étouf-
» fante. Nous mîmes la main dans l’eau, et nous la trouvâmes
y> brûlante : nous étions pourtant encore à 5oo pas de l’île.
» N’y ayant pas d’apparence de pousser plus loin par-là, nous
» tournâmes vers la pointe la plus éloignée de la grande
» bouche. Les feux qui y étaient encore, et la mer qui jetait
» de gros bouillons, nous obligèrent de faire un long circuit y
» et encore sentions-nous bien de la chaleur.... Nous allâmes
» descendre à la grande Camoeni (Hiera), et nous eûmes la
» commodité d’examiner, sans beaucoup de danger, la nouvelle
» île : elle pouvait bien avoir 200 pieds de haut, un mille dans
» sa plus grande largeur, et environ cinq milles de tour.... En
» abordant à Santorin, nos mariniers nous firent remarquer que
« la grande chaleur de l’ eau avait emporté presque toute la poix
» de notre carque , qui commençait à s’ouvrir de tous côtés. »
M. de Choiseul, qui visita les lieux en 1776 , dit que , pendant
dix ans après sa formation, le volcan de la nouvelle île eut
(1) Histoire de VAcadémie , 1708,
plusieurs éruptions, et qu’actuellement il est entièrement dans
l ’inaction. « L’eau n’est plus chaude en aucun endroit, dit-il ;
» on n’y remarque même aucune exhalaison : on voit seule-
» ment sortir par ses côtés une grande quantité de bitume et
» de soufre qui nagent sur les eaux sans s’y mêler. »
L ’île de Santorin , dont la surface est d’environ huit lieues
carrées, présente un vaste golfe, demi-circulaire, qui a quatre
lieues de diamètre, et dont la sonde n’a pu atteindre le fond. Le
cercle tracé en entier passerait par l’île Therasia (aujourd hui
Aspronysi) , qui en suit la courbure; dans le milieu se trou
vent trois petites îles dont nous avons parlé ; on les nomme
Camoeni, c’est-à-dire brûlées. Les rochers qui bordent le golfe
sont noirs, calcinés, vitreux, et de la nature de l’obsidienne:
ils s’élèvent à plus de 200 mètres au-dessus du niveau de l’eau ;
le reste de l’île est calcaire. Il paraît, d’après cela, que ce golfe
est un ancien cratère, immense à la vérité, et dont une partie
s’est éboulée dans la mer ; que Therasia est un vestige de ses
bords ; que le volcan auquel il appartient brûle encore sous le
fond de la mer, et que , dans ses grandes éruptions, il a produit
les trois petites îles du milieu. Quant à Santorin , il paraît
que, bien loin de devoir sou origine aux feux souterrains,
ainsi qu’on pourrait l’inférer du passage cité de Pline , il a été
déchiré et presque anéanti par eux (1).
L ’archipel des Açores a quelquefois présenté les mêmes
phénomènes que celui delà Grèce. En i 638, il y parut une de
peu éloignée de Saint-Michel. En 1720, à la suite d’un grand
tremblement de terre, il s’ en forma une nouvelle entre Ter-
cère et Saint-Michel : elle jetait beaucoup de fumée ; le fond de
la mer voisine fut trouvé très-chaud ; la hauteur de l’île , qui
était d’abord assez considérable pour qu’011 pût l’apercevoir à six
(1) Voyez les plans de ces îles et du golfe, dans le magnifique
Voyage pittoresque de là Grèce, par M- de Choiseul.