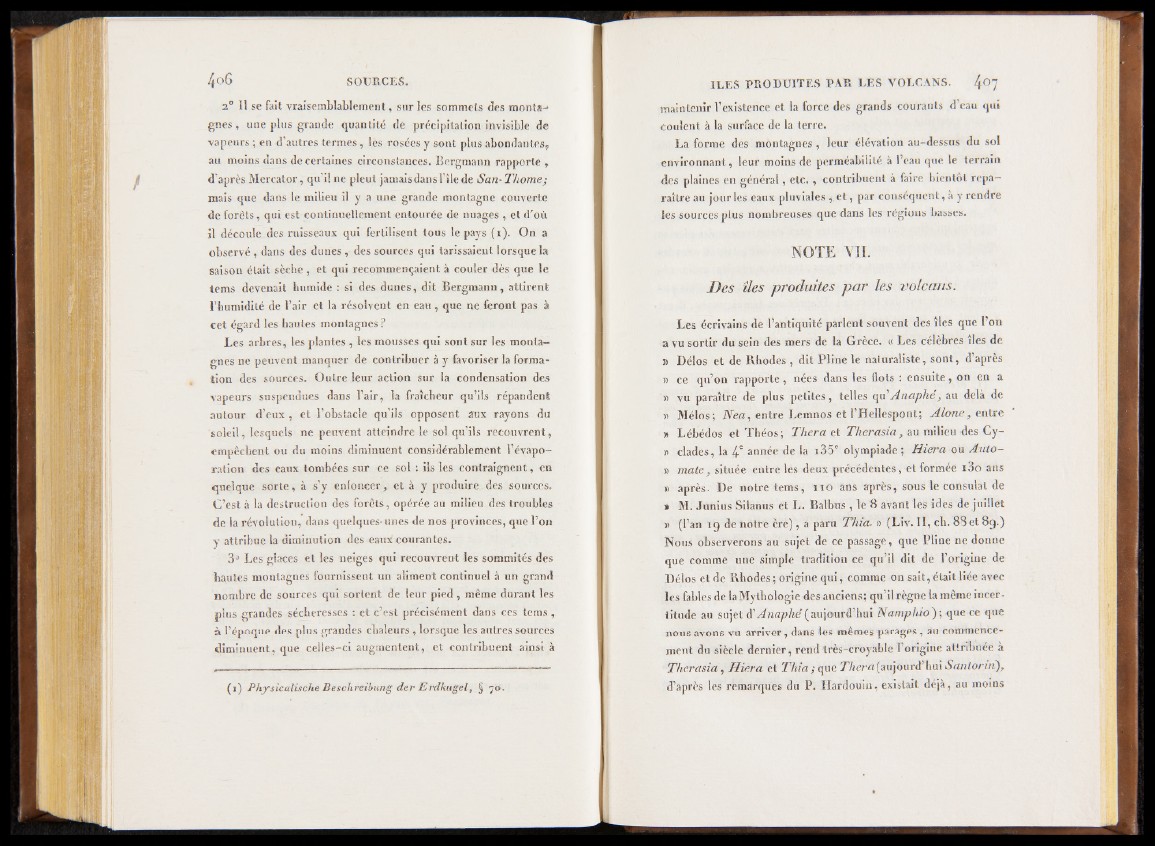
2° Il se fait vraisemblablement, sur les sommets des montagnes
, une plus grande quantité dé précipitation invisible de
vapeurs ; en d’autres termes, lés rosées y sont plus abondantes,
au moins dans de certaines circonstances. Bergmann rapporte ,
d'après Mercator, qu’il ne pleut jamais dans l’ile de San-Thome;
mais que dans le milieu il y a une grande montagne couverte
de forêts, qui est continuellement entourée de nuages , et d’où
il découle des ruisseaux qui fertilisent tous le pays ( i). On a
observé , dans des dunes, des sources qui tarissaient lorsque la
saison était sècbe , et qui recommençaient à couler dès que le
tems devenait humide : si des dunes, dit Bergmann, attirent
l ’humidité de l’air et la résolvent en eau , que ne feront pas à
cet égard les hautes montagnes ?
Les arbres, les plantes , les mousses qui sont sur les montagnes
ne peuvent manquer de contribuer à y favoriser la formation
des sources. Outre leur action sur la condensation des
vapeurs suspendues dans l’air, la fraîcheur qu’ils répandent
autour d’eux , et l’obstacle qu’ils opposent aux rayons du
soleil, lesquels ne peuvent atteindre le sol qu’ils recouvrent,
empêchent ou du moins diminuent considérablement l’évaporation
des eaux tombées sur ce sol : ils les contraignent, en
quelque sorte, à s’y enfoncer, et à y produire des sources.
C ’est à la destruction des forêts, opérée au milieu des troubles
de la révolution, dans quelques-unes de nos provinces, que l’on
v attribue J la diminution des eaux courantes. 33 Les glaces et les neiges qui recouvrent les sommités des
hautes montagnes fournissent un aliment continuel à un grand
nombre de sources qui sortent de leur pied, même durant les
plus grandes sécheresses : et c’est précisément dans ces tems,
à l’époque des plus grandes chaleurs , lorsque les autres sources
diminuent, que celles-ci augmentent, et contribuent ainsi à
( i ) Physïcalische Beschreibung der E rd ku ge l, § 70.
maintenir l’existence et la force des grands courants d’eau qui
coulent à la surface de la terre.
La forme des montagnes, leur élévation au-dessus du sol
environnant, leur moins de perméabilité à l’eau que le terrain
des plaines en général, etc. , contribuent à faire bientôt reparaître
au jour les eaux pluviales e t , par conséquent, à y rendre
les sources plus nombreuses que dans les régions basses.
NOTE VII.
Des îles produites par les volcans.
Les écrivains de l’antiquité parlent souvent des îles que l’on
a vu sortir du sein des mers de la Grèce. « Les célèbres îles de
» Délos et de Rhodes, dit Pline le naturaliste, sont, d’après
» ce qu’on rapporte, nées dans les flots : ensuite, on en a
» vu paraître de plus petites, telles qu’Anaphé, au delà de
» Mélos; Nea, entre Lemnos et l’Hellespont; Alone, entre
» Lébédos et Théos ; Thera et Therasia, au milieu des Cy-
» clades, la année de la i 35e olympiade; Hiera ou Auto-
» mate, située entre les deux précédentes, et formée i 3o ans
» après. De notre temsi 110 ans après, sous le consulat de
» M. Junius Silanus et L. Balbos , le 8 avant les ides de juillet
y> (l’an 19 de nôtre ère), a paru Thia. » (Liv. II, cb. 83 et 8g.)
Nous observerons au sujet de ce passage, que Pline ne donne
que comme une simple tradition ce qu’il dit de l’origine de
Délos et de Rhodes; origine qui, comme on sait, était liée avec
les fables de la Mythologie des anciens; qu’il règne la même incertitude
au sujet d'Anaphé(aujourd’hui Natnphio); que ce que
nous avons vu arriver, dans les mêmes parages, au commencement
du siècle dernier, rend très-croyable l’origine attribuée a
Therasia, Hiera et Thia ; que Thera (aujourd’ Lui Santorin),
d’après les remarques du P. Hardouin, existait déjà, au moins