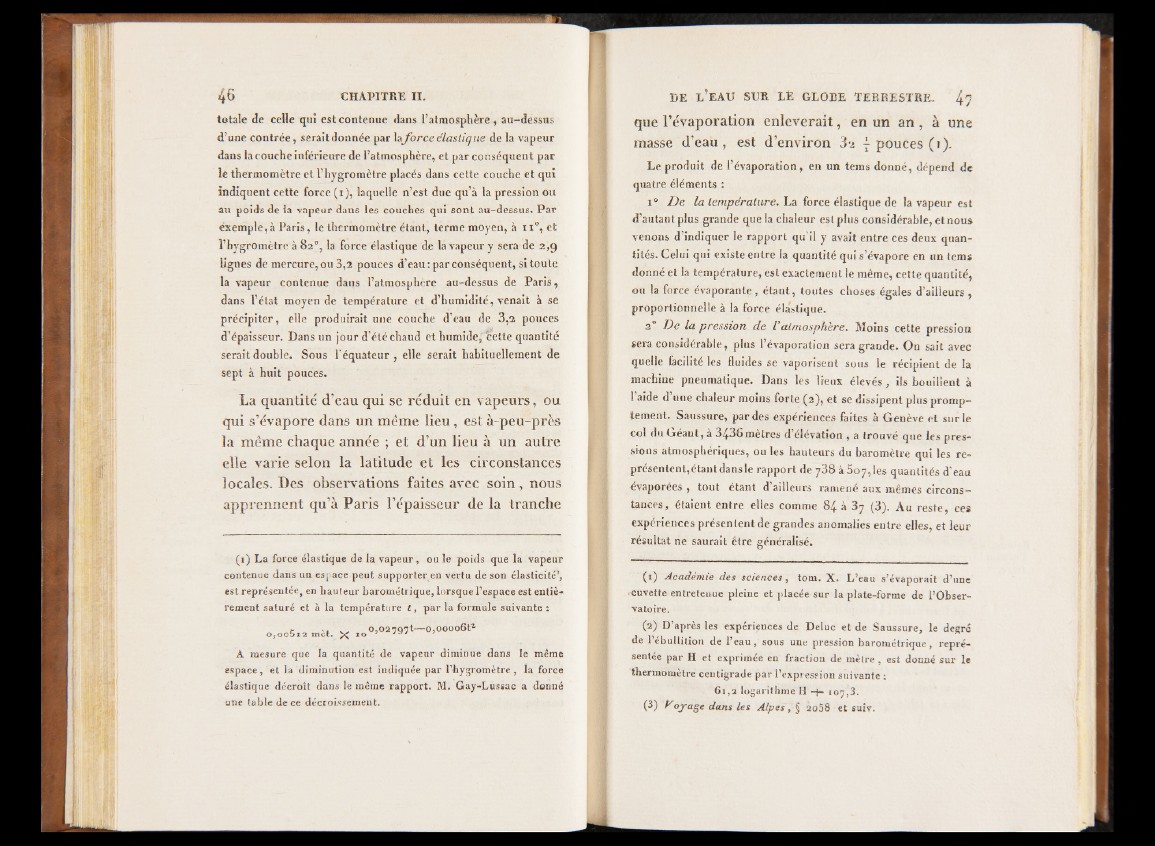
totale de celle qui est contenue dans l’atmosphère, au-dessus
d’une contrée, serait donnée par laforce élastique de la vapeur
dans la couche inférieure de l’atmosphère, et par conséquent par
le thermomètre et l’hygromètre placés dans cette couche et qui
indiquent cette force (i), laquelle n’est due qu’à la pression ou
au poids de la vapeur dans les couches qui sont au-dessus. Par
exemple,à Paris, le thermomètre étant, terme moyen, à i i °, et
l’hygromètre à 82°, la force élastique de la vapeur y sera de 2,9
ligues de mercure, ou 3,2 pouces d’eau: par conséquent, si toute
la vapeur contenue dans l’atmosphère au-dessus de Paris,
dans l’état moyen de température et d’humidité, venait à se
précipiter, elle produirait une couche d’eau de 3,2 pouces
d’épaisseur. Dans un jour d’été chaud et humide," celte quantité
serait double. Sous l'équateur, elle serait habituellement de
sept à huit pouces.
La quantité d’eau qui se réduit en vapeurs, ou
qui s’évapore dans un meme lieu, est à-peu-près
la même chaque année ; et d’un lieu à un autre
elle varie selon la latitude et les circonstances
locales. Des observations faites avec soin, nous
apprennent qu’à Paris l’épaisseur de la tranche
(1) La force élastique de la vapeur, ouïe poids que la vapeur
contenue dans un espace peut supporter en vertu de son élasticité’,
est représentée> en hauteur barométrique, lorsque l’espace est entièrement
saturé et à la température t , par la formule suivante :
e ' l w 0 ,0 2 7 0 7 1— O.OOOOÔt1 1 o,oo5i2 met. X 10
À mesure que la quantité de vapeur diminue dans le même
espace, et la diminution est indiquée par l’hygromètre , la force
élastique décroît dans le même rapport. M. Gay-Lussac a donné
une table de ce décroissement.
DE L ’EAU SUR LE GLOBE TERRESTRE. 4 7
que l ’évaporation enlèverait, en un an , à une
masse d’eau, est d’environ 3-2 7 pouces (1).
Le produit de l’évaporation, en un tems donné, dépend de
quatre éléments :
i° De la température. La force élastique de la vapeur est
d’autant plus grande que la chaleur est plus considérable, et nous
venons d’indiquer le rapport qu'il y avait entre ces deux quantités.
Celui qui existe entre la quantité qui s’évapore en un tems
donné et la température, est exactement le même, cette quantité,
ou la force évaporante, étant, toutes choses égales d’ailleurs,
proportionnelle à la force élastique.
20 De la pression de l atmosphère. Moins cette pression
sera considérable, plus l’évaporation sera grande. On sait avec
quelle facilité les fluides se vaporisent sous le récipient de la
machine pneumatique. Dans les lieux élevés, ils bouillent à
l’aide d’une chaleur moins forte (2), et se dissipent plus promptement.
Saussure, par des expériences faites à Genève et sur le
col du Géant, à 34.36mètres d’élévation , a trouvé que les pressions
atmosphériques, ou les hauteurs du baromètre qui les représentent,
étant dans le rapport de y38 à 5oy,Ies quantités d’eau
évaporées , tout étant d’ailleurs ramené aux mêmes circonstances,
étaient entre elles comme 84. à 37 (3). Au reste, ces
expériences présentent de grandes anomalies entre elles, et leur
résultat ne saurait être généralisé.
(1) Académie des sciences, tom. X. L ’eau s’évaporait d’une
cuvette entretenue pleine et placée sur la plate-forme de l’Observatoire.
(2) D’après les expériences de Deluc et de Saussure, le degré
de l’ébullition de l’ eau, sous une pression barométrique, représentée
par H et exprimée en fraction de mètre , est donné sur le
thermomètre centigrade par l’expression suivante ;
61,2 logarithme H -f- io 7,3.
(3) Voyage dans les Alpes , § 2o58 et suiv.