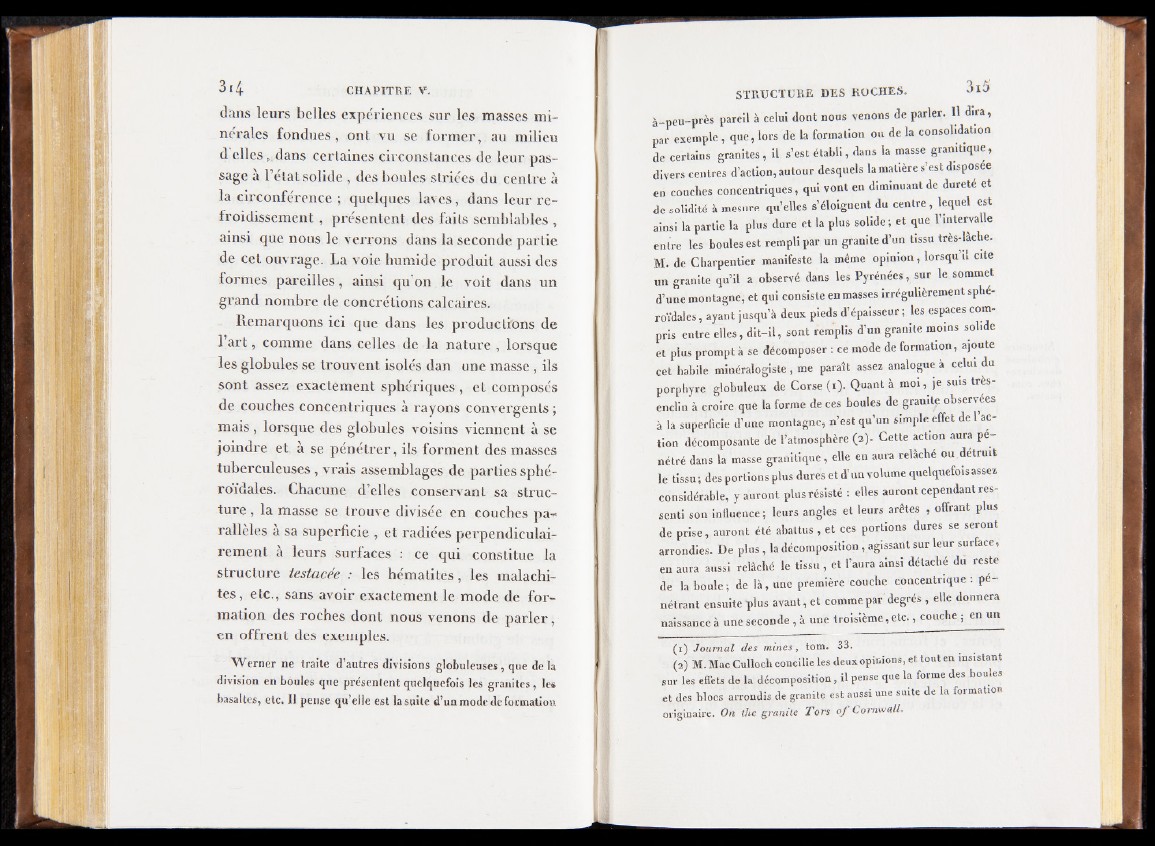
dans leurs belles expériences sur les masses minérales
fondues, ont vu se former, au milieu
d elles „ dans certaines circonstances de leur passage
à l’état solide , des boules striées du centre à
la circonférence ; quelques laves, dans leur refroidissement
, présentent des faits semblables ,
ainsi que nous le verrons dans la seconde partie
de cet ouvrage. La voie humide produit aussi des
formes pareilles, ainsi qu’on le voit dans un
grand nombre de concrétions calcaires.
Remarquons ici que dans les productions de
l’ar t, comme dans celles de la nature , lorsque
les globules se trouvent isolés dan une masse, ils
sont assez exactement sphériques, et composés
de couches concentriques à rayons convergents ;
mais , lorsque des globules voisins viennent à se
joindre et à se pénétrer, ils forment des masses
tuberculeuses, vrais assemblages de parties sphé-
roïdales. Chacune d’elles conservanl sa structure
, la masse se trouve divisée en couches pa-
rallèles a sa superficie , et radiées perpendiculairement
à leurs surfaces : ce qui constitue la
structure testacée : les hématites, les malachites,
etc., sans avoir exactement le mode de formation
des roches dont nous venons de parler,
en offrent des exemples.
Werner ne traite d’autres divisions globuleuses, que delà
division en boules que présentent quelquefois les granites, les
basaltes, etc. Il pense qu’elle est la suite d’un mode de formation
à-peu-près pareil à celui dont nous venons de parler. 11 dira,
par exemple , que, lors de la formation ou de la consolidation
de certains granités, il s’est établi, dans la masse granitique,
divers centres d’action, autour desquels la matière s est disposée
en couches concentriques, qui vont en diminuant de durete et
de solidité à mesure qu’elles s’éloignent du centre, lequel est
ainsi la partie la plus dure et la plus solide ; et que l’interval e
entre les boules est rempli par un granité d’un tissu très-lache.
M. de Charpentier manifeste la même opinion, lorsqu’il cite
un granité qu’il a observé dans les Pyrénées, sur le sommet
d’une montagne, et qui consiste en masses irrégulièrement sphé-
roïdales, ayant jusqu’à deux pieds d’épaisseur; les espaces compris
entre elles, d it- il, sont remplis d’un granité moins solide
et plus prompt à se décomposer : ce mode de formation, ajoute
cet habile minéralogiste, me parait assez analogue a celui du
porphyre globuleux de Corse (i) . Quant à moi, je suis très-
enclin à croire que la forme de ces boules de granité observées
à la superficie d’une montagne, n’est qu’un simple effet de l’action
décomposante de l’atmosphère (2). Cette action aura pe
nétré dans la masse granitique , elle en aura relâché ou détruit
le tissu ; des portions plus dures et d’un volume quelquefois assez
considérable, y auront plus résisté : elles auront cependant ressenti
son intluence; leurs angles et leurs arêtes , offrant plus
de prise, auront été abattus , et ces portions dures se seront
arrondies. De plus , la décomposition, agissant sur leur surface,
en aura aussi relâché le tissu, et l’aura ainsi détaché du reste
de la boule; de là, une première couche concentrique : pénétrant
ensuite plus avant, et comme par degrés , elle donnera
naissance à une seconde , à une troisième, etc., couche ; en
( 1 ) Journal des mines, tom . 3 3 .
(2) M . M a c C u l lo c h c o n c i l ie le s d e u x o p in io n s , e t to u t en in s is ta n t
su r le s e ffe ts d e la d é c om p o s it io n , i l p en se que la fo rm e d e s b o u le s
e t d es b lo c s a r r o n d is d e g r a n ité e s t a u s s i u ne su ite d e la fo rm a t io n
o r ig in a ir e . On the granité T ors o f Cornwall.