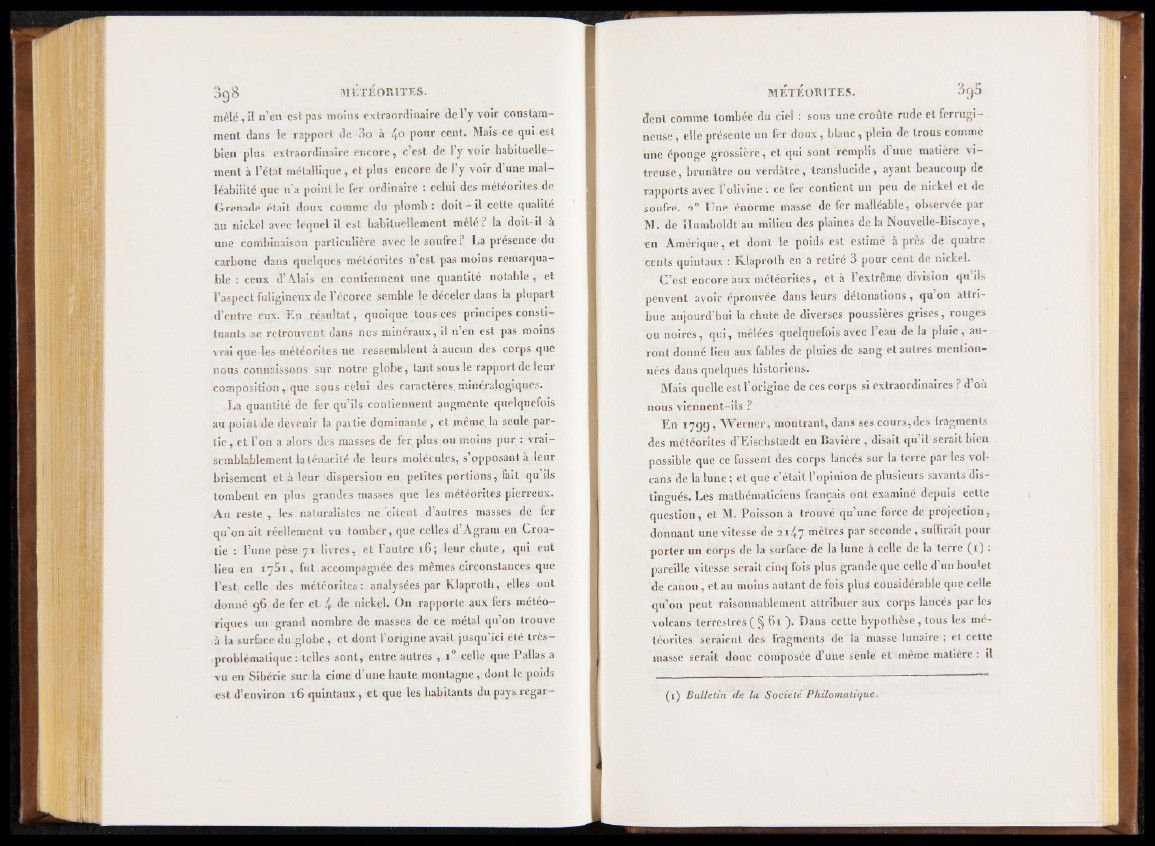
mêlé, il n’en est pas moins extraordinaire de l’y voir constamment
dans le rapport de 3o à 4° pour cent. Mais ce qui est
bien plus extraordinaire encore, c’est de l’y voir habituellement
à l’état métallique, et plus encore de l’y voir d’une malléabilité
que n’a point le fer ordinaire : celui des météorites de
Grenade était doux comme du plomb: d oit-il cette qualité
au nickel avec lequel il est habituellement mêlé ? la doit-il à
une combinaison particulière avec le soufre ? La présence du
carbone dans quelques météorites n’est pas moins remarquable
: ceux d’Alais en contiennent une quantité notable, et
l’aspect fuligineux de l’écorce semble le déceler dans la plupart
d’entre eux. En résultat, quoique tous ces principes constituants
se retrouvent dans nos minéraux, il n’en est pas moins
vrai que les météorites ne ressemblent à aucun des corps que
nous connaissons sur notre globe, tant sous le rapport de leur
composition, que sous celui des caractères minéralogiques.
La quantité de fer qu’ils contiennent pigmente quelquefois
au point de devenir la partie dominante, et même, la seule partie,
et l’on a alors des masses de fer. pîus ou moins pur : vraisemblablement
la ténacité de leurs molécules, s’opposant à leur
brisement et à leur dispersion en petites portions, fait qu’ils
tombent en plus grandes masses que les météorites pierreux.
Au reste , les naturalistes ne citent d’autres masses de fer
qu’on ait réellement vu tomber, que celles d’Agr^m en Croatie
: l’une pèse 71 livres, et l’autre 16; leur chute, qui eut
lieu en 1751, fut accompagnée des mêmes circonstances que
l’est celle des météorites: analysées par Klaproth, elles ont
donné 96 de fer et. 4 de nickel. On rapporte aux fers météoriques
un grand nombre de masses de ce métal qu’on trouve
à la surlace du globe, et dont l’origine avait jusqu’ici été très-
problématique : telles sont, entre autres , i° celle que Pallas a
vu en Sibérie sur la cime d’une haute montagne, dont le poids
est d’environ 16 quintaux, et que les habitants du pays regardent
comme tombée du ciel : sous une croûte rude et ferrugineuse,
elle présente un fer doux, blanc, plein de trous comme
une éponge grossière, et qui sont remplis d’une matière vitreuse,
brunâtre ou verdâtre, translucide, ayant beaucoup de
rapports avec i’olivine : ce fer contient un peu de nickel et de
soufre. 20 Une énorme masse de fer malléable, observée par
M. de Humboldt au milieu des plaines de la Nouvelle-Biscaye,
en Amérique, et dont le poids est estimé à près de quatre
cents quintaux : KJaproth en a retire 3 pour cent de nickel.
C’est encore aux météorites, et à l’extrême division qu’ils
peuvent avoir éprouvée dans leurs détonations , cju on attribue
aujourd’hui la chute de diverses poussières grises, rouges
ou noires, qui, mêlées quelquefois avec l’eau de la pluie, auront
donné lieu aux fables de pluies de sang et autres mentionnées
dans quelques historiens.
Mais quelle est l’origine de ces corps si extraordinaires ? d’où
nous viennent-ils ?
En 1799 , Werner, montrant, dans ses cours,des fragments
des météorites d’Eischstædt en Bavière , disait qu’il serait bien
possible que ce fussent des corps lancés sur la terre par les volcans
de la lune ; et que c’était l’opinion de plusieurs savants distingués.
Les mathématiciens français O S ont examiné depuis cette
question, et M. Poisson a trouvé qu’une force de projection,
donnant une vitesse de 2x47 mètres par seconde , suffirait pour
porter un corps de la surface de la lune à celle de la terre (1) :
pareille vitesse serait cinq fois plus grande que celle d’un boulet
de canon , et au moins autant de fois plus considérable que celle
qu’on peut raisonnablement attribuer aux corps lancés par les
volcans terrestres ( § 61 ). Dans cette hypothèse , tous les météorites
seraient des fragments de la masse lunaire ; et cette
masse serait donc composée d’une seule et -même matière : il
(1) Bulletin de la Société Philomatique.