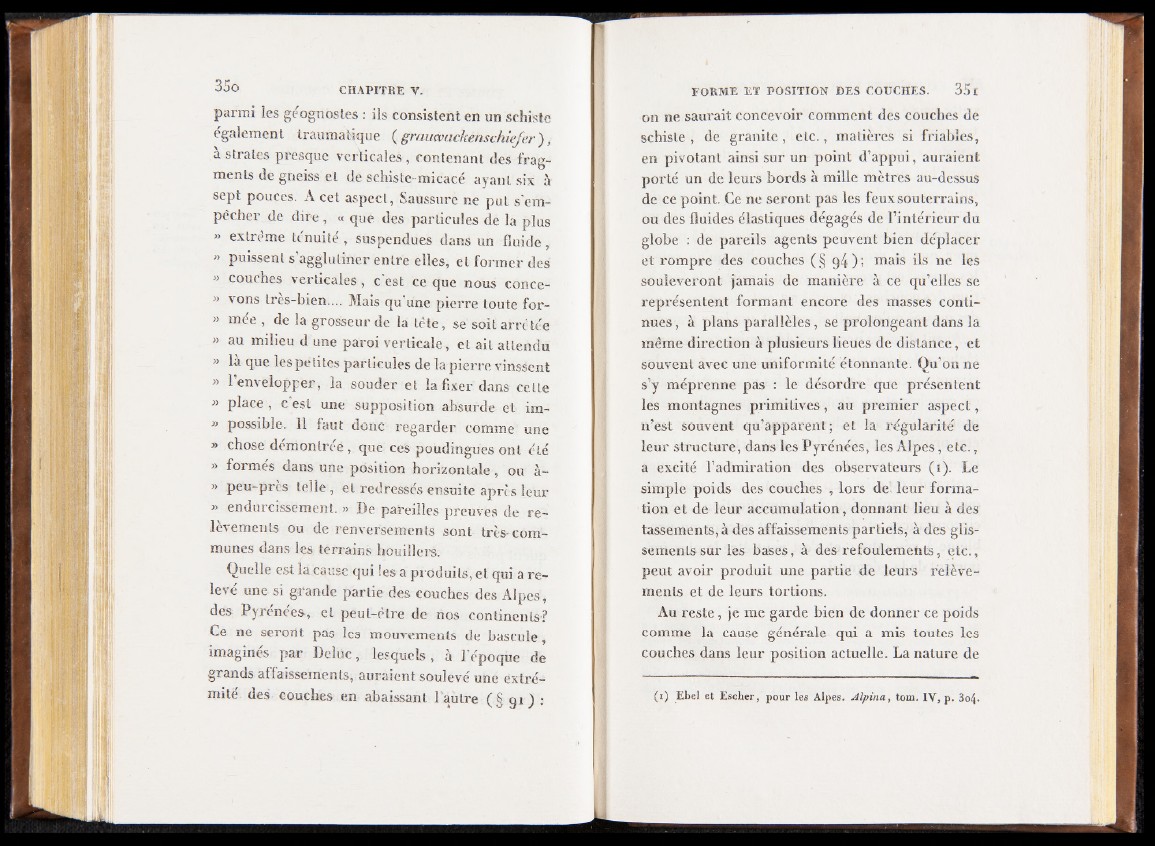
parmi les géognostes : ils consistent en un schiste
egalement traumatique ( grauwackenschiefer ),
à strates presque verticales , contenant des fragments
de gneiss et de schiste-micacé ayant six à
sept pouces. A cet aspect, Saussure ne put s’empêcher
de dire , « que des particules de la plus
» extrême ténuité, suspendues dans un fluide,
» puissent s’agglutiner entre elles, et former des
» couches verticales, c est ce que nous conce-
» vons très-bien.... Mais qu’une pierre toute for-
« mée , de la grosseur de la tête, se soit arrêtée
» au milieu d une paroi verticale, et ail attendu
» là que les petites particules de la pierre vinssent
1 envelopper, la souder et la fixer dans cette
» place , c est une supposition absurde et im-
» possible. Il faut donc regarder comme une
» chose démontrée , que ces poudingues ont été
» formes dans une position horizontale , ou à-
» peu-près telle , et redressés ensuite après leur
» endurcissement. » De pareilles preuves de relèvements
ou de renversements sont très-communes
dans les terrains houillers.
Quelle est la cause qui !es a produits, et qui a relevé
une si grande partie des couches des Alpes,
des Pyrénées, et peut-être de nos continents?
Ce ne seront pas les mouvements de bascule,
imagines par Delüc, lesquels , à l ’époque de
grands affaissements, auraient soulevé une extrémité
des couches en abaissant l ’autre (§ 91 ) :
on ne saurait concevoir comment des couches de
schiste, de granité, etc., matières si friables,
en pivotant ainsi sur un point d’appui, auraient
porté un de leurs bords à mille mètres au-dessus
de ce point. Ce ne seront pas les feux souterrains,
ou des fluides élastiques dégagés de l ’intérieur du
globe : de pareils agents peuvent bien déplacer
et rompre des couches ( § g4 ) ; mais ils ne les
soulèveront jamais de manière à ce qu’elles se
représentent formant encore des masses continues
, à plans parallèles, se prolongeant dans la
même direction à plusieurs lieues de distance, et
souvent avec une uniformité étonnante. Qu’on ne
s’y méprenne pas : le désordre que présentent
les montagnes primitives, au premier aspect,
n’est souvent qu’apparent; et la régularité de
leur structure, dans les Pyrénées, les Alpes, etc.,
a excité l’admiration des observateurs (i). Le
simple poids des couches , lors de leur formation
et de leur accumulation, donnant lieu à des
tassements, à des affaissements partiels, à des glissements
sur lès bases, à des refoulements, etc.,
peut avoir produit une partie de leurs relèvements
et de leurs tortions.
Au reste, je me garde bien de donner ce poids
comme la cause générale qui a mis toutes les
couches dans leur position actuelle. La nature de
(i) Ebel et Escher, pour les Alpes. Alpina, tom. IV, p. 3o4-