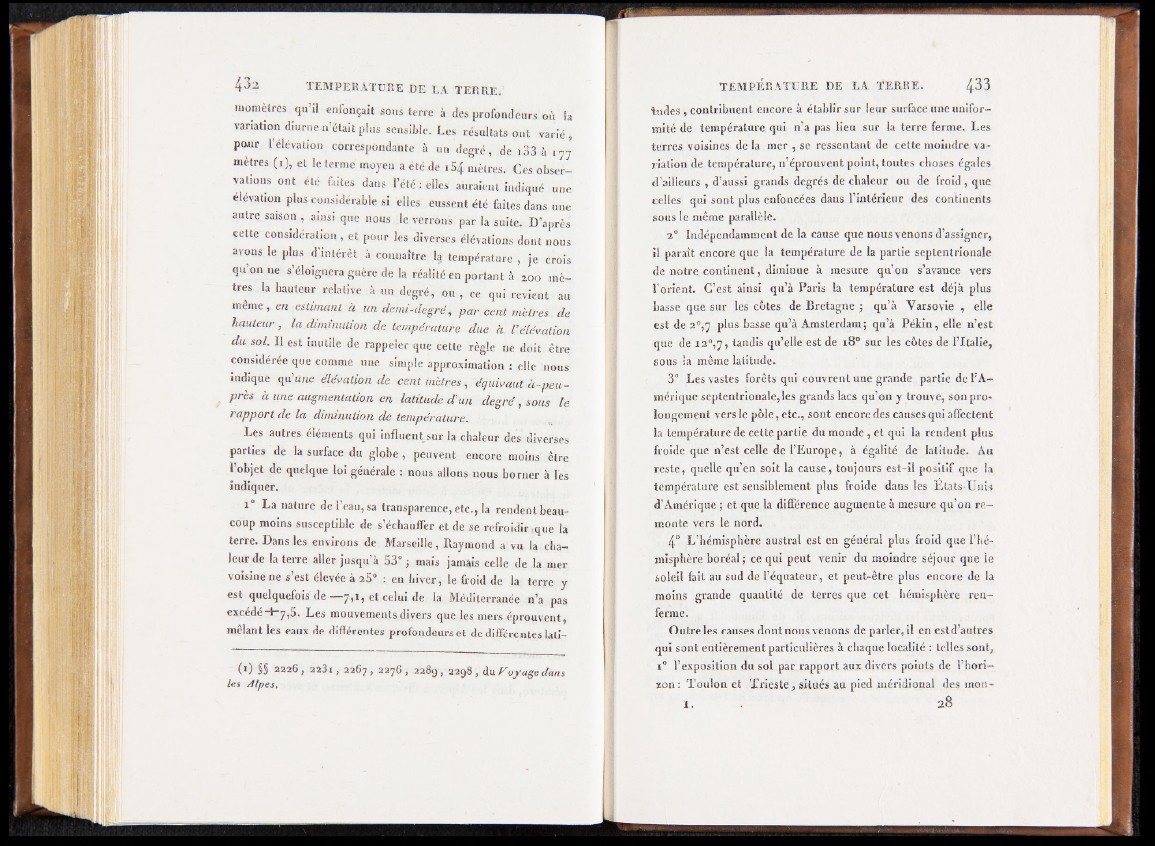
momèlres qu’il enfonçait sous terre à des profondeurs où la
variation diurne n’était plus sensible. Les résultats ont varié,
paur l’élévation correspondante à un degré, de 133 à 177
mètres (1), et le terme moyen a été de i 54 mètres. Ces observations
ont été faites dans l’été : elles auraient indiqué une
élévation plus considérable si elles eussent été faites dans une
autre saison , ainsi que nous le verrons par la suite. D ’après
cette considération, et pour les diverses élévations dont nous
avons le plus d’intérêt à connaître la température , je crois
qu’on ne s’éloignera guère de la réalité en portant à i00 mètres
la hauteur relative à un degré, ou , ce qui revient au
même, en estimant à un demi-degré, par cent mètres de
hauteur, la diminution de température due à , l ’ élévation
du sol. Il est inutile de rappeler que cette règle ne doit être
considérée que comme une simple approximation : elle nous
indique qu’une élévation de cent mètres, équivaut à -peu-
près à une augmentation en latitude d'un d eg r é , sous le
rapport de la diminution de température.
Lés autres éléments qui influent sur la chaleur des diverses
parties de la surface du globe , peuvent encore moins être
l’objet de quelque loi générale : nous allons nous borner à les
indiquer.
i° La nature de l’eau, sa transparence, etc., la rendent beaucoup
moins susceptible de s’échauffer et de se refroidir,que la
terre. Dans les environs de Marseille, Raymond a vu la chaleur
de la terre aller jusqu’à 53° ; mais jamais celle de la mer
voisine ne s’est élevée à a50 : en hiver, le froid de la terre y
est quelquefois d e— 7,1, et celui de la Méditerranée n’a pas
excédé*+"7,5. Les mouvements divers que les mers éprouvent,
mêlant les eaux de différentes profondeurs et de différentes lati- 1
(1) §§ 2226, 2231,2267, 2276, 2289, 2298, du Voyage dans
les Alpes,
433
tades, contribuent encore à établir sur leur surface une uniformité
de température qui n’a pas lieu sur la terre ferme. Les
terres voisines de la mer , se ressentant de cette moindre variation
de température, n’éprouvent point, toutes choses égales
d’ailleurs , d’aussi grands degrés de chaleur ou de froid, que
celles qui sont plus enfoncées dans l’intérieur des continents
sous le même parallèle.
20 Indépendamment de la cause que nous venons d’assignei’,
il parait encore que la température de la partie septentrionale
de notre continent, diminue à mesure qu’on s’avance vers
l’orient. C’est ainsi qu’à Paris la température est déjà plus
basse que sur les côtes de Bretagne -, qu’à Varsovie , elle
est de 20,7 plus basse qu’à Amsterdam ; qu’à Pékin, elle n’est
que de i2 ° ,7 , tandis qu’ elle est de 180 sur les côtes de l’Italie,
sous la même latitude.
3° Les vastes forêts qui couvrent une grande partie de l’Amérique
septentrionale, les grands lacs qu’on y trouve, son prolongement
vers le pôle, etc., sont encore des causes qui affectent
la température de cette partie du monde , et qui la rendent plus
froide que n’est celle de l’Europe, à égalité de latitude. Au
reste, quelle qu’en soit la cause, toujours est-il positif que la
température est sensiblement plus froide dans les États-Unis
d’Amérique ; et que la différence augmente à mesure qu’on remonte
vers le nord.
4° L ’hémisphère austral est en général plus froid que l’hémisphère
boréal 5 ce qui peut venir du moindre séjour que le
soleil fait au sud de l’équateur, et peut-être plus encore de la
moins grande quantité de terres que cet hémisphère renferme.
Outre les causes dont nous venons de parler, il en estd’autres
qui sont entièrement particulières à chaque localité : telles sont,
i° l’ exposition du soi par rapport aux divers points de î’hori-
xon: Toulon et Trieste, situés au pied méridional des mon-
I. 28