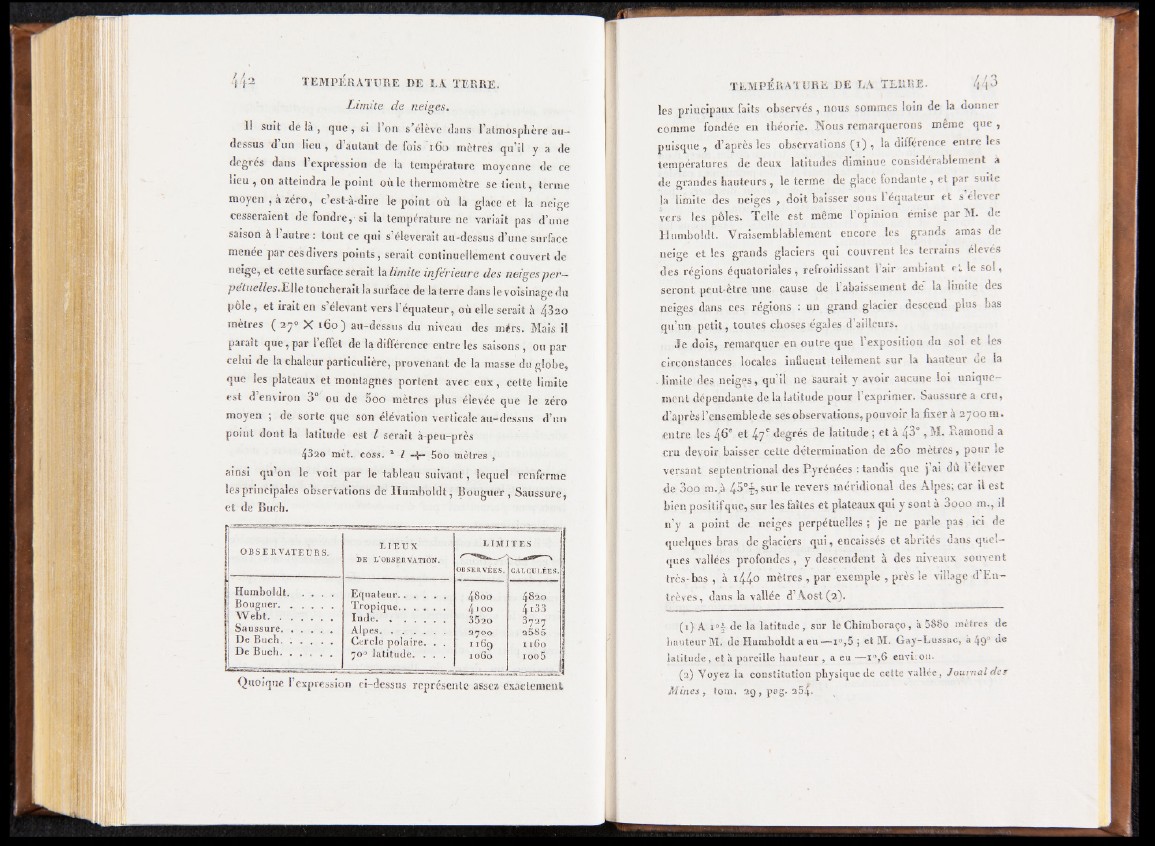
Limite de neiges.
Il su*l: 3e là j que, si l’on s’ élève dans l’atmosphère au-
dessus d un lieu , d autant de fois 160 mètres qu’il y a de
degres dans 1 expression de la température moyenne de ce
lieu , on atteindra le point oùle thermomètre se tient, terme
moyen, à zéro, c’est-à-dire le point où la glace et la neige
cesseraient de fondre,-si la température ne variait pas d’une
saison à l’autre : tout ce qui s’élèverait au-dessus d’une surface
menée par ces divers points, serait continuellement couvert de
neige, et cette surface serait la limite inferieure des neiges per pétuelles.
Elle toucherait la surface de la terre dans le voisinage du
pôle , et irait en s élevant vers l’equateur, où elle serait à 432°
métrés ( 27° X 160) au-dessus du niveau des mérs. Mais il
paraît que, par l’effet de la différence entre les saisons , ou par
celui de la chaleur particulière, provenant de la masse du globe,
que les plateaux et montagnes portent avec eu x, cette limite
est d environ 3 ou de 5oo mètres plus élevée que le zéro
moyen ; de sorte que son élévation verticale au-dessus d’un
point dont la latitude est l serait à-peu-près
4320 mèt. coss. 1 l —p- 5oo mètres ,
ainsi qu on le voit par le tableau suivant, lequel renferme
les principales observations de Humboldt, Bouguer , Saussure,
et de Buch.
OBSERVATEURS.
LIEUX
DE L’OBSEKVATION.
LIMl
OBSERVÉES.
TES
CALCULÉES. ;
Humboldt................
Bouguer. . .
W e b t .......................
Saussure..................
I De Buch. . . . . .
De B u c h ................
IL--------— . . . .—-
Equateur.................
Tropique.. . . . .
Inde.....................
Alpes.......................
Cercle polaire. . .
700 latitude. . . .
4800
4>oo
3520
2700
1 169
1060
4820
4 1 33
3727
2585 j
1 160 j
100 5 j
Quoique l’expression ci-dessus représente assez exactement
les principaux faits observés , nous sommes loin de la donner
comme fondée en théorie. Nous remarquerons même que ,
puisque, d’ après les observations (1) , la différence entre les
températures de deux latitudes diminue considérablement a
de grandes hauteurs , le terme de glace fondante , et par suite
la limite des neiges , doit baisser sous 1 équateur et s élever
vers les pôles. Telle est même 1 opinion émise par M. de
Humboldt. Vraisemblablement encore les grands amas de
neige et les grands glaciers qui couvrent les terrains élevés
des régions équatoriales, refroidissant l’air ambiant f . le sol,
seront peut-être une cause de l’abaissement de la limite des
neiges dans ces régions : un grand glacier descend plus bas
qu’un petit, toutes choses égales d’ailleurs.
Je dois, remarquer en outre que l’exposition du sol et les
circonstances locales influent tellement sur la hauteur de la
. limite des neiges, qu’il ne saurait y avoir aucune loi uniquement
dépendante de la latitude pour l’exprimer. Saussure a cru,
d’après l’ensemble de ses observations, pouvoir la fixer à 2700 m.
entre les 46“ et 47e degrés de latitude ; et à 43° , M. Ramond a
cru devoir baisser cette détermination de 260 mètres, pour le
versant septentrional des Pyrénées : tandis que j’ai dû l’élever
de 3oo m.à 45°-jiSur le revers méridional des Alpes; car il est
bien positifque, sur les faîtes et plateaux qui y sont à 3ooo m., il
n’y a point de neiges perpétuelles ; je ne parle pas ici de
quelques bras de glaciers qui, encaissés et abrités dans quelques
vallées profondes, y descendent à des niveaux souvent
très-bas , à x44° mètres , par exemple , près le village d’En-
trèves, dans la vallée d’Âost(2).
(1) A i ° j de la latitude , sur le Chiruboraço, à 588o mètres de
hauteur M. de Humboldt a eu— 1°,5 ; et M. Gay-Lussac, à 49" de
latitude, et à pareille hauteur , a eu — i °,6 envi;ou.
(2) Voyez la constitution physique de cette vallée, Journal de?
Mines, ton». 29, pag. 254.