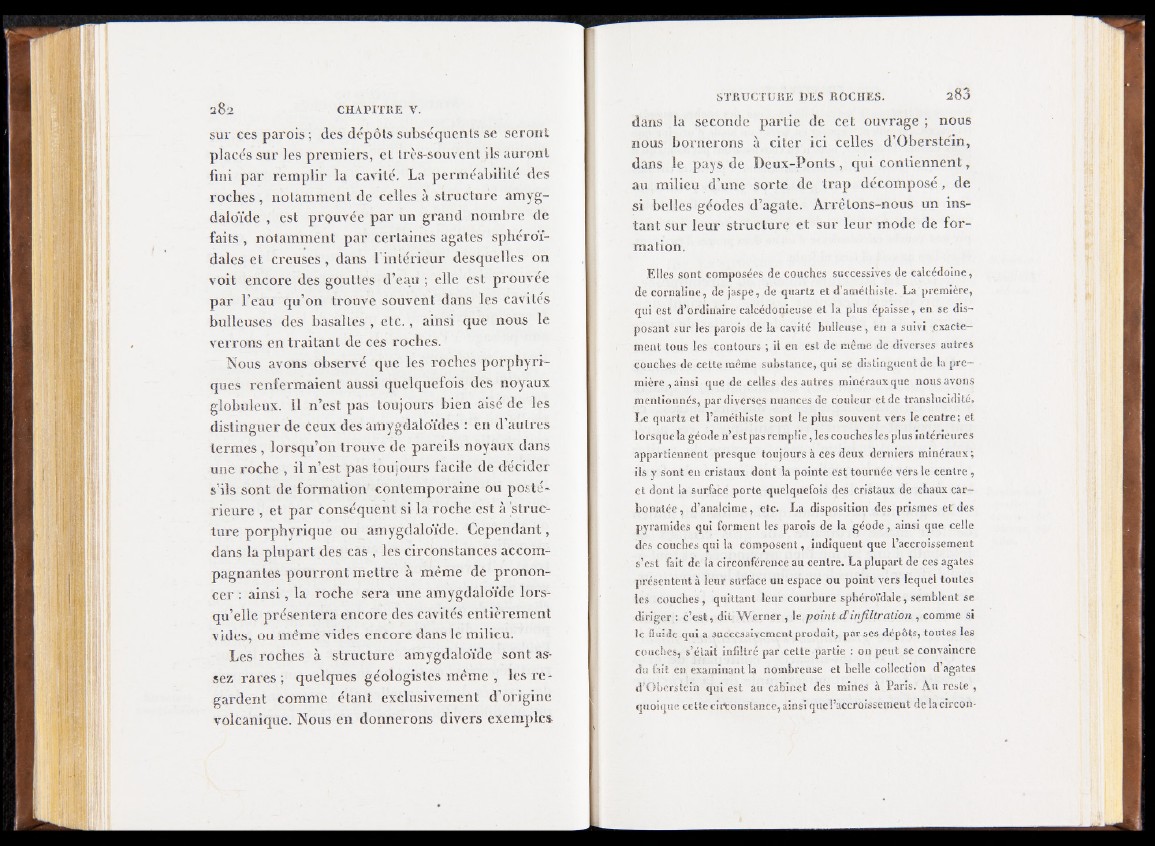
sur ces parois; des dépôts subséquents se seront
placés sur les premiers, et très-souvent ils auront
fini par remplir la cavité. La perméabilité des
roches, notamment de celles à structure amyg-
daloïde , est prouvée par un grand nombre de
faits, notamment par certaines agates sphéroï-
dales et creuses, dans l’intérieur desquelles on
voit encore des gouttes d’eau ; elle est prouvée
par l’eau qu’on trouve souvent dans les cavités
bulleuses des basaltes , etc., ainsi que nous le
verrons en traitant de ces roches.
Nous avons observé que les roches porphyri-
ques renfermaient aussi quelquefois des noyaux
globuleux. Il n’est pas toujours bien aisé de les
distinguer de ceux des amygdaloïdes : en d’autres
termes, lorsqu’on trouve de pareils noyaux dans
une roche , il n’est pas toujours facile de décider
s’ils sont de formation contemporaine ou postérieure
, et par conséquent si la roche est à structure
porphyrique ou amygdaloïde. Cependant,
dans la plupart des cas , les circonstances accompagnantes
pourront mettre à meme de prononcer
: ainsi, la roche sera une amygdaloïde lorsqu’elle
présentera encore des cavités entièrement
vides, ou même vides encore dans le milieu.
Les roches à structure amygdaloïde sont assez
rares; quelques géologistes même , les regardent
comme étant exclusivement d’origine
volcanique. Nous en donnerons divers exemples
dans la seconde partie de cet ouvrage ; nous
nous bornerons à citer ici celles d’Obersteïn,
dans le pays de Deux-Ponts, qui contiennent,
au milieu d’une sorte de trap décomposé, de
si belles géodes d’agate. Arrêtons-nous un instant
sur leur structure et sur leur mode de formation.
Elles sont composées de couches successives de calcédoine,
de cornaline, de jaspe, de quartz et d’améthiste. La première,
qui est d’ordinaire calcédonieuse et la plus épaisse, en se disposant
sur les parois de la cavité bulleuse, en a suivi .exactement
tous les -contours ; il en est de même de diverses autres
couches de cette même substance, qui se distinguent de la première,
ainsi que de celles des autres minéraux que nous avons
mentionnés, par diverses nuances de couleur et de translucidité.
Le quartz et l’améthiste sont le plus souvent vers le centre; et
lorsque la géode n’est pas remplie, les couches les plus intérieures
appartiennent presque toujours à ces deux derniers minéraux;
ils y sont en cristaux dont la pointe est tournée vers le centre ,
et dont la surface porte quelquefois des cristaux de chaux car-
bonatée, d’analcime, etc. La disposition des prismes et des
pyramides qui forment les parois de la géode, ainsi que celle
des couches qui la composent, indiquent que l’accroissement
s’ est fait de la circonférence au centre. La plupart de ces agates
présentent à leur surface un espace ou point vers lequel toutes
les couches , quittant leur courbure sphéroïdale , semblent se
diriger : c’est, dit Werner , 1 e. point d ’infiltration , comme si
le fluide qui a successivement produit, par ses dépôts, toutes les
couches, s’était infiltré par cette partie : on peut se convaincre
du fait en examinant la nombreuse et belle collection d’agates
d’Oberstein qui est au cabinet des mines à Paris. Au reste ,
quoique celte cirtonstance, ainsi quel’accroissememt delacircon