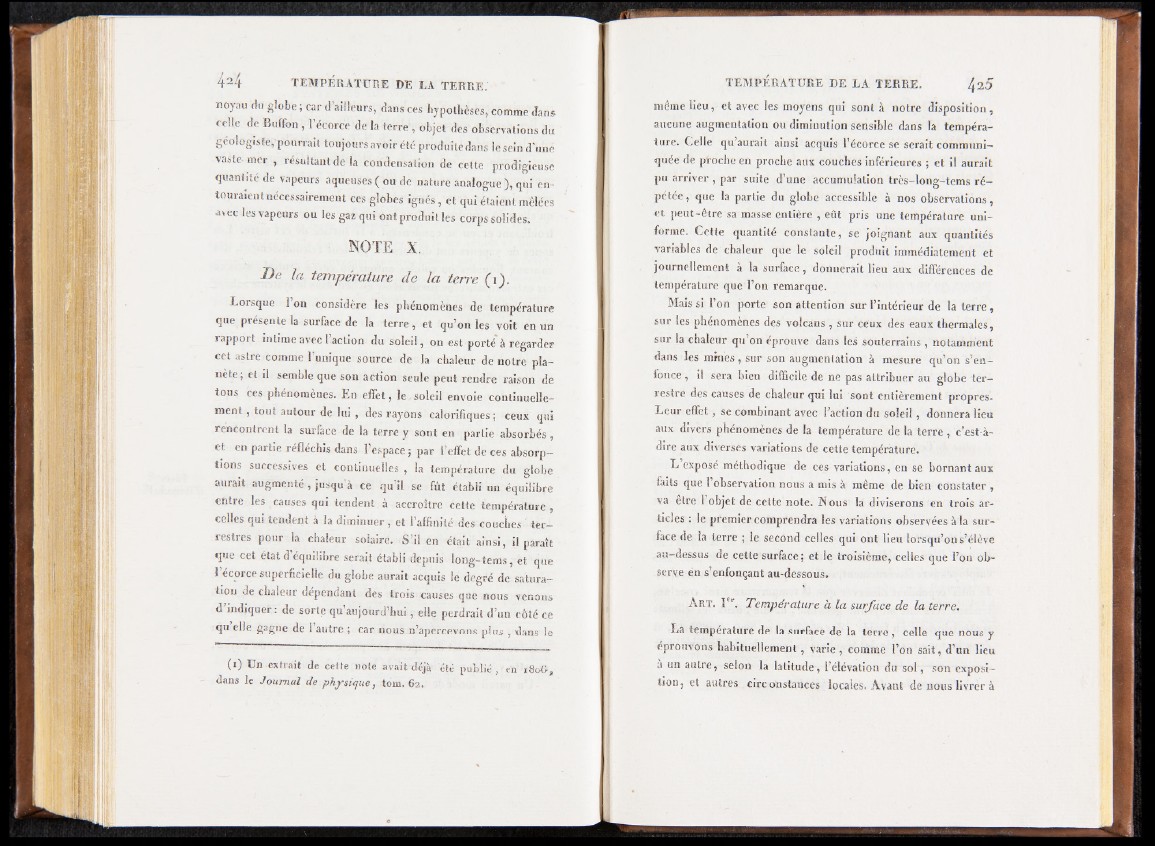
noyau du globe ; car d’ailleurs, dans ces hypothèses, comme dans
celle de Buffon, l’écorce de la terre , objet des observations du
géoiogiste, pourrait toujours avoir été produite dans le sein d’une
vaste mer , résultant de la condensation de cette prodigieuse
quantité de vapeurs aqueuses ( ou de nature analogue ), qui entouraient
nécessairement ces globes ignés, et qui étaient mêlées
avec les vapeurs ou les gaz qui ont produit les corps solides.
NOTE X.
De la température de la teri'e (1).
Lorsque l’on considère les phénomènes de température
que présente la surface de la terre, et qu’on les voit en un
rapport intime avec 1 action du soleil , on est porté à regarder
cet astre comme l’unique source de la chaleur de notre planète,
et il semble que son action seule peut rendre raison de
tous ces phénomènes. En effet, le.soleil envoie continuellement
, tout autour de lui , des rayons calorifiques ; ceux qui
rencontrent la surface de la terre y sont en partie absorbés ,
et en partie réfléchis dans l’espace j par l’effet de ces absorptions
successives et continuelles , la température du globe
aurait augmenté , jusqu’à ce qu’il se fût établi un équilibre
entre les causes qui tendent à accroître cette température ,
celles qui tendent à la diminuer , et l’affinité des couches terrestres
pour la chaleur solaire. S ’il en était ainsi, il paraît
que cet état d équilibre serait établi depuis Iong- tems, et que
1 écorce superficielle du globe aurait acquis le degré de saturation
de chaleur dépendant des trois causes que nous venons
d’indiquer: de sorte qu’aujourd’h u i, elle perdrait d’un côté ce
qu elle gagne de 1 autre ; car nous n’apercevons plus , dans le
(i) Un extrait de cette note avait déjà été publié , en xSoR»
dans le Journal de physique, tom. 62.
même lieu, et avec les moyens qui sont à notre disposition,
aucune augmentation ou diminution sensible dans la température.
Celle qu’aurait ainsi acquis l’écorce se serait communiquée
de pfoche en proche aux couches inférieures ; et il aurait
pu arriver , par suite d’une accumulation très-long-tems répétée
, que la partie du globe accessible à nos observations,
et peut-être sa masse entière , eût pris une température uniforme.
Cette quantité constante, se joignant aux quantités
variables de chaleur que le soleil produit immédiatement et
journellement à la surface, donnerait lieu aux différences de
température que l’on remarque.
Mais si l’on porte son attention sur l’intérieur de la terre,
sur les phénomènes des volcans , sur ceux des eaux thermales,
sur la chaleur qu’on éprouve dans les souterrains , notamment
dans les mines , sur son augmentation à mesure qu’on s’enfonce
, il sera bien difficile de ne pas attribuer au globe terrestre
des causes de chaleur qui lui sont entièrement propres.
Leur effet, se combinant avec l’action du soleil, donnera lieu
aux divers phénomènes de la température de la terre , c’est-à-
dire aux diverses variations de cette température.
L ’exposé méthodique de ces variations, en se bornant aux
faits que l’observation nous a mis à même de bien constater ,
va etre 1 objet de cette note. Nous la diviserons en trois articles
: le premier comprendra les variations observées à la surface
de la terre ; le second celles qui ont lieu lorsqu’on s’élève
au-dessus de cette surface ; et le troisième, celles que l’on observe
en s’enfonçant au-dessous.
A rt. Ier. Température à la surface de la terre.
La température de la surface de la terre , celle que nous y
éprouvons habituellement, varie, comme l’on sait, d’un lieu
a un autre, selon la latitude, l’élévation du sol, son exposition,
et autres circonstances locales. Avant de nous livrer à