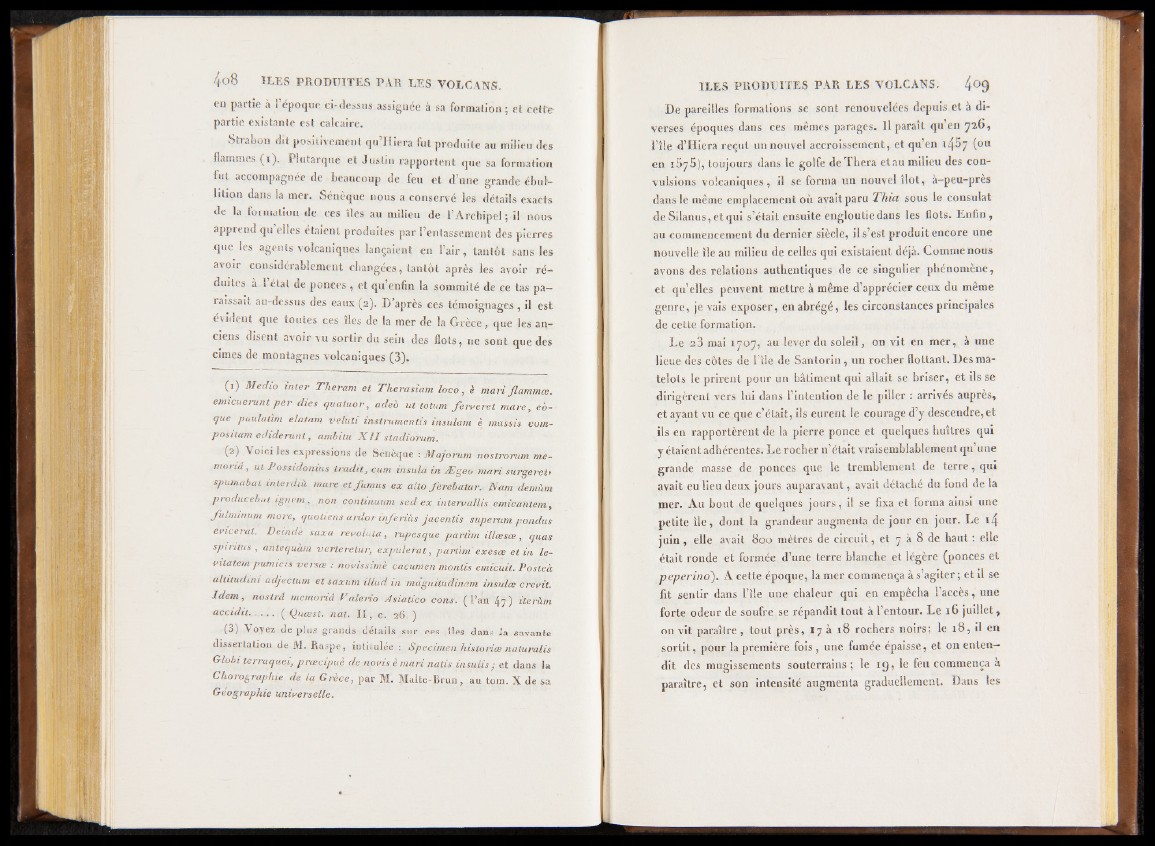
en partie à l’époque ci-dessus assignée à sa formation ; et cette
partie existante est calcaire.
Strabon dit positivement qu’Hiera fut produite au milieu des
flammes ( i) . Plutarque et Justin rapportent que sa formation
fut accompagnée de beaucoup de feu et d’une grande ébullition
dans la mer. Sénèque nous a conservé les détails exacts
de la formation de ces îles au milieu de l’Archipel; il nous
apprend qu’elles étaient produites par l’entassement des pierres
que les agents volcaniques lançaient en l’a ir, tantôt sans les
avoir considérablement changées, tantôt après les avoir réduites
à 1 état de ponces , et qu’enfin la sommité de ce tas paraissait
au-dessus des eaux (2). D’après ces témoignages , il est
évident que toutes ces îles de la mer de la Grèce, que les anciens
disent avoir vu sortir du sein des flots, ne sont que des
cimes de montagnes volcaniques (3).
(1) AI edi O inter Tlieram et Therasîam loco, è mari Jlammoe.
emicuerunt per dies quatuor, ade'o ut totum ferveret mare, eo-
que puulatïm elatam veluti instruments insulam è massis corn-
positam ediderunt, ambitu X I I sladiorum.
(2) Voici les expressions de Sénèque : Majorum nostrorum mémo
rid, ut Possidonius tradit, cum insula in Ægeo mari surgeretf
spumabul inlerdiù mare et fumus ex alto ferebalur. Nam demùm
producebut ignem, non continuum sed ex intervallis emicanlem,
Julminum more, quotiens ardor mjeriùs jacentis superum pondus
eviceral. Deuidè saxa revolula, rupesque partim illcesoe, quas
spiritus , antequàm verteretur, expulerat, partim exesce et in le-
tntatern pumicis versoe : novissimè cacumen montis emicuit. Posteà
altitudini adjectum etsaxum illud in màgniludinam insulte crevit.
Idem, nostra memonâ l ' alerio Asiatico cons. ( l ’an 4y) iterùm
accidit------ ( Quoest. nat. II , c. 26. )
(3) Voyez de plus grands détails sur ces îles dans la savante
dissertation de M. Raspe, iutilulée : Specimen historioe naturalis
Globi terraquei, proecipuè de novis è mari natis insulis ; et dans la
Chorographie de la Grèce, par M. Malte-Brun, au tom. X de sa
Géographie universelle.
De pareilles formations se sont renouvelées depuis et à diverses
époques dans ces mêmes parages. 11 paraît qu’en 726,
l’île d’Hiera reçut un nouvel accroissement, et qu’en i 4^7 (ou
en iSyS), toujours dans le golfe deThera et au milieu des convulsions
volcaniques, il se forma un nouvel îlot, à-peu-près
dans le même emplacement où avait paru Thia sous le consulat
de Silanus, et qui s’était ensuite engloutie dans les flots. Enfin,
au commencement du dernier siècle, il s’est produit encore une
nouvelle île au milieu de celles qui existaient déjà. Comme nous
avons des relations authentiques de ce singulier phénomène,
et qu’ elles peuvent mettre à même d’apprécier ceux du même
genre, je vais exposer, en abrégé, les circonstances principales
de cette formation.
Le 23 mai 1707, au lever du soleil, on vit en mer, à une
lieue des côtes de l’île de Santorin, un rocher flottant. Des matelots
le prirent pour un bâtiment qui allait se briser, et ils se
dirigèrent vers lui dans l’intention de le piller : arrivés auprès,
et ayant vu ce que c’ était, ils eurent le courage d’y descendre,et
ils en rapportèrent de la pierre ponce et quelques huîtres qui
y étaient adhérentes. Le rocher n’était vraisemblablement qu’une
grande masse de ponces que le tremblement de terre, qui
avait eu lieu deux jours auparavant, avait détaché du fond de la
mer. Au bout de quelques jours, il se fixa et forma ainsi une
petite île , dont la grandeur augmenta de jour en jour. Le i 4
juin , elle avait 800 mètres de circuit, et 7 à 8 de haut : elle
était ronde et formée d’une terre blanche et légère (ponces et
peperino). A cette époque, la mer commença à s’agiter ; et il se
fit sentir dans l’île une chaleur qui en empêcha l’accès, une
forte odeur de soufre se répandit tout à l’entour. Le 16 juillet,
on vit paraître, tout près, 17 à 18 rochers noirs; le 18, il en
sortit, pour la première fois , une fumée épaisse, et on entendit
des mugissements souterrains; le 19, le feu commença à
paraître, et son intensité augmenta graduellement. Dans les