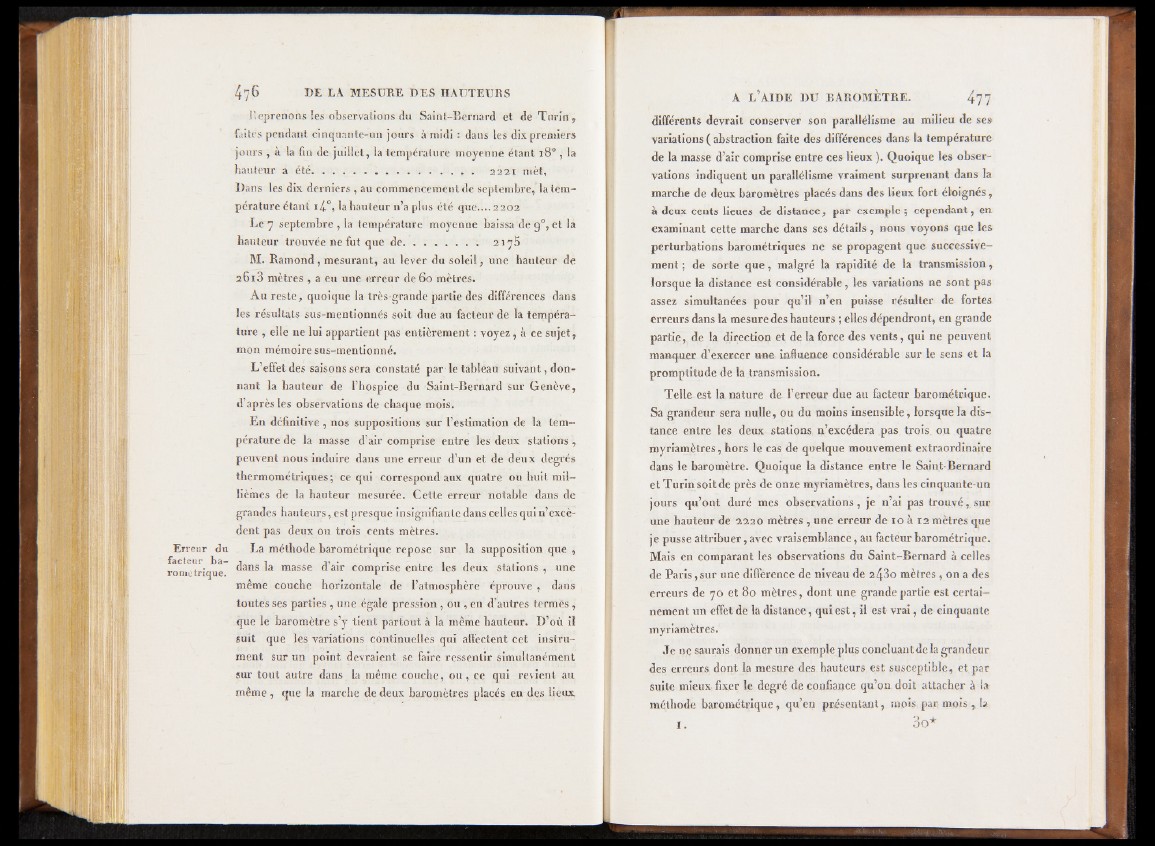
Erreur du
facteur baronie
trique.
lîéprenons les observations du Saint-Bernard et de Turin ,
faites pendant cinquante-un jours à midi : dans les dix premiers
jours , à la fin de juillet, la température moyenne étant 180, la
hauteur a été..................... ............................... 2221 mèt,
Dans les dix derniers , au commencement de septembre, la température
étant i4°, la hauteur n’a plus été que.... 2202
Le 7 septembre , la température moyenne baissa de 90, et la
hauteur trouvée ne fut que de. . . . . . . . 2 iy 5
M. Ramond, mesurant, au lever du soleil, une hauteur de
26i 3 mètres , a eu une erreur de 60 mètres.
Au reste, quoique la très-grande partie des différences dans
les résultats sus-mentionnés soit due au facteur de la température
, elle ne lui appartient pas entièrement : voyez, à ce sujet,
mon mémoire sus-mentionné.
L ’effet des saisons sera constaté par le tableau suivant, donnant
la hauteur de l’hospice du Saint-Bernard sur Genève,
d’après les observations de chaque mois.
En définitive , nos suppositions sur l’estimation de la température
de la masse d’air comprise entre les deux stations,
peuvent nous induire dans une erreur d’un et de deux degrés
thermométriques; ce qui correspond aux quatre ou huit millièmes
de la hauteur mesurée. Cette erreur notable dans de
grandes hauteurs, est presque insignifiante dans celles qui n’excèdent
pas deux ou trois cents mètres.
La méthode barométrique repose sur la supposition que ,
dans la masse d’air comprise entre les deux stations , une
même couche horizontale de l’atmosphère éprouve , dans
toutes ses parties , une égale pression, ou , en d’autres termes,
que le baromètre s’y tient partout à la même hauteur. D’où il
suit que les variations continuelles qui affectent cet instrument
sur un point devraient se faire ressentir simultanément
sur tout autre dans la même couche, ou , ce qui revient au
même , que la marche de deux baropiètres placés en des lieux
différents devrait conserver son parallélisme au milieu de ses
variations ( abstraction faite des différences dans la température
de la masse d’air comprise entre ces lieux ). Quoique les observations
indiquent un parallélisme vraiment surprenant dans la
marche de deux baromètres placés dans des lieux fort éloignés,
à deux cents lieues de distance, par exemple ; cependant, en
examinant cette marche dans ses détails , nous voyons que les
perturbations barométriques ne se propagent que successivement
; de sorte q u e , malgré la rapidité de la transmission,
lorsque la distance est considérable, les variations ne sont pas
assez simultanées pour qu’il n’en puisse résulter de fortes
erreurs dans la mesure des hauteurs ; elles dépendront, en grande
partie, de la direction et de la force des vents, qui ne peuvent
manquer d’exercer une influence considérable sur le sens et la
promptitude de la transmission.
Telle est la nature de l’erreur due au facteur barométrique.
Sa grandeur sera nulle, ou du moins insensible, lorsque la distance
entre les deux stations n’excédera pas trois, ou quatre
myriamètres, hors le cas de quelque mouvement extraordinaire
dans le baromètre. Quoique la distance entre le Saint-Bernard
et Turin soit de près de onze myriamètres, dans les cinquante-un
jours qu’ont duré mes observations, je n’ai pas trouvé, sur
une hauteur de 2220 mètres , une erreur de 10 à 12 mètres q,ue
je pusse attribuer, avec vraisemblance, au facteur barométrique.
Mais en comparant les observations du Saint-Bernard à celles
de Paris, sur une différence de niveau de 243o mètres, on a des
erreurs de 70 et 80 mètres, dont une grande partie est certainement
un effet de la distance, qui e s t, il est vrai, de cinquante
myriamètres.
Je ne saurais donner un exemple plus concluant de la grandeur
des erreurs dont la mesure des hauteurs est susceptible, et par
suite mieux fixer le degré de confiance qu’on doit attacher à la
méthode barométrique, qu’en présentant, mois par mois , la
I. 3o*