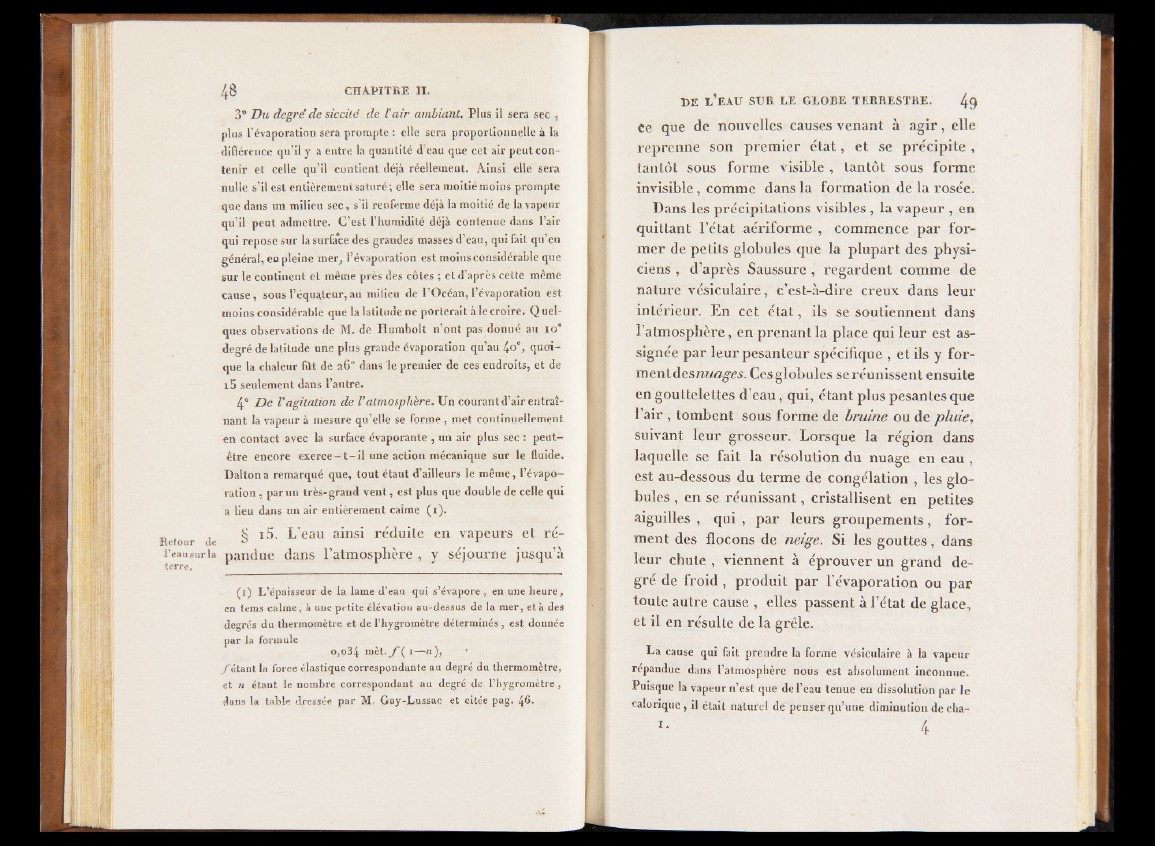
Retour de
ï’eausur la
Serre.
3° Du degré de siccité de l'air ambiant. Plus il sera sec ,
plus l’évaporation sera prompte : elle sera proportionnelle à la
différence qu’il y a entre la quantité d’eau que cet air peut contenir
et celle qu’il contient déjà réellement. Ainsi elle sera
nulle s’il est entièrement saturé; elle sera moitié moins prompte
que dans un milieu sec, s’il renferme déjà la moitié de la vapeur
qu’il peut admettre. C’est l’humidité déjà contenue dans l’air
qui repose sur la surface des grandes masses d’eau, qui fait qu’en
général, en pleine mer, l’évaporation est moins considérable que
sur le continent et même près des côtes ; et d’après cette même
cause, sous l’équateur, au milieu de l ’Océan, l’évaporation est
moins considérable que la latitude ne porterait à le croire. Q uel-
ques observations de M. de Humbolt n’ont pas donné au io ‘
degré de latitude une plus grande évaporation qu’au lt.oe, quoique
la chaleur fât de 26° dans le premier de ces endroits, et de
i 5 seulement dans l’autre.
4° D e l’agitation de l’ atmosphère. Un courant d’air entraînant
la vapeur à mesure qu’elle se forme , met continuellement
en contact avec la surface évaporante , un air plus sec : peut-
être encore exerce-t-il une action mécanique sur le fluide.
Dalton a remarqué que, tout étant d’ailleurs le même, l’évaporation
, parun très-grand vent, est plus que double de celle qui
a lieu dans un air entièrement calme (1).
§ i 5. L’eau ainsi réduite en vapeurs et répandue
dans l ’atmosphère , y séjourne jusqu’à 1
(1) L ’épaisseur de la lame d’eau qui s’évapore , en une heure,
en teins calme, à une petite élévation au-dessus de la mer, et à des
degrés du thermomètre et de l’hygromètre déterminés , est donnée
par la formule
o,o34 mèt.i/ ’ ( i—a ) , *
/’étant la force élastique correspondante au degré du thermomètre,
et n étant le nombre correspondant au degré de l’hygromètre ,
dans la table dressée par M. Gay-Lussac et citée pag. tfi.
DE L ’EAU SUR LE GLOBE TERRESTRE. 4 9
ce que de nouvelles causes venant à agir, elle
reprenne son premier état, et se précipite ,
tantôt sous forme visible , tantôt sous forme
invisible, comme dans la formation de la rosée.
Dans les précipitations visibles , la vapeur , en
quittant l’état aériforme , commence par former
de petits globules que la plupart des physiciens
, d’après Saussure , regardent comme de
nature vésiculaire, c’est-à-dire creux dans leur
intérieur. En cet état, ils se soutiennent dans
l ’atmosphère, en prenant la place qui leur est assignée
par leur pesanteur spécifique , et ils y for-
mentdesnuages. Ces globules se réunissent ensuite
en gouttelettes d’eau, qui, étant plus pesantes que
l’air , tombent sous forme de bruine ou de pluie,
suivant leur grosseur. Lorsque la région dans
laquelle se fait la résolution du nuage en eau ,
est au-dessous du terme de congélation , les globules
, en se réunissant, cristallisent en petites
aiguilles , qui , par leurs groupements, forment
des flocons de neige. Si les gouttes, dans
leur chute , viennent à éprouver un grand degré
de froid, produit par l’évaporation ou par
toute autre cause , elles passent à l’état de glace,
et il en résulte de la grêle.
La cause qui fait prendre la forme vésiculaire à la vapeur
répandue dans l’atmosphère nous est absolument inconnue.
Puisque la vapeur n’est que de l’eau tenue en dissolution par le
calorique, il était naturel de penser qu’une diminution de cha