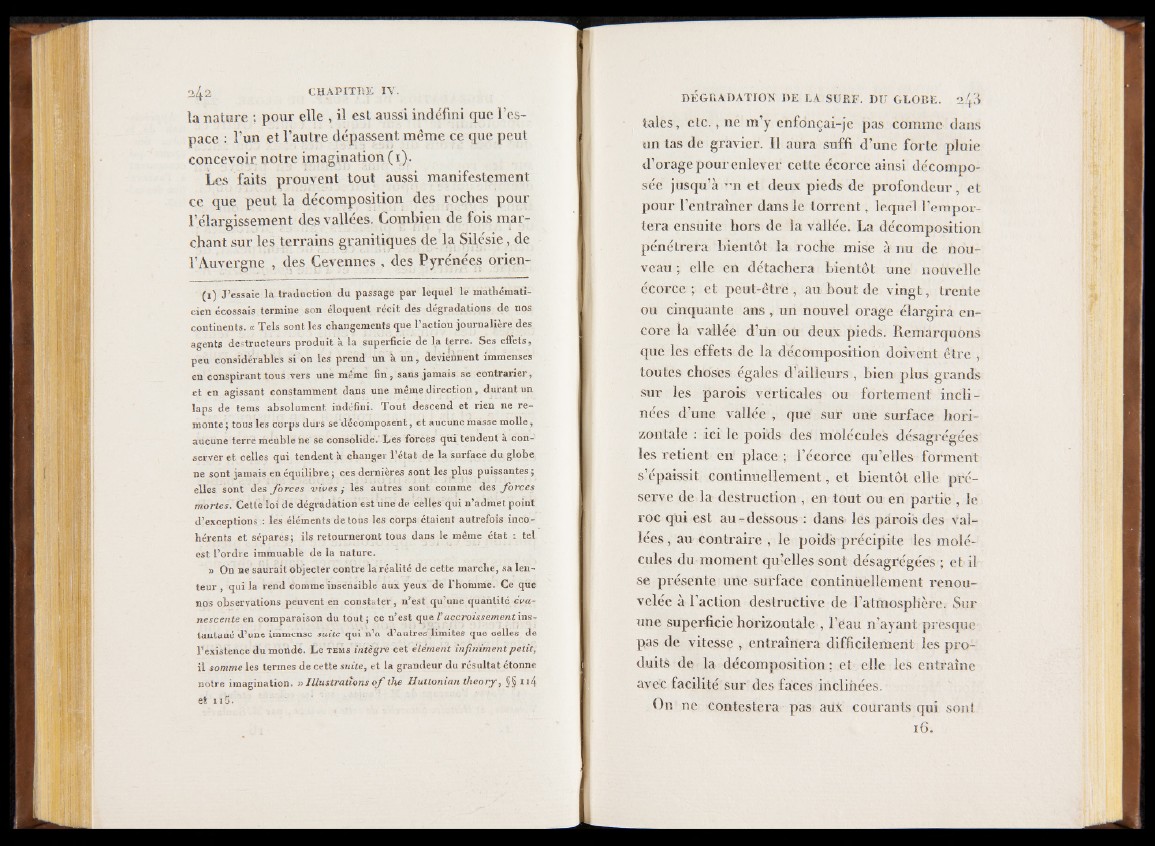
242 CHAPITRE IV.
la nature ; pour elle , il est aussi indéfini que l ’espace
: l’un et l’autre dépassent même ce que peut
concevoir notre imagination (1).
Les faits prouvent tout aussi manifestement
ce que peut la décomposition des roches pour
l’élargissement des vallées. Combien de fois marchant
sur les terrains granitiques de la Silésie, de
l’Auvergne , des Cevennes , des Pyrénées orien-
(1) J’essaie la traduction du passage par lequel le mathématicien
écossais termine son éloquent récit des dégradations de nos
continents. « Tels sont les changements que l’action journalière des
agents destructeurs produit à la superficie de la terre. Ses effets,
peu considérables si on les prend un à un, deviennent immenses
en conspirant tous vers une même fin, sans jamais se contrarier,
et en agissant constamment dans une même direction , durant un
laps de tems absolument indéfini. Tout descend et rien ne remonte;
tous les corps durs se'décomposent, et aucune masse molle,
aucune terre meuble ne se consolidé.' Les forces qui tendent a conserver
et celles qui tendent à changer l’etat de la surface du globe
ne sont jamais en équilibre ; ces dernières sont les plus puissantes;
elles sont des forces vives ; les autres sont comme des forces
mortes. Cette loi de dégradation est line de celles qui n’admet point
d’exceptions : les éléments de tous les corps étaient autrefois incohérents
et séparés; ils retourneront tous dans le même état : tel
est l’ordre immuable de la nature.
» On ne saurait objecter contré là réalité de cette marche, sa lenteur
, qui la rend comme insensible aux yeux de l'homme. Ce que
nos observations peuvent en constater , n’est qu’une quantité évanescente
en comparaison du tout; ce n’ est que V accroissement instantané
d’une immense suite qui n’a d’autres limites que celles de
l’existence du monde. Le tems intègre cet élément infiniment petit,
il somme les termes de cette suite, et la grandeur du résultat étonne
notre imagination. » Illustrations o f the Hutlonian theory, §§ n 4
et n 5.
DEGRADATION DE LA SURF. DU GLOBE.
taies, e lc ., ne m’y enfonçai-je pas comme dans
un tas de gravier. Il aura suffi d’une forte pluie
d’orage pour enlever cette écorce ainsi décomposée
jusqu’à un et deux pieds de profondeur, et
pour l’entraîner dans le torrent, lequel l ’emportera
ensuite hors de la vallée. La décomposition
pénétrera bientôt la roche mise à nu de nouveau
; elle en détachera bientôt une nouvelle
écorce ; et peut-être , au bout de vingt, trente
ou cinquante ans , un nouvel orage élargira encore
la vallée d’un ou deux pieds. Remarquons
que les effets de la décomposition doivent être ,
toutes choses égales d’ailleurs , bien plus grands
sur les parois verticales ou fortement inclinées
d’une vallée , que sur une surface horizontale
: ici le poids des molécules désagrégées
les retient en place ; l’écorce qu’elles forment
s’épaissit continuellement, et bientôt elle préserve
de la destruction , en tout ou en partie , le
roc qui est au - dessous : dans les parois des vallées,
au contraire , le poids précipite les molécules
du moment quelles sont désagrégées ; et il
se présente une surface continuellement renouvelée
à l ’action destructive de l’atmosphère. Sur
une superficie horizontale , l’eau n’ayant presque
pas de vitesse , entraînera difficilement les produits
de la décomposition ; et elle les entraîne
avec facilité sur des faces inclinées.
On ne contestera pas aux courants qui sont
16.