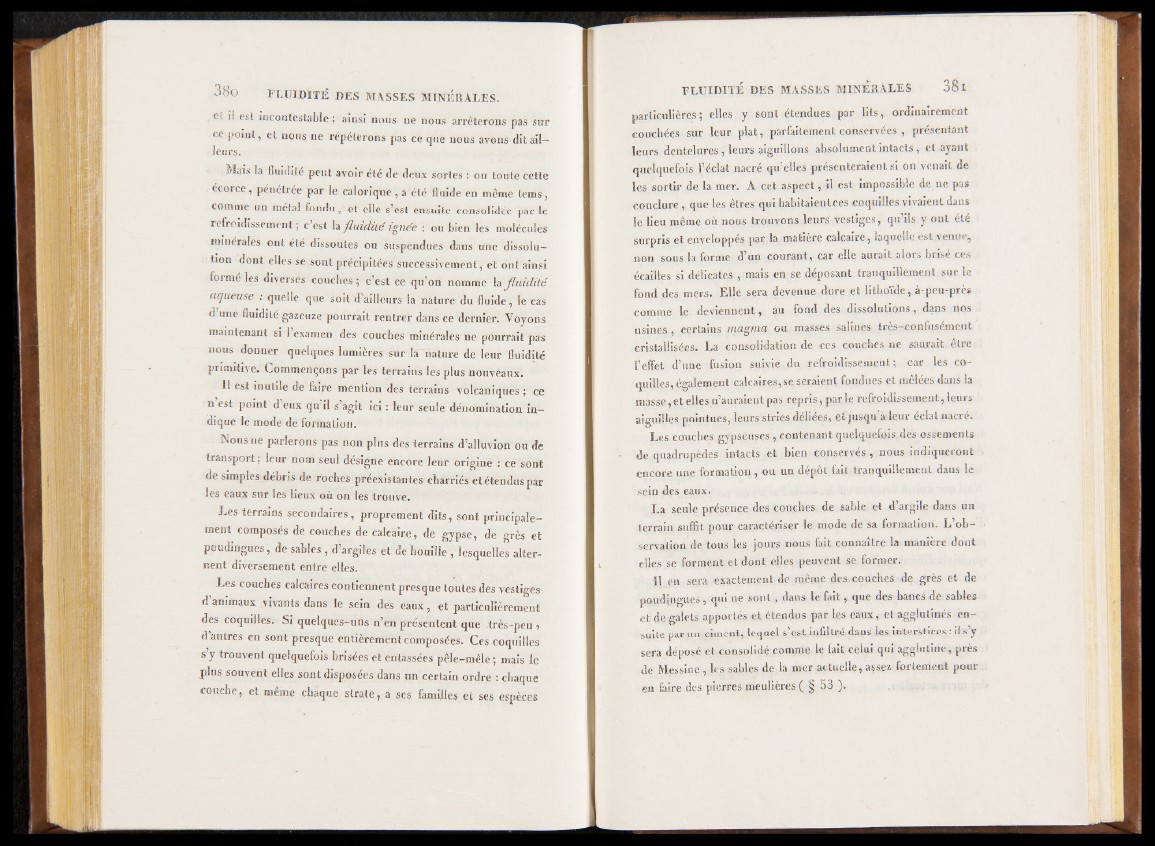
3 b o FLUIDITÉ DES MASSES MINÉRALES,
et il est incontestable ; ainsi nous ne nous arrêterons pas sur
ce point, et nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ailleurs.
Mais la fluidité peut avoir été de deux sortes : ou toute cette
écorce, péuétrée par le calorique, a été fluide en même tems,
comme un métal fondu, et elle s’est ensuite consolidée par le
refroidissement ; c’est la fluidité ignée : ou bien les molécules
minérales ont été dissoutes ou suspendues dans une dissolution
dont elles se sont précipitées successivement, et ont ainsi
formé les diverses couches ; c’est ce qu’on nomme la fluidité
aqueuse : quelle que soit d’ailleurs la nature du fluide, le cas
d une fluidité gazeuze pourrait rentrer dans ce dernier. Voyons
maintenant si 1 examen des couches minérales ne pourrait pas
nous donner quelques lumières sur la nature de leur fluidité
primitive. Commençons par les terrains les plus nouveaux.
U est inutile de faire mention des terrains volcaniques ; ce
n est point d eux qu il s’agit ici : leur seule dénomination indique
le mode de formation.
INousne parlerons pas non plus des terrains d’alluvion ou de
transport ; leur nom seul désigne encore leur origine : ce sont
de simples débris de roches préexistantes charriés et étendus par
les eaux sur les lieux où on les trouve.
Les terrains secondaires, proprement dits, sont principalement
composés de couches de calcaire, de gypse, de grès et
poudingues, de sables , d’argiles et de houille , lesquelles alternent
diversement entre elles.
Les couches calcaires contiennent presque toutes des vestiges
d animaux vivants dans le sein des eaux , et particulièrement
des coquilles. Si quelques-uns n’en présentent que très-peu ■>
d’autres en sont presque entièrement composées. Ces coquilles
s’y trouvent quelquefois brisées et entassées pêle-mêle ; mais le
plus souvent elles sont disposées dans un certain ordre : chaque
couche, et meme chaque strate, a ses familles et ses espèces
particulières ; elles y sont étendues par lits, ordinairement
couchées sur leur plat, parfaitement conservées , présentant
leurs dentelures, leurs aiguillons absolument intacts, et ayant
quelquefois l’éclat nacré quelles présenteraient si on venait de
les sortir de la mer. A cet aspect, il est impossible de ne pas
conclure, que les êtres qui habitaient ces coquilles vivaient dans
le lieu même où nous trouvons leurs vestiges, qu’ils y ont été
surpris et enveloppés par la matière calcaire, laquelle est venue,
non sous la forme d’un courant, car elle aurait alors brise ces
écailles si délicates , mais en se déposant tranquiliement sur le
fond des mers. Elle sera devenue dure et lithoïde, à-peu-près
comme le deviennent, au fond des dissolutions, dans nos
usines , certains magma ou masses salines très-confusément
cristallisées. La consolidation de ces couches ne saurait être
l’effet d’ une fusion suivie.du refroidissement; car les coquilles,
également calcaires, se seraient fondues et mêlées dans la
masse, et elles n’auraient pas repris, parle refroidissement, leurs
aiguilles pointues, leurs stries déliées, et jusqu’à leur éclat nacré.
Les couches gypseuses , contenant quelquefois des ossements
de quadrupèdes intacts et bien conservés, nous indiqueront
encore une formation , ou un dépôt fait tranquillement dans le
sein des eaux.
La seule présence des couches de sable et d’argile dans un
terrain suffit pour caractériser le mode de sa formation. L ’observation
de tous les jours nous fait connaître la manière dont
elles se forment et dont elles peuvent se former.
11 en sera exactement de même des.couches de grès et de
poudingues, qui ne sont, dans le fait, que des bancs de sables
et de galets apportés et étendus par les eaux, et agglutinés ensuite
par un ciment, lequel s’est infiltré dans les interstices : il s’y
sera déposé et consolidé comme le fait celui qui agglutine , près
de Messine , les sables de la mer actuelle, assez fortement pour
en faire des pierres meulières ( § 53 ).