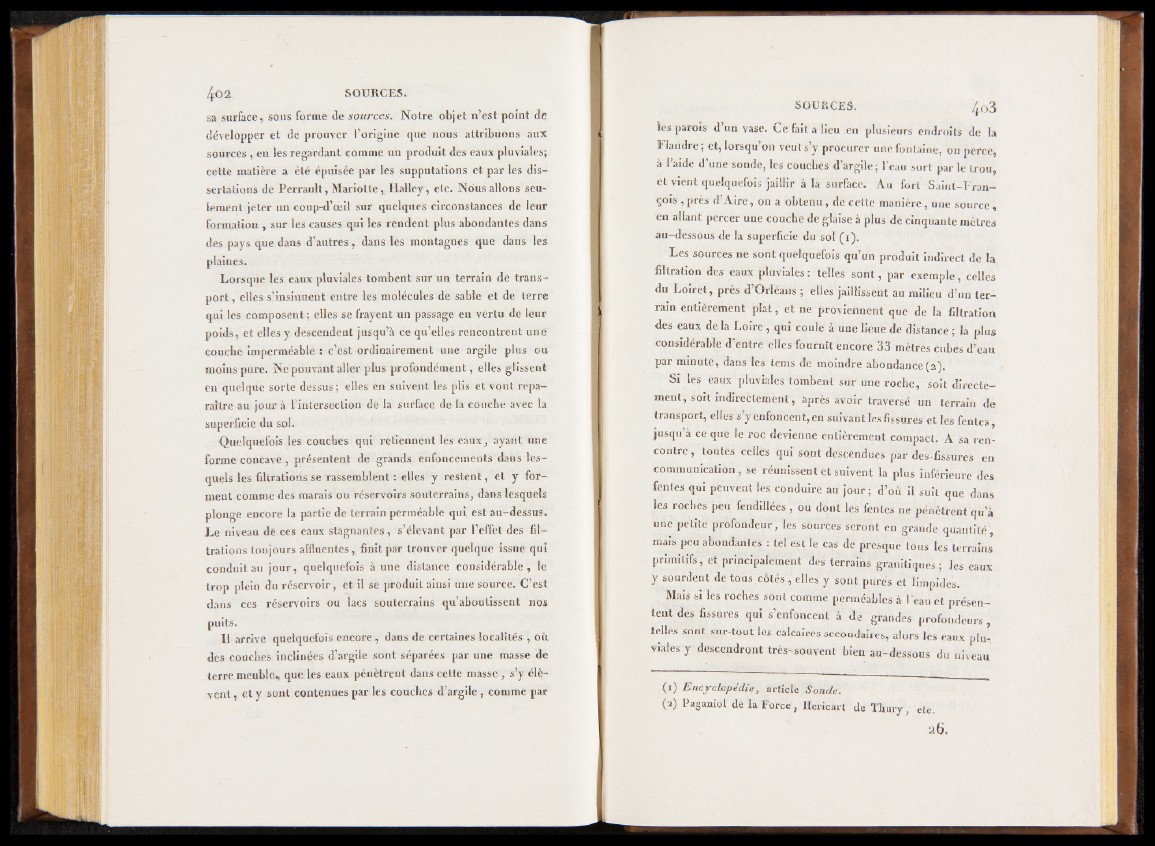
4-02 S O U R C E S .
sa surface, sous forme de sources. Notre objet n’est point de
développer et de prouver l’origine que nous attribuons aux
sources , en les regardant comme un produit des eaux pluviales;
cette matière a été épuisée par les supputations et par les dissertations
de Perrault, Mariotte, Halley, etc. Nous allons seulement
jeter un coup-d’oeil sur quelques circonstances de leur
formation , sur les causes qui les rendent plus abondantes dans
des pays que dans d’autres, dans les montagnes que dans les
plaines.
Lorsque les eaux pluviales tombent sur un terrain de transport,
elles s’insinuent entre les molécules de sable et de terre
qui les composent ; elles se frayent un passage en vertu de leur
poids, et elles y descendent jusqu’à ce qu’elles rencontrent une
couche imperméable : c’est ordinairement une argile plus ou
moins pure. Ne pouvant aller plus profondément, elles glissent
en quelque sorte dessus ; elles en suivent les plis et vont reparaître
au jour à l'intersection de la surface de la couche avec la
superficie du sol.
Quelquefois les couches qui retiennent les eaux, ayant une
forme concave , présentent de grands enfoncements dans lesquels
les filtrations se rassemblent : elles y restent, et y forment
comme des marais ou réservoirs souterrains, dans lesquels
plonge encore la partie de terrain perméable qui est au-dessus.
Le niveau dé ces eaux stagnantes, s’élevant par l’effet des filtrations
toujours affluentes, finit par trouver quelque issue qui
conduit au jour, quelquefois aune distance considérable, le
trop plein du réservoir, et il se produit ainsi une source. C’est
dans ces réservoirs ou lacs souterrains qu’aboutissent nos
puits.
Il arrive quelquefois encore, dans de certaines localités , où
des couches inclinées, d’argile sont séparées par une masse de
terre meuble, que les eaux pénètrent dans cette masse , s’y élèvent
, et y sont contenues par les couches d’argile, comme par
S O U R C E S . 4o3
les parois d’un vase. Ce fait a lieu en plusieurs endroits de la
Flandre; et, lorsqu’on veut s’y procurer une fontaine, on perce,
à l’aide d’une sonde, les couches d’argile ; l’eau sort par le trou
et vient quelquefois jaillir à la surface. Au fort Saint-François
, près d’Aire, on a obtenu, de cette manière, une source
en allant percer une couche de glaise à plus de cinquante mètres
au-dessous de la superficie du sol (i).
Les sources ne sont quelquefois qu’un produit indirect de la
filtration des eaux pluviales : telles sont, par exemple, celles
du Loiret, près d’Orléans ; elles jaillissent au milieu d’un terrain
entièrement plat, et ne proviennent que de la filtration
des eaux de la Loire , qui coule à une lieue de distance ; la plus
considérable d’entre elles fournit encore 33 mètres cubes d’eau
par minute, dans les tems de moindre abondance (2).
Si les eaux pluviales tombent sur une roche, soit directement,
soit indirectement, après avoir traversé un terrain de
transport, elles s’y enfoncent, en suivant les fissures et les fentes,
jusqu’à ce que le roc devienne entièrement compact. A sa rencontre,
toutes celles qui sont descendues par des-fissures en
communication, se réunissent et suivent la plus inférieure des
fentes qui peuvent les conduire au jour; d’où il suit que dans
les roches peu fendillées, ou dont lès fentes ne pénètrent qu’à
une petite profondeur, les sources seront en grande quantité,
mais peu abondantes : tel est le cas de presque tous les terrains
primitifs, et principalement des terrains granitiques; les eaux
y sourdent de tous côtés, elles y sont pures et limpides.
Mais si les roches sont comme perméables à l’eau et présentent
des fissures qui s’enfoncent à de grandes profondeurs,
telles sont sur-tout les calcaires secondaires, alors les eaux pluviales
y descendront très-souvent bien au-dessous du niveau
(1) En cy clopéd ie , article Sonde.
(2 ) P a g a n io l d e la F o r c e , I le r i c a r t d e T h u r y , e t c .