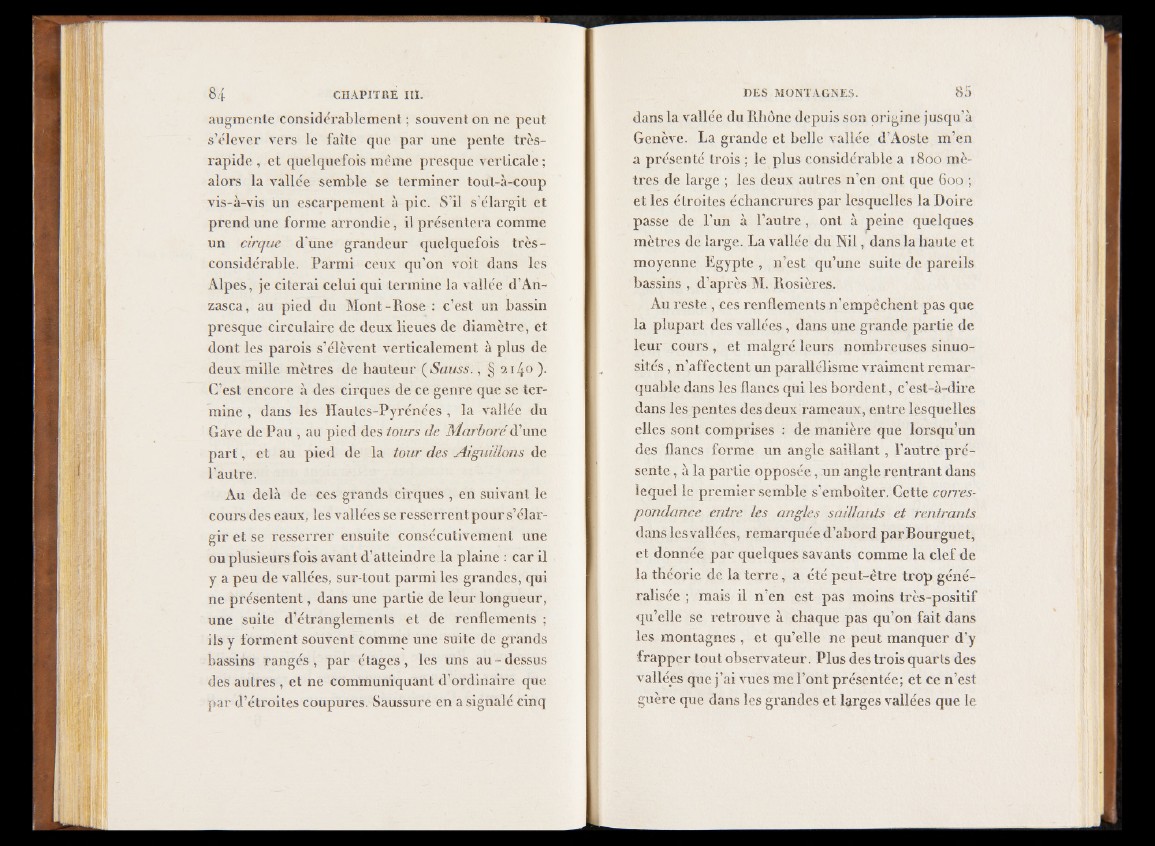
augmente considérablement ; souvent on ne peut
s’élever vers le faîte que par une pente très-
rapide , et quelquefois meme presque verticale ;
alors la vallée semble se terminer toul-à-coup
vis-à-vis tin escarpement à pic. S’il s’élargit et
prend une forme arrondie, il présentera comme
un cirque d’une grandeur quelquefois très-
considérable. Parmi ceux qu’on voit dans les
Alpes, je citerai celui qui termine la vallée d’An-
zasca, au pied du Mont-Rose : c’est un bassin
presque circulaire de deux lieues de diamètre, et
dont les parois s’élèvent verticalement à plus de
deux mille mètres de hauteur ( Sauss., § 2140 ).
C’est encore à des cirques de ce genre que se termine
, dans les Hautes-Pyrénées , la vallée du
Gave de Pau , au pied des tours de Marboréd’une
part, et au pied de la tour des Aiguillons de
l ’autre.
Au delà de ces grands cirques , en suivant le
cours des eaux, les vallées se resserrent pour s’élargir
et se resserrer ensuite consécutivement une
ou plusieurs fois avant d’atteindre la plaine : car il
y a peu de vallées, sur tout parmi les grandes, qui
ne présentent, dans une partie de leur longueur,
une suite d’étranglements et de renflements ;
ils y forment souvent comme une suite de grands
bassins rangés, par étages , les uns au - dessus
des autres , et ne communiquant d’ordinaire que
par d’étroites coupures. Saussure en a signalé cinq
dans la vallée du Rhône depuis son origine jusqu’à
Genève. La grande et belle vallée d’Aoste m’en
a présenté trois ; le plus considérable a 1800 mètres
de large ; les deux autres n’en ont que 600 ;
et les étroites échancrures par lesquelles la Doire
passe de l’un à l’autre, ont à peine quelques
mètres de large. La vallée du N il, dans la haute et
moyenne Egypte , n’est qu’une suite de pareils
bassins , d’après M. Rosières.
Au reste , ces renflements n’empêchent pas que
la plupart des vallées , dans une grande partie de
leur cours , et malgré leurs nombreuses sinuosités
, n’affectent un parallélisme vraiment remarquable
dans les flancs qui les bordent, c’est-à-dire
dans les pentes des deux rameaux, entre lesquelles
elles sont comprises : de manière que lorsqu’un
des flancs forme un angle saillant, l ’autre présente
, à la partie opposée, un angle rentrant dans
lequel le premier semble s’emboîter. Cette correspondance
entre les angles saillants et rentrants
dans les vallées, remarquée d’abord parBourguet,
et donnée par quelques savants comme la clef de
la théorie de la terre, a été peu t-être trop généralisée
; mais il n’en est pas moins très-positif
qu’elle se retrouve à chaque pas qu’on fait dans
les montagnes , et qu’elle ne peut manquer d’y
frapper tout observateur. Plus des trois quarts des
vallées que j’ai vues me l’ont présentée; et ce n’est
guère que dans les grandes et larges vallées que le