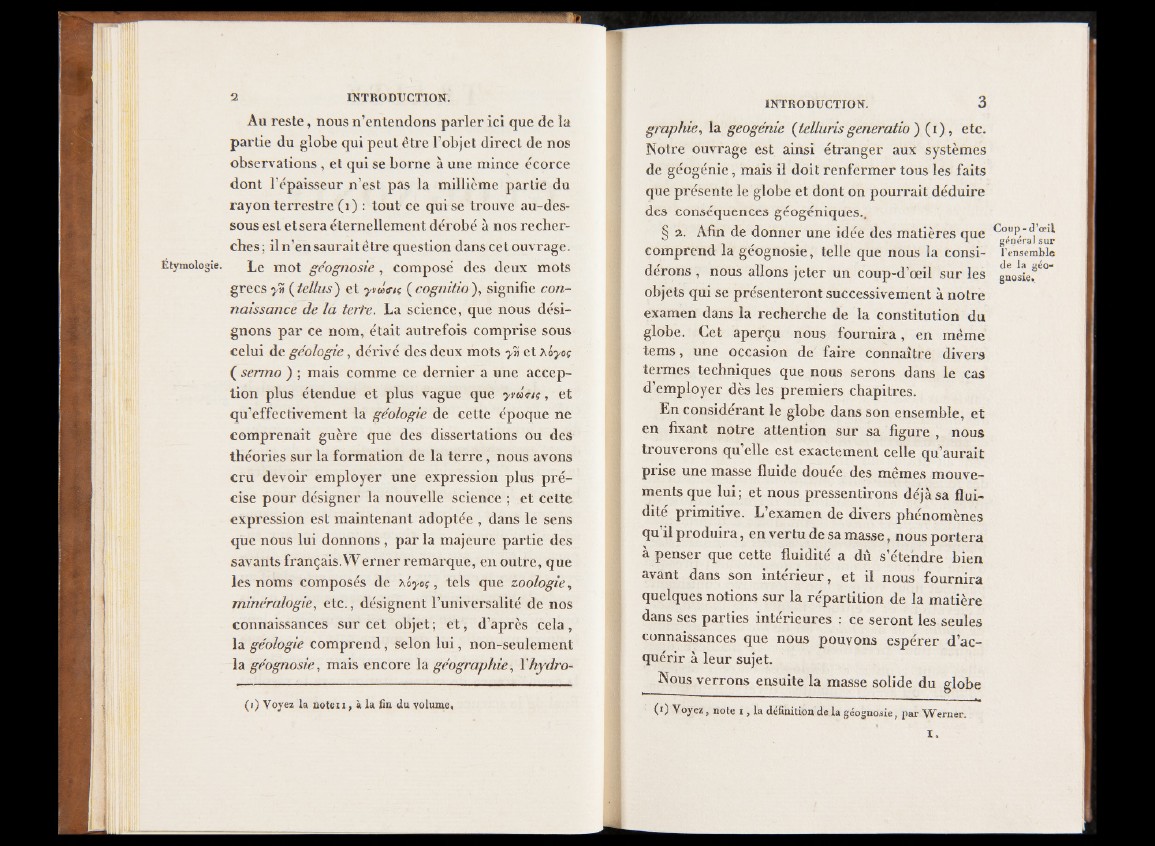
Au reste, nous n’entendons parler ici que de ïa
partie du globe qui peut être l’objet direct de nos
observations, et qui se borne à une mince écorce
dont l ’épaisseur n’est pas la millième partie du
rayon terrestre (1) : tout ce qui se trouve au-dessous
est et sera é ternellement dérobé à nos recherches
; il n’en saurait être question dans cet ouvrage.
Le mot géognosie , composé des deux mots
grecs yti ( tellus ) et yvàeis ( cognitio ), signifie connaissance
de la terte. La science, que nous désignons
par ce nom, était autrefois comprise sous
celui de géologie, dérivé des deux mots yn et xôyoç
( sermo ) ; mais comme ce dernier a une acception
plus étendue et plus vague que yvàaç, et
qu’effectivement la géologie de cette époque ne
comprenait guère que des dissertations ou des
théories sur la formation de la terre, nous avons
cru devoir employer une expression plus précise
pour désigner la nouvelle science ; et cette
expression est maintenant adoptée , dans le sens
que nous lui donnons , par la majeure partie des
savants français.Werner remarque, en outre, que
les noms composés de xôyoç, tels que zoologie,
minéralogie, etc., désignent l’universalité de nos
connaissances sur cet objet; et, d’après cela,
la géologie comprend, selon lu i, non-seulement
la géognosie, mais encore la géographie, Yhydro-
(1) Voyez la noten, à la fin du volume,
graphie, la geogénie (felluris generatio ) (1 ) , etc.
Notre ouvrage est ainsi étranger aux systèmes
de géogénie, mais il doit renfermer tous les faits
que présente le globe et dont on pourrait déduire
des conséquences géogéniques.,
§ 2. Afin de donner une idée des matières que
comprend la géognosie, telle que nous la considérons
, nous allons jeter un coup-d’oeil sur les
objets qui se présenteront successivement à notre
examen dans la recherche de la constitution du
globe. Cet aperçu nous fournira, en même
tems, une occasion de faire connaître divers
termes techniques que nous serons dans le cas
d’employer dès les premiers chapitres.
En considérant le globe dans son ensemble, et
en fixant notre attention sur sa figure , nous
trouverons qu’elle est exactement celle qu’aurait
prise une masse fluide douée des mêmes mouvements
que lui ; et nous pressentirons déjà sa fluidité
primitive. L’examen de divers phénomènes
qu’il produira, en vertu de sa masse, nous portera
à penser que cette fluidité a dû s’étendre bien
avant dans son intérieur, et il nous fournira
quelques notions sur la répartition de la matière
dans ses parties intérieures : ce seront les seules
connaissances que nous pouvons espérer d’acquérir
à leur sujet.
Nous verrons ensuite la masse solide du globe
(1) Voyez, note i , la définition de la géognosie, par Werner.
Coup - d’oeil
général sur
l’ensemble
de la géognosie.