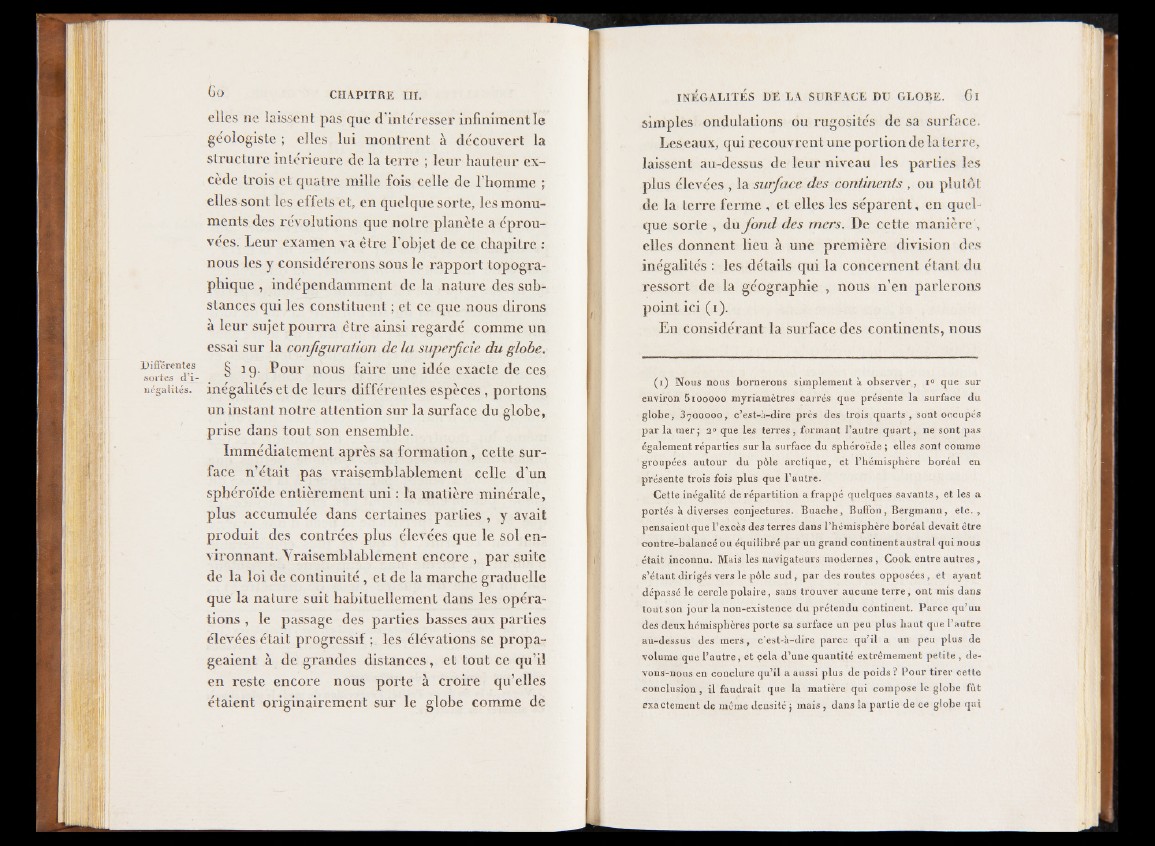
Différentes
sortes d’illégalités.
elles ne laissent pas que d’intéresser infiniment le
géologis te ; elles lui montrent à découvert la
structure intérieure de la terre ; leur hauteur ex-
cede trois et quatre mille fois celle de l ’homme ;
elles sont les effets et, en quelque sorte, les monuments
des révolutions que notre planète a éprouvées.
Leur examen va être l’objet de ce chapitre :
nous les y considérerons sous le rapport topographique
, indépendamment de la nature des substances
qui les constituent ; et ce que nous dirons
à leur sujet pourra être ainsi regardé comme un
essai sur la configuration de la superficie du globe.
§ 19. Pour nous faire une idée exacte de ces
inégalités et de leurs différentes espèces, portons
un instant notre attention sur la surface du globe,
prise dans tout son ensemble.
Immédiatement après sa formation , cette surface
n’était pas vraisemblablement celle d’un
sphéroïde entièrement uni : la matière minérale,
plus accumulée dans certaines parties , y avait
produit des contrées plus élevées que le sol environnant.
Vraisemblablement encore , par suite
de la loi de continuité , et de la marche graduelle
que la nature suit habituellement dans les opérations
, le passage des parties basses aux parties
élevées était progressif ; les élévations se propageaient
à de grandes distances, et tout ce qu’il
en reste encore nous porte à croire qu’elles
étaient originairement sur le globe comme de
simples ondulations ou rugosités de sa surface.
Leseaux, qui recouvrent une portion de la terre,
laissent au-dessus de leur niveau les parties les
plus élevées , la surface des continents , ou plutôt
de la terre ferme , et elles les séparent, en quelque
sorte , du fond des mers. De ce tte manière ,
elles donnent lieu à une première division des
inégalités : les détails qui la concernent étant du
ressort de la géographie , nous n’en parlerons
point ici (1).
En considérant la surface des continents, nous
(1) Nous nous bornerons simplement à observer, i° que sur
environ 5 100000 myriamètres carrés que présente la surface du
globe, 3700000, c’est-à-dire près des trois quarts, sont occupés
par la mer5 20 que les terres, formant l’autre quart, ne sont pas
également réparties sur la surface du sphéroïde ; elles sont comme
groupées autour du pôle arctique, et l’hémisphère boréal en
présente trois fois plus que l’autre.
Cette inégalité de répartition a frappé quelques savants , et les a
portés à diverses conjectures. Buache, Buffon, Bergmann, etc.,
pensaient que l’excès des terres dans l’hémisphère boréal devait être
contre-balancé ou équilibré par un grand continent austral qui nous
était inconnu. Mais les navigateurs modernes , Cook entre autres ,
s’étant dirigés vers le pôle sud , par des routes opposées, et ayant
dépassé le cercle polaire, sans trouver aucune terre, ont mis dans
tout son jour la non-existence du prétendu continent. Parce qu’un
des deux hémisphères porte sa surface un peu plus haut que l’autre
au-dessus des mers, c'est-à-dire parce qu’il a un peu plus de
volume que l’autre, et çela d’une quantité extrêmement petite , devons
nous en conclure qu’il a aussi plus de poids ? Pour tirer cette
conclusion, il faudrait que la matière qui compose le globe fût
exactement de même densité j mais , dans la partie de ce globe qui