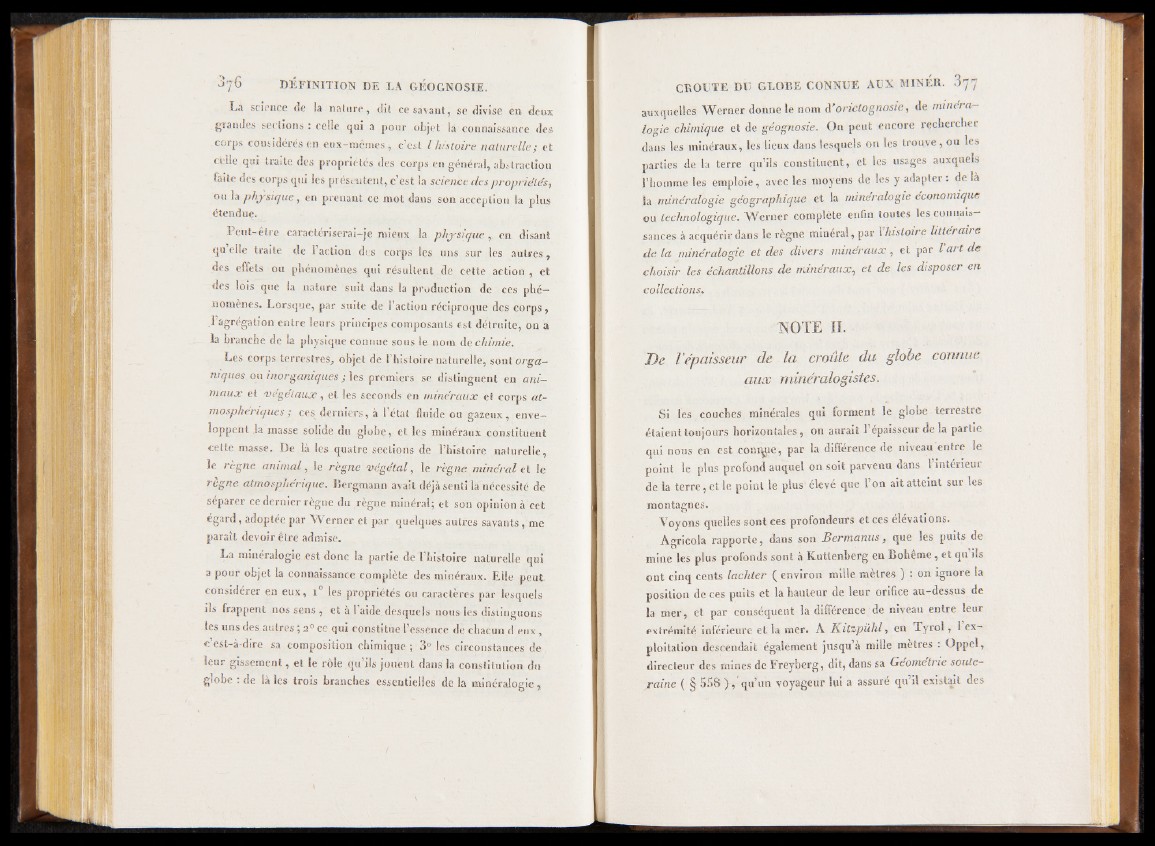
3 y 6 DÉFINITION DE LA GÉOGNOSIE.
La science de la nature, dit ce savant, se divise en deux
grandes sections : celle qui a pour objet la connaissance des
corps considérés en eux-mêmes, c’est l histoire n a tu r e lle ; et
celle qui traite des propriétés des corps en général, abstraction
faite des corps qui les présentent, c’est la science des p rop r ié lé s 7
ou la p h y s iq u e , en prenant ce mot dans son acception la plus
étendue.
Peut-etre caractériserai-je mieux la p h y s iq u e , en disant
qu elle traite de l’action des corps les uns sur les autres,
des effets ou phénomènes qui résultent de cette action , et
des lois que la nature suit dans la production de ces phénomènes.
Lorsque, par suite de l’action réciproque des corps,
l’agrégation entre leurs principes composants est détruite, on a
la branche de la physique connue sous le nom de chimie.
Les corps terrestres, objet de 1 histoire naturelle, sont o rg a niques
ou inorganiques ; les premiers se distinguent en anim
a u x et v é g é ta u x 7 et les seconds en m in é ra u x et corps atm
o sp h é r iq u e s ; ces derniers, à l’état fluide ou gazeux, enveloppent
la masse solide du globe, et les minéraux constituent
cette masse. De là les quatre sections de l’histoire naturelle,
le règn e a n im a l , le r ègn e v é g é ta l , le règne m in é ra l et le
r ègn e atmosphérique. Bergmann avait déjà senti la nécessité de
séparer ce dernier règne du règne minéral; et son opinion à cet
égard, adoptée par Werner et par quelques autres savants, me
paraît devoir être admise.
La minéralogie est donc la partie de 1 histoire naturelle qui
a pour objet la connaissance complète des minéraux. Elle peut
considérer en eux, î les propriétés ou caractères par lesquels
ils frappent nos sens , et a 1 aide, desquels nous les distinguons
les uns des autres ; i ° ce qui constitue l’essence de chacun d eux,
c’est-à dire sa composition chimique ; 3° les circonstances de
leur gissement, et le rôle qu’ils jouent dans la constitution du
globe : de là les trois branches essentielles de la minéraloOgi e ,*
CROUTE DU GLOBE CONNUE AUX MINER. Orj r]
auxquelles Werner donne le nom à’ oricto gn o s ie , de miné ralogie
chimique et de géognosie. On peut encore rechercher
dans les minéraux, les lieux dans lesquels on les trouve, ou les
parties de la terre qu’ils constituent, et les usages auxquels
l’homme les emploie, avec les moyens de les y adapter : de là
la minéralogie géographique et la mineralogie économique
ou technologique. Werner complète enfin toutes les connaissances
à acquérir dans le règne minéral, par l'histoire littéraire
d e la minéralogie et des divers m in é r a u x , et par l ’a r t de
choisir les échantillons d e m in é ra u x , et d e les disposer en
collections.
INOTE 4L
De l ’épaisseur de la croûte du globe connue
aux minéralogistes.
Si les couches minérales qui forment le globe terrestre
étaient toujours horizontales, on aurait l’épaisseur de la partie
qui nous en est commue, par la différence de niveau entre le
point le plus profond auquel on soit parvenu dans 1 intérieur
de la terre, et le point le plus eleve que 1 on ait atteint sur les
montagnes.
Voyons quelles sont ces profondeurs et ces élévations.
Agricola rapporte, dans son B e rm a n u s , que les puits de
mine les plus profonds sont à Kuttenberg en Bohême, et qu’ils
ont cinq cents lachter ( environ mille mètres ) : on ignore la
position de ces puits et la hauteur de leur orifice au-dessus de
la mer, et par conséquent la différence 'de niveau entre leur
extrémité inférieure et la mer. A K i t z p ü h l , en T y ro l, 1 exploitation
descendait également jusqu’à mille métrés : Oppeï,
directeur des mines de Freyberg, dit, dans sa Géométrie soute-
raine ( § 558 ) , qu’un voyageur lui a assuré qu il existait des