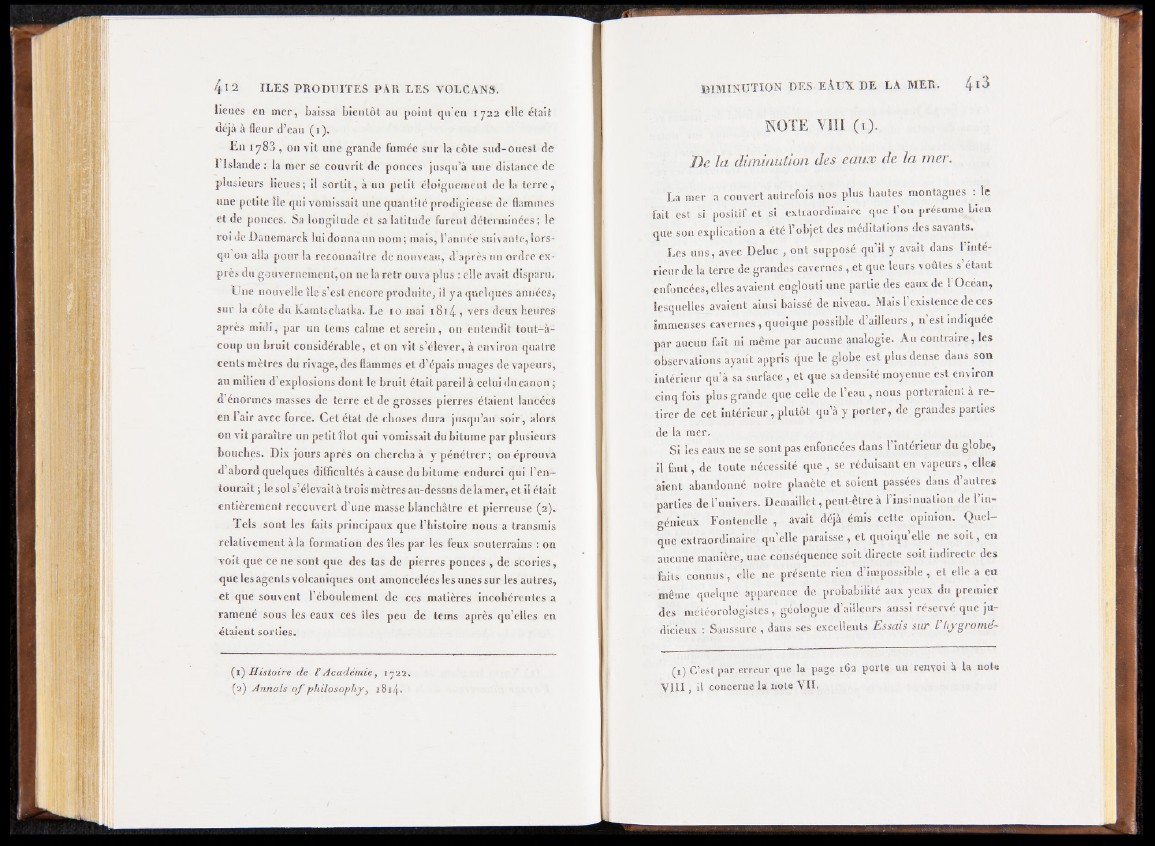
lieues en mer, baissa bientôt au point qu'en 1722 elle était
déjà à fleur d’eau (1).
En 1783, on vit une grande fumée sur la côte sud-ouest de
l’Islande : la mer se couvrit de ponces jusqu’à une distance de
plusieurs lieues; il sortit, à un petit éloignement de la terre,
une petite de qui vomissait une quantité prodigieuse de flammes
et de ponces. Sa longitude et sa latitude furent déterminées; le
roi de Da nemarch lui donna un nom; mais, l’année suivante, lorsqu
on alla pour la reconnaître de nouveau, d’après un ordre exprès
du gouvernement,on ne la retr ouva plus : elle avait disparu.
Une nouvelle île s’est encore produite, il y a quelques années,
sur la côte du Kamtscbatka. Le 10 mai 1814 ? vers deux heures
après midi, par un teins calme et serein, on entendit tout-à-
coup un bruit considérable, et on vit s’élever, à environ quatre
cents mètres du rivage, des flammes et d’épais nuages de vapeurs,
au milieu d’explosions dont le bruit était pareil à celui ducanon ;
d’énormes masses de terre et de grosses pierres étaient lancées
en l’air avec force. Cet état de choses dura jusqu’au soir , alors
on vit paraître un petit îlot qui vomissait du bitume par plusieurs
bouches. Dix jours après on chercha à y pénétrer ; on éprouva
d’abord quelques difficultés à cause du bitume endurci qui l’entourait
; le sol s’élevait à trois mètres au-dessus de la mer, et il était
entièrement recouvert d’une masse blanchâtre et pierreuse (2).
Tels sont les faits principaux que l’histoire nous a transmis
relativement à la formation des îles par les feux souterrains : on
voit que ce ne sont que des tas de pierres ponces , de scories,
que les agents volcaniques ont amoncelées les unes sur les autres,
et que souvent l’éboulemenl de ces matières incohérentes a
ramené sous les eaux ces îles peu de tems après qu’elles en
étaient sorties.
(1) Histoire de VAcadémie, 1722.
(2) Annals o f philosophy, 1814.
NOTE YIII (ODe
la diminution des eaux de la mer.
La mer a couvert autrefois nos plus hautes montagnes : le
fait est si positif et si extraordinaire que l’on présume bien
que son explication a été l’ objet des méditations des savants.
Les uns, avec Deluc , ont supposé qu’il y avait dans l’intérieur
de la terre de grandes cavernes , et que leurs voûtes s’étant
enfoncées, elles avaient englouti une partie des eaux de 1 Océan,
lesquelles avaient ainsi baissé de niveau. Mais l’existence de ces
immenses cavernes, quoique possible d’ailleurs , n est indiquée
par aucun fait ni même par aucune analogie. Au contraire, les
observations ayant appris que le globe est plus dense dans son
intérieur qu’à sa surface , et que sa densité moyenne est environ
cinq fois plus grande que celle de l’eau , nous porteraient à retirer
de cet intérieur, plutôt qu à y porter, de grandes parties
de la mer.
Si les eaux ne se sont pas enfoncées dans l’intérieur du globe,
il faut, de toute nécessité que , se réduisant en vapeurs, elles
aient abandonné notre planète et soient passées dans d’autres
parties de l’univers. Demaillet, peut-être à l’insinuation de l’ingénieux
Fontenelle , avait déjà émis cette opinion. Quelque
extraordinaire qu elle paraisse , et quoiqu elle ne soit, en
aucune manière, une conséquence soit directe soit indirecte des
faits connus, elle ne présente rien d’impossible , et elle a eu
même quelque apparence de probabilité aux yeux du premier
des météorologistes, géologue d’ailleurs aussi réservé que judicieux
: Saussure , dans ses excellents Essais sur l’hygromé-
(1) C’est par erreur que la page 162 porte un renvoi à la note
Y I I I , d concerne la note VII.