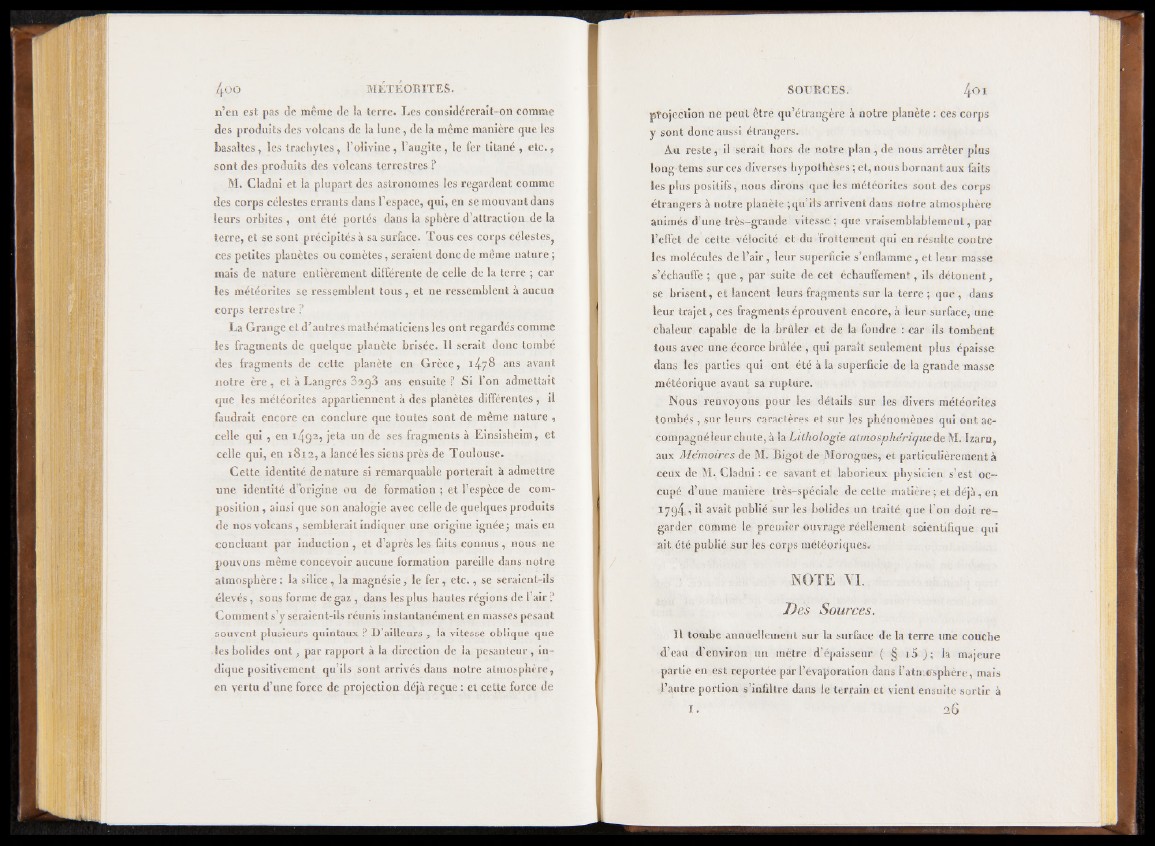
n’en est pas de même de la terre. Les considérerait-on comme
des produits des volcans de la lune, de la même manière que les
basaltes, les trachytes, l’olivine, l’augite, le fer titané , etc.,
sont des produits des volcans terrestres P
M. Cladni et la plupart des astronomes les regardent comme
des corps célestes errants dans l’espace, qui, en se mouvant dans
leurs orbites , ont été portés dans la sphère d’attraction de la
terre, et se sont précipités à sa surface. Tous ces corps célestes^
ces petites planètes ou comètes, seraient donc de même nature ;
mais de nature entièrement différente de celle de la terre ; car
les météorites se ressemblent tous, et ne ressemblent à aucun
corps terrestre ?
La Grange et d’autres mathématiciens les ont regardés comme
les fragments de quelque planète brisée. 11 serait donc tombé
des fragments de cette planète en Grèce, 14.78 ans avant
notre ère, et à Langres 3ag3 ans ensuite ? Si l’on admettait
que les météorites appartiennent à des planètes différentes , il
faudrait encore en conclure que toutes sont de même nature ,
celle qui , en 1492, jeta un de ses fragments à Einsisheim, et
celle qui, en 1812, a lancé les siens près de Toulouse.
Cette identité de nature si remarquable porterait à admettre
une identité d’origine ou de formation ; et l’espèce de composition
, ainsi que son analogie avec celle de quelques produits
de nos volcans, semblerait indiquer une origine ignée; mais en
concluant par induction , et d’après les faits connus, nous ne
pouvons même concevoir aucune formation pareille dans notre
atmosphère : la silice, la magnésie, le fer, etc., se seraient-ils
élevés, sous forme de gaz , dans les plus hautes régions de l’air ?
Comment s’y seraient-ils réunis instantanément en masses pesant
souvent plusieurs quintaux ? D’ailleurs , la vitesse oblique que
les bolides ont, par rapport à la direction de la pesanteur, indique
positivement qu’ils sont arrivés dans notre atmosphère,
en vertu d’une force de projection déjà reçue : et cette fqrce de
pîojection ne peut être qu’étrangère à notre planète : ces corps
y sont donc aussi étrangers.
Au reste, il serait hors de notre plan, de nous arrêter plus
long-tems sur ces diverses hypothèses ; et, nous bornant aux faits
les plus positifs, nous dirons que les météorites sont des corps
étrangers à notre planète ; qu’ils arrivent dans notre atmosphère
animés d’une très-grande vitesse ; que vraisemblablement, par
l’effet de cette vélocité et du frottement qui en résulte contre
les molécules de l’air, leur superficie s’enflamme, et leur masse
s’échauffe ; que , par suite de cet échauffement, ils détonent,
se brisent, et lancent leurs fragments sur la terre ; que , dans
leur trajet, ces fragments éprouvent encore, à leur surface, une
chaleur capable de la brûler et de la fondre : car ils tombent
tous avec une écorce brûlée , qui paraît seulement plus épaisse
dans les parties qui ont été à la superficie de la grande masse
météorique avant sa rupture.
Nous renvoyons pour les détails sur les divers météorites
tombés , sur leurs caractères et sur les phénomènes qui ont accompagné
leur chute, à la Lithologie atmosphérique de M. Izarn,
aux Mémoires de M. Bigot de Morogues, et particulièrement à
ceux de M. Cladni : ce savant et laborieux physicien s’est occupé
d’une manière très-spéciale de cette matière ; et déjà, en
1704, il avait publié sur les bolides un traité que l’on doit regarder
comme le premier ouvrage réellement scientifique qui
ait été publié sur les corps météoriques*
NOTE YI.
Des Sources.
Il tombe annuellement sur la surface de la terre une couche
d’eau d’environ un mètre d’épaisseur ( § i 5 ); la majeure
partie en est reportée par l’évaporation dans l’atmosphère, mais
l’autre portion s’infiltre dans le terrain et vient ensuite sortir à
I. 26