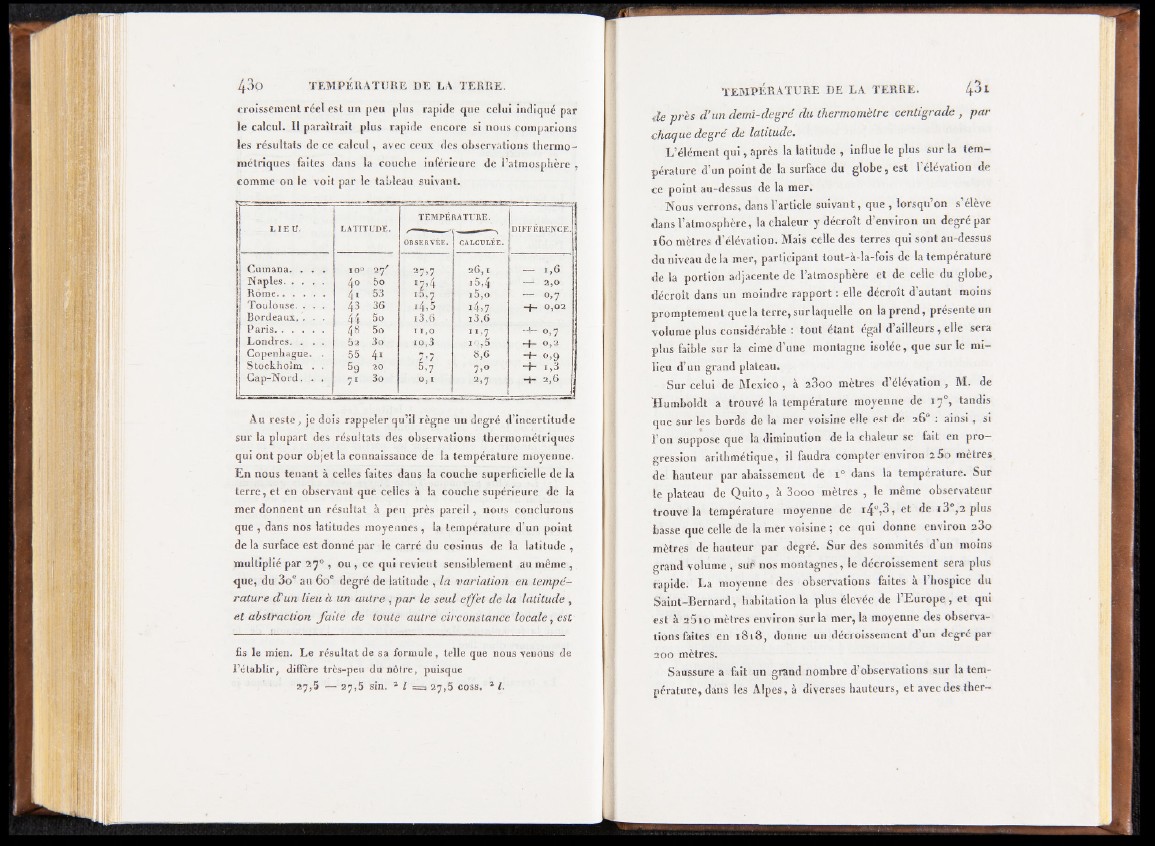
43o
croissement réel est un peu plus rapide que celui indiqué par
le calcul. Il paraîtrait plus rapide encore si nous comparions
les résultats de ce calcul, avec ceux dès observations thermo-
métriques faites dans la couche inférieure de l’atmosphère ,
comme on le voit par le tableau suivant.
LIEU. L A T ITU D E .
TEMPERATURE.
DIFFÉRENCE.
OBSERVÉE. CALCULÉE.
Cuinana. . . . 10° 27' 27>7 26,1 — 1,6
Naples.............. 4o 5o *7>4 15,4 --- ï 2,0 ;
Rome................. 4 t 53 i 5 , 7 i 5,o — 0,7
Toulouse. . . .
Bordeaux. . . .
43 36
44 5o
14.5
13.6 *4,7
i 3 , 6
-f- 0,02
Paris................. 48 5o ï 1,0 1 1,7 - 4 - 0,7 1
Londres. . . . &2 3o io ,3 ro,5 “l- ° ,2
Copenhague. . 55 4 1 7?7 8,6 -+■ Cl,9
Stockholm . . 5o 30 5,7 7>° ~f- i ,3
Cap-Nord, . . 71 3o 0,1 2>7 *4- 2,6
Au reste, je dois rappeler qu’il règne un degré d’incertitude
sur la plupart des résultats des observations thermométriques
qui ont pour objet la connaissance de la température moyenne.
En nous tenant à celles faites dans la couche superficielle de la
terre, et en observant que celles à la couche supérieure de la
mer donnent un résultat à peu près pareil, nous conclurons
que , dans nos latitudes moyennes, la température d’un point
de la surface est donné par le carré du cosinus de la latitude ,
multiplié par iq ° , ou, ce qui revient sensiblement au même ,
que, du 3oe au 60e degré de latitude , la variation en température
d'un lieu à un autre , par le seul effet de la latitude ,
et abstraction fa ite de toute autre circonstance locale, est
fis le mien. Le résultat de sa formule, telle que nous venons de
l ’établir, diffère très-peu du nôtre, puisque
2 7 ,5 — 2 7 ,5 siii. 1 l = 5 2 7 ,5 coss. 1 1.
de près d’ un demi-degré du thermomètre centigrade , par
chaque degré de latitude.
L ’élément q u i, après la latitude , influe le plus sur la température
d’un point de la surface du globe, est l’élévation de
ce point au-dessus de la mer.
Nous verrons, dans l’article suivant, que , lorsqu’on s’ élève
dans l’atmosphère, la chaleur y décroît d’environ un degré par
160 mètres d’élévation. Mais celle des terres qui sont au-dessus
du niveau de la mer, participant tout-à-la-fois de la température
de la portion adjacente de l’atmosphère et de celle du globe,
décroît dans un moindre rapport : elle décroît d’autant moins
promptement que la terre, sur laquelle on la prend, présente un
volume plus considérable : tout étant égal d’ailleurs, elle sera
plus faible sur la cime d’une montagne isolée, que sur le milieu
d’ un grand plateau.
Sur celui de Mexico, à 2800 mètres d’élévation , M. de
Humboldt a trouvé la température moyenne de iy ° , tandis
que sur les bords de la mer voisine elle est de 26° : ainsi, si
l’on suppose que la diminution de la chaleur se fait en progression
arithmétique, il faudra compter environ 25o mètres
de hauteur par abaissement de i° dans la température. Sur
le plateau de Quito, à 3ooo mètres , le même observateur
trouve la température moyenne de i 4u,3, et de i 3 ,2 plus
basse que celle de la mer voisine ; ce qui donne environ 23o
mètres de hauteur par degré. Sur des sommités d’un moins
grand volume , sué nos montagnes, le décroissement sera plus
rapide. La moyenne des observations faites à l’hospice du
Saint-Bernard, habitation la plus élevée de l’Europe, et qui
est à 2510 mètres environ sur la mer, la moyenne des observations
faites en 1818, donne un décroissement d’un degré par
200 mètres.
Saussure a fait un grand nombre d’observations sur la température,
dans les Alpes, à diverses hauteurs, et avec des ther-
.«JO.