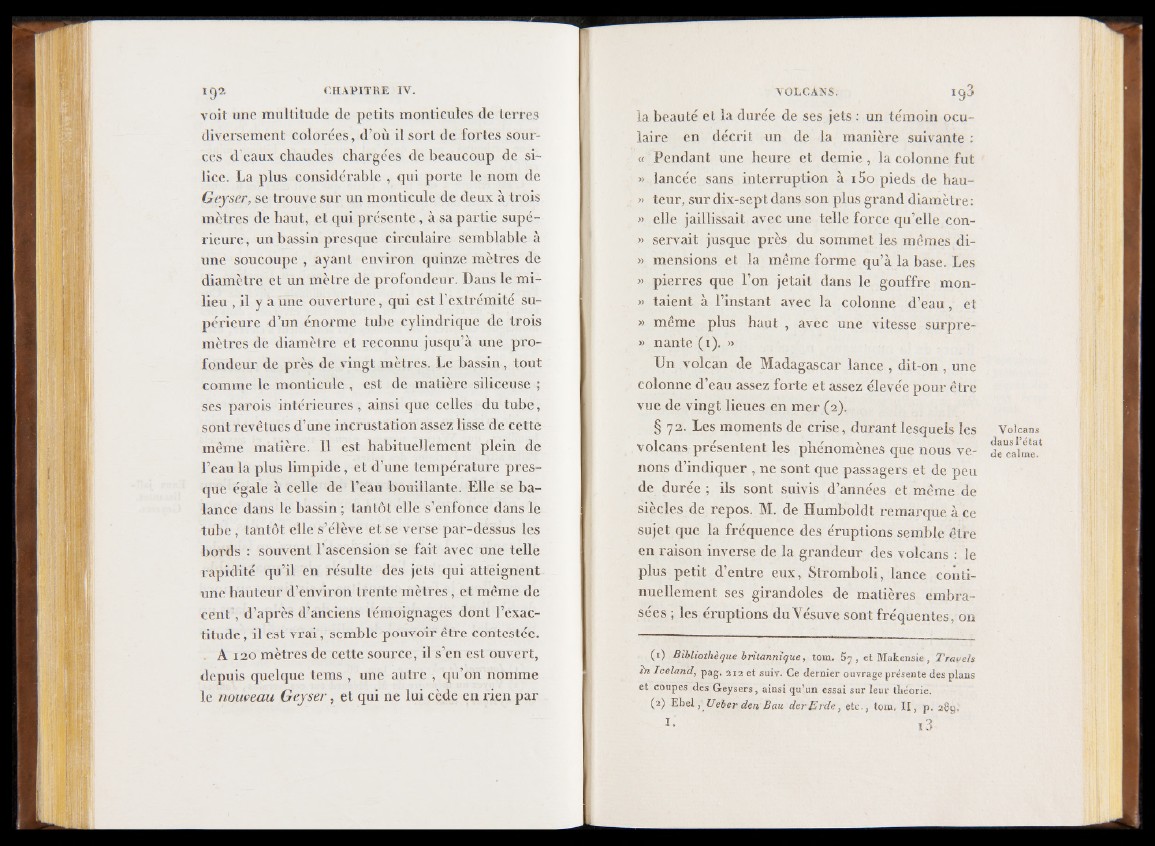
voit une multitude de petits monticules de terres
diversement colorées, d’où il sort de fortes sources
d eaux chaudes chargées de beaucoup de silice.
La plus considérable , qui porte le nom de
Geyser, se trouve sur un monticule de deux à trois
mètres de haut, et qui présente, à sa partie supérieure
, un bassin presque circulaire semblable à
une soucoupe , ayant environ quinze mètres de
diamètre et un mètre de profondeur. Dans le milieu
, il y à une ouverture, qui est l’extrémité supérieure
d’un énorme tube cylindrique de trois
mètres de diamètre et reconnu jusqu’à une profondeur
de près de vingt mètres. Le bassin, tout
comme le monticule , est de matière siliceuse ;
ses parois intérieures, ainsi que celles du tube,
sont revêtues d’une incrustation assez lisse de cette
même matière. Il est habituellement plein de
l ’eau la plus limpide, et d’une température presque
égale à celle de l’eau bouillante. Elle se balance
dans le bassin ; tantôt elle s’enfonce dans le
tube, tantôt elle s’élève et se verse par-dessus les
bords : souvent l ’ascension se fait avec une telle
rapidité qu’il en résulte des jets qui atteignent
une hauteur d’environ trente mètres, et même de
cent, d’après d’anciens témoignages dont l’exactitude,
il est vrai, semble pouvoir être contestée.
. A 120 mètres de cette source, il s’en est ouvert,
depuis quelque tems , une autre , qu’on nomme
le nouveau Geyser, et qui ne lui cède en rien par
la beauté et la durée de ses jets : un témoin oculaire
en décrit un de la manière suivante :
« Pendant une heure et demie , la colonne fut
» lancée sans interruption à i 5o pieds de hau-
« teur, sur dix-sep t dans son plus grand diamètre :
» elle jaillissait avec une telle force qu’elle con-
» servait jusque près du sommet les mêmes di-
» mensions et la même forme qu’à la base. Les
» pierres que l’on jetait dans le gouffre mon-
» taient à l ’instant avec la colonne d’eau, et
» même plus haut , avec une vitesse surpre-
» nante (1). »
Un volcan de Madagascar lance , dit-on , une
colonne d’eau assez forte et assez élevée pour être
vue de vingt lieues en mer (2).
§ 72. Les moments de crise, durant lesquels les
volcans présentent les phénomènes que nous venons
d’indiquer , ne sont que passagers et de peu
de durée ; ils sont suivis d’années et même de
siècles de repos. M. de Humboldt remarque à ce
sujet que la fréquence des éruptions semble être
en raison inverse de la grandeur des volcans : le
plus petit d’entre eux, Stromboli, lance continuellement
ses girandoles de matières embrasées
; les éruptions du Vésuve sont fréquentes, on
(1) Bibliothèque britannique, tom. 5q , et Makensie, Travels
in Iceland, pag. 212 et suiv. Ce dernier ouvrage présente des plans
et coupes des Geysers, ainsi qu’un essai sur leur théorie.
(2) Ebel, Ueber den Bau derErd e, etc., tom. I I , p. 289.
$ l 3
Volcans
dans l’état
de calme.