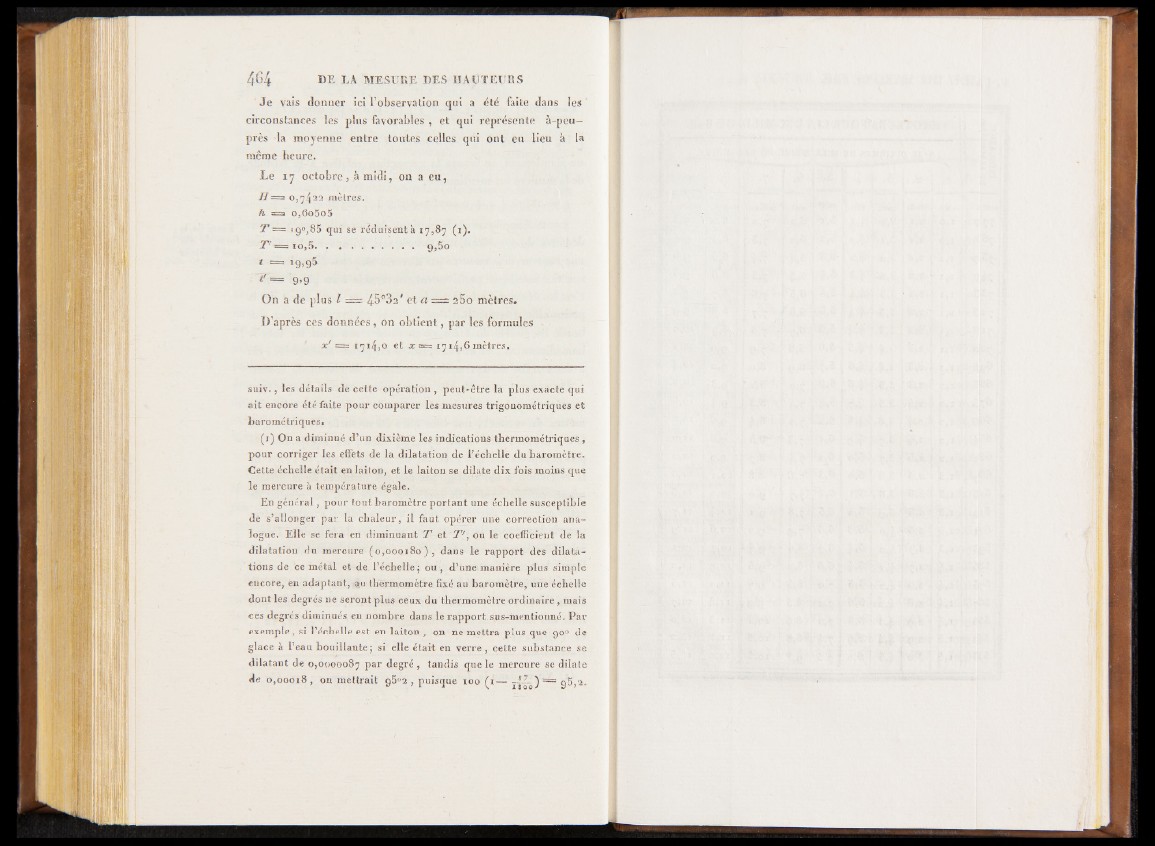
DE LÀ 464 MESURE DES HAUTEURS
Je yais donner ici l’observation qui a été faite dans les
circonstances les plus favorables , et qui représente à-peu-
près la moyenne entre toutes celles qui ont eu lieu à la
même heure.
Le 17 octobre, à midi, on a eu,
H== 0,7/j23 mètres.
h = o,6o5o5
T = t.90,85 qui se réduisent à 17,87 (1).
.7’' ' = 10 ,5.............................. .... 9 ,5 o
1 == I9>9^
ir~ 9’9
On a de plus l = 4-5°32* et a = 25o mètres.
D’après ces données, on obtient, par les formules
x ' = 171^,0 et x = 1714,6 mètres. *1
suiv., les détails de cette opération , peut-être la plus exacte qui
ait encore été faite pour comparer les mesures trigonométriques et
barométriques.
(1) On a diminué d’un dixième les indications thermométriques ,
pour corriger les effets de la dilatation de l’échelle du baromètre.
Cette échelle était en laiton, et le laiton se dilate dix fois moins que
le mercure à température égale.
En général, pour tout baromètre portant une échelle susceptible
de s’ allonger par la chaleur, il faut opérer une correction analogue.
Elle se fera en diminuant T et T ' , ou le coefficient de la
dilatation du mercure (0,000180), dans le rapport des dilatations
de ce métal et de l’échelle ; ou, d’une manière plus simple
encore, en adaptant, au thermomètre fixé au baromètre, une échelle
dont les degrés ne seront plus ceux du thermomètre ordinaire , mais
ces degrés diminués en nombre dans le rapport sus-mentionné. Par
exemple, si l’échelle est en laiton , on ne mettra plus que 90° de
glace à l’eau bouillante; si elle était en verre , cette substance se
dilatant de 0,0000087 par degré, tandis que le mercure se dilate
de 0,00018, on mettrait , puisque 100 (1— g5,a.