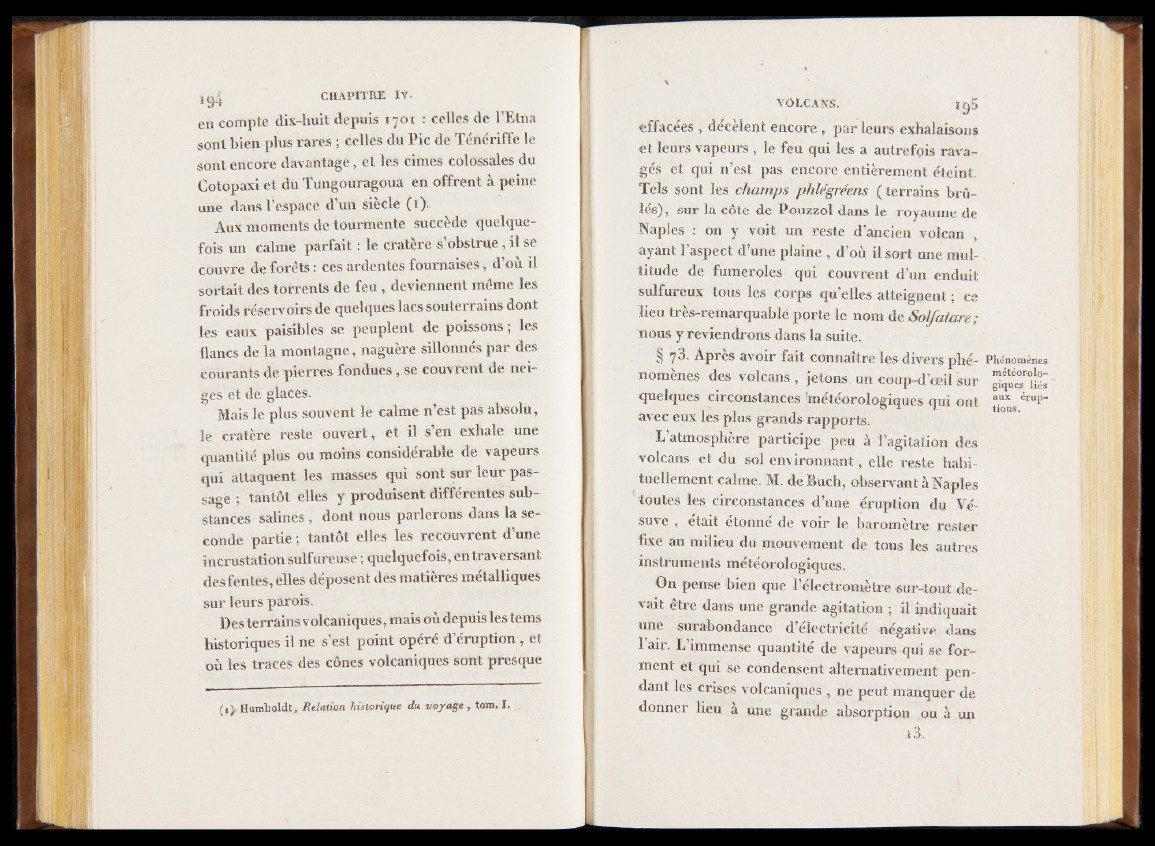
en compte dix-huit depuis 1701 : celles de l’Etna
sont bien plus rares ; celles du Pic de Ténériffe le
sont encore davantage, et les cimes colossales du
Cotopaxi et du Tungouragoua en offrent à peine
une dans l ’espace d’un siècle (1).
Aux moments de tourmente succède quelquefois
un calme parfait : le cratère s’obstrue, il se
couvre de forêts : ces ardentes fournaises, d’où il
sortait des torrents de feu , deviennent même les
froids réservoirs de quelques lacs souterrains dont
les eaux paisibles se peuplent de poissons ; les
flancs de la montagne, naguère sillonnés par des
courants de pierres fondues, se couvrent de neiges
et de glaces.
Mais le plus souvent le calme n’est pas absolu,
le cratère reste ouvert, et il s’en exhale une
quantité plus ou moins considérable de vapeurs
qui attaquent les masses qui sont sur leur passage
; tantôt elles y produisent différentes substances
salines , dont nous parlerons dans la seconde
partie ; tantôt elles les recouvrent d’une
incrustation sulfureuse ; quelquefois, en traversant
des fentes, elles déposent des matières métalliques
sur leurs parois.
Des terrains volcaniques, mais où depuis les tems
historiques il ne s est point opéré d éruption, et
où les traces des cônes volcaniques sont presque
f i } Humboldt, Relation historique du voyage , tom. I.
effacées , décèlent encore , par leurs exhalaisons
et leurs vapeurs , le feu qui les a autrefois ravagés
et qui n’est pas encore entièrement éteint.
Tels sont les champs phlégréens (terrains brûlés),
sur la côte de Pouzzol dans le royaume de
Naples : on y voit un reste d’ancien volcan
ayant l ’aspect d’une plaine , d’où il sort une multitude
de fumeroles qui couvrent d’un enduit
sulfureux tous les corps qu’elles atteignent ; ce
lieu très-remarquable porte le nom de Solfatare;
nous y reviendrons dans la suite.
§ 7^. Apres avoir fait connaître les divers phénomènes
des volcans , jetons, un coup-d’oeil sur
quelques circonstances 'météorologiques qui ont
avec eux les plus grands rapports.
L’atmosphère participe peu à l ’agitation des
volcans et du sol environnant, elle reste habituellement
calme. M. de fhich, observant à Naples
toutes les circonstances d’une éruption du Vésuve
, était étonné de voir le baromètre rester
fixe au milieu du mouvement de tous les autres
instruments météorologiques.
On pense bien que l ’électromètre sur-tout devait
être dans une grande agitation ; il indiquait
une surabondance d’électricité négative dans
l ’air. L’immense quantité de vapeurs qui se forment
et qui se condensent alternativement pendant
les crises volcaniques , n e peut manquer de
donner lieu à une grandie absorption ou à un
Phénomènes
météorologique^
liés
aux éruptions.