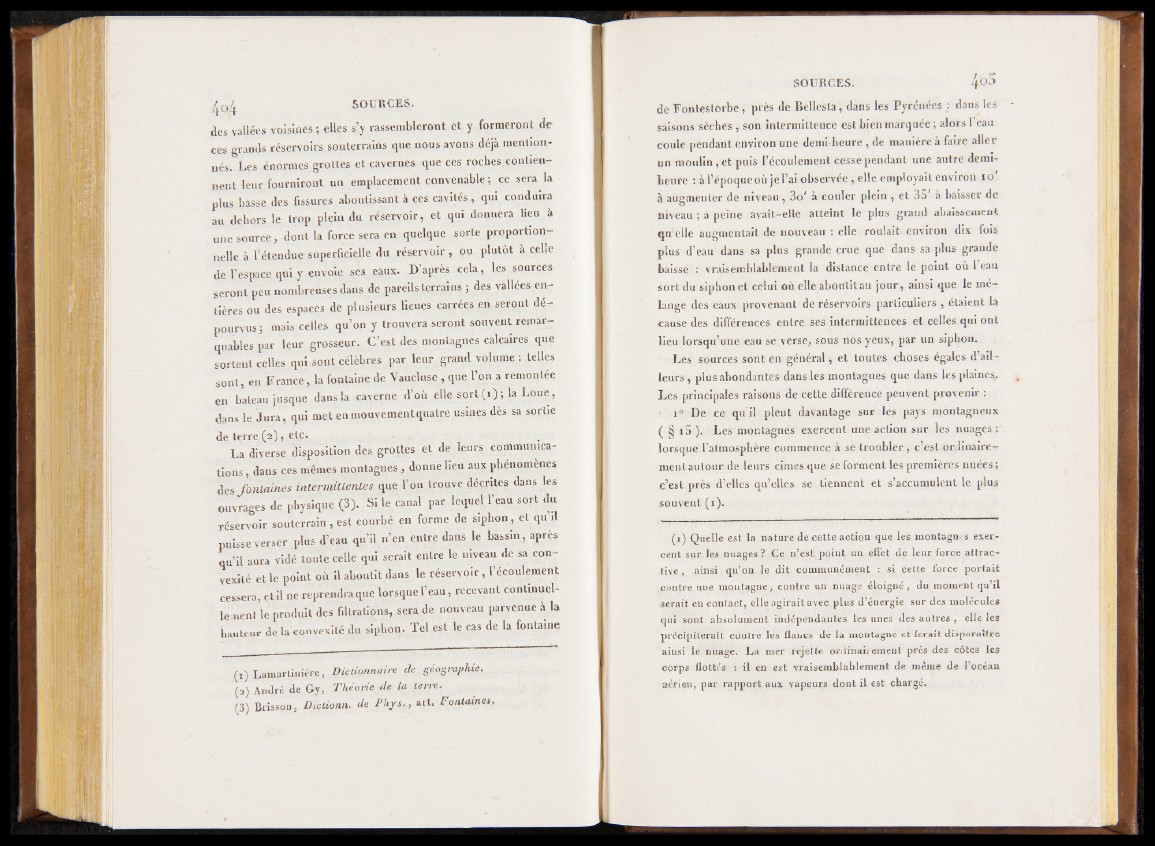
/n/( SOURCES.
clés vallées voisines ; elles s’y rassembleront et y formeront de
ces grands réservoirs souterrains que nous avons déjà mentionnés.
Les énormes grottes et cavernes que ces roches contiennent
leur fourniront un emplacement convenable ; ce sera la
plus basse des fissures aboutissant à ces cavités , qui conduira
au dehors le trop plein du réservoir, et qui donnera lieu a
une source, dont la force sera en quelque sorte proportionnelle
à l’étendue superficielle du réservoir , ou plutôt à celle
de l’espace qui y envoie ses eaux. D’après cela, les sources
seront peu nombreuses dans de pareils terrains ; des vallées entières
ou des espaces de plusieurs lieues carrées en seront dépourvus
j mais celles qu’on y trouvera seront souvent remarquables
par leur grosseur. C’est des montagnes calcaires que
sortent celles qui sont célèbres par leur grand volume : telles
sont, en France, la fontaine de Vaucluse , que l’on a remontée
en bateau jusque dans la caverne d’où elle sort (i) ; la Loue,
dans le Jura, qui met en mouvement quatre usines dès sa sortie
de terre (2), etc.
La diverse disposition des grottes et de leurs communications
, dans ces mêmes montagnes , donne lieu aux phénomènes
des fontaines intermittentes que l’on trouve décrites dans les
ouvrages de physique (3). Si le canal par lequel l’eau sort du
réservoir souterrain, est courbé en forme de siphon , et qu il
puisse verser plus d’eau qu’il n’en entre dans le bassin, après
qu’il aura vidé toute celle qui serait entre le niveau de sa convexité
et le point où il aboutit dans le réservoir , l’écoulement
cessera, et il ne reprendra que lorsque l’eau, recevant continuellement
le produit des filtrations, sera de nouveau parvenue a la
hauteur de la convexité du siphon. Tel est le cas de la fontaine
(1) Lamartinière, Dictionnaire de géographie.
(2) André de Gy, Théorie de la terre.
(3) Brisson, Dictionn. de P h y s ., art. Fontaines,
de Fontestorbe , près de Bellesta , dans les Pyrénées : dans les
saisons sèches , son intermittence est bien marquée ; alors l’eau
coule pendant environ une demi-heure , de manière à faire aller
un moulin, et puis T écoulement cesse pendant une autre demi-
heure : à l’époque où je l’ai observée, elle employait environ 10
à augmenter de niveau, 3o( à couler plein , et Sb7 à baisser de
niveau ; à peine avait-elle atteint le plus grand abaissement
qu elle augmentait de nouveau : elle roulait environ dix fois
plus d’eau dans sa plus grande crue que dans sa plus grande
baisse : vraisemblablement la distance entre le point où l’eau
sort du siphon et celui où elle aboutit au jour, ainsi que le mélange
des eaux provenant de réservoirs particuliers , étaient la
cause des différences entre ses intermittences et celles qui ont
lieu lorsqu’une eau se verse, sous nos yeux, par un siphon.
Les sources sont en général, et toutes choses égales d’ailleurs
, plus abondantes dans les montagnes que dans les plaines,.
Les principales raisons de cette différence peuvent provenir :
i° De ce qu’il pleut davantage sur les pays montagneux
( § i5 ). Les montagnes exercent une action sur les nuages
lorsque l’atmosphère commence à se troubler , c’est ordinairement
autour de leurs cimes que se forment les premières nuées ;
c’est près d’elles qu’elles se tiennent et s’accumulent le plus
souvent (1).
(1) Quelle est la nature de cette action que les montagnes exercent
sur les nuages ? Ce n’ est point un effet de leur force attractive
, ainsi qu’on le dit communément : si cette force portait
contre uue montagne, contre un nuage éloigné, du moment qu’il
serait en contact, elle agirait avec plus d’énergie sur des molécules
qui sont absolument indépendantes les unes des autres , elle les
précipiterait contre les flancs de la montagne et ferait disparaître
ainsi le nuage. La mer rejette ordinairement près des côtes les
corps flottés : il en est vraisemblablement de même de l’océan
aérien, par rapport aux vapeurs dont il est chargé.