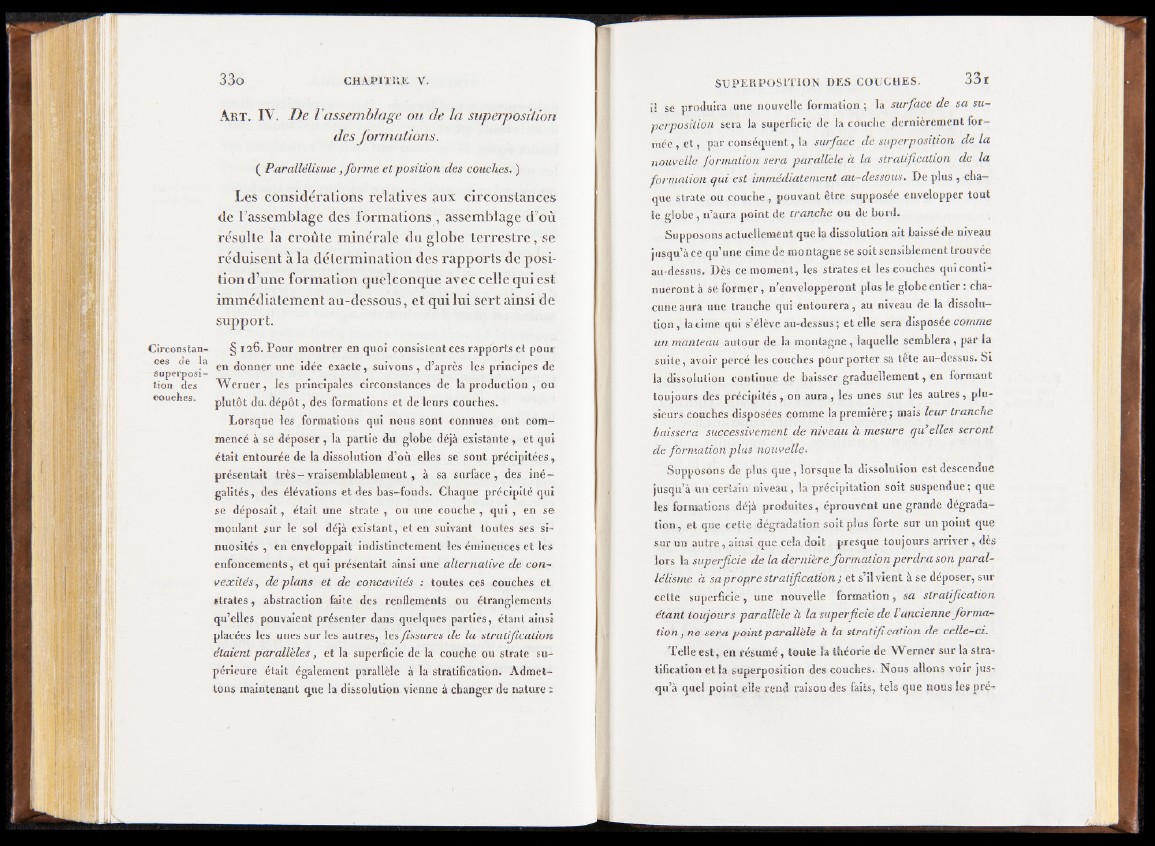
Circonstances
de la
superposition
des
couches.
A r t . IV. De l ’assemblage ou de la superposition
des formations.
( Parallélisme, forme et position des couches. )
Les considérations relatives aux circonstances
de l’assemblage des formations , assemblage d’où
résulte la croûte minérale du globe terrestre, se
réduisent à la détermination des rapports de position
d’une formation quelconque avec celle qui est
immédiatement au-dessous, et qui lui sert ainsi de
support.
§ 126. Pour montrer en quoi consistent ces rapports et pour
en donner une idée exacte, suivons , d’après les principes de
W ern er, les principales circonstances de la production , ou
plutôt du, dépôt, des formations et de leurs couches.
Lorsque les formations qui nous sont connues ont commencé
à se déposer , la partie du globe déjà existante , et qui
était entourée de la dissolution d’où elles se sont précipitées,
présentait très — vraisemblablement , à sa surface , des iné —
galités, des élévations et des bas-fonds- Chaque précipité qui
se déposait, était une strate , ou une couche , qui , en se
moulant sur le sol déjà existant, et en suivant toutes ses sinuosités
, en enveloppait indistinctement les éminences et les
enfoncements, et qui présentait ainsi une alternative de convexités
, de plans et de concavités : toutes ces couches et
strates, abstraction faite des renflements ou étranglements
qu’elles pouvaient présenter dans quelques parties, étant ainsi
placées les unes sur les autres, les fissures de la stratification
étaient parallèles, et la superficie de la couche ou strate supérieure
était également parallèle à la stratification. Admettons
maintenant que la dissolution vienne à changer de nature ;
il se produira une nouvelle formation ; la surface de sa superposition
sera la superficie de la couche dernièrement formée
, e t , par conséquent, la surface de superposition de la
nouvelle formation sera parallèle à la stratification de la
formation qui est immédiatement au-dessous. De plus , chaque
strate ou couche , pouvant être supposée envelopper tout
le globe, n’aura point de tranche ou de bord.
Supposons actuellement que la dissolution ait baissé de niveau
jusqu’à ce qu’une cime de montagne se soit sensiblement trouvée
au-dessus, Dès ce moment, les strates et les couches quiconti*
nueront à se former, n’envelopperont plus le globe entier : chacune
aura une tranche qui entourera, au niveau de la dissolution,
la cime qui s’élève au-dessus; et elle sera disposée comme
un manteau autour de la montagne, laquelle semblera, par la
suite, avoir percé les couches pour porter sa tête au-dessus. Si
la dissolution continue de baisser graduellement, en formant
toujours des précipités , on aura , les unes sur les autres, plusieurs
couches disposées comme la première; mais leur tranche
baissera successivement de niveau à mesure qu’ elles seront
de formation plus nouvelle.
Supposons de plus que, lorsque la dissolution est descendue
jusqu’à un certain niveau , la précipitation soit suspendue ; que
les formations déjà produites, éprouvent une grande dégradation,
et que cette dégradation soit plus forte sur un point que
sur un autre, ainsi que cela doit presque toujours arriver , dès
lors la superficie de la dernière formation perdra son parallélisme
à sa propre stratification ; et s’il vient à se déposer, sur
cette superficie, une nouvelle formation, sa stratification
étant toujours parallèle à la superficie de Vancienne formation,
ne sera point parallèle à la stratification de celle-ci.
Telle est, en résumé, toute la théorie de Werner sur la stratification
et la superposition des couches. Nous allons voir jusqu’à
quel point elle rend raison des faits, tels que nous les pré